
Schubert, un classique parmi les romantiques ? Pauline Borrel. 24-01-23

Avec tous les remerciements du comité éditorial pour les jeunes musiciens et le chanteur qui ont interprété quelques « moments » musicaux de Schubert pour illustrer la conférence de P. Borel.
D’après nature ? Les artistes à la ménagerie. Nathalie Cournarie. 13-12-22.

Une ménagerie scientifique : au plus près de l’animal
« Le lion est mort. – Au galop. Le temps qu’il fait doit nous y activer. Je vous attends. »[1] Eugène Delacroix adresse ce célèbre billet à son compagnon de jeunesse, le sculpteur Antoine-Louis Barye, l’un et l’autre représentants de l’art animalier romantique, sans doute à la mi-octobre 1816, en réaction à la mort d’un lion d’Afrique, pensionnaire de la ménagerie du Museum d’Histoire naturelle au Jardin des Plantes à Paris.
Pourquoi tant d’empressement et même de fébrilité chez ces deux jeunes artistes (18/21 ans) ? Ils partagent le désir ardent d’aller dessiner sur place, et dans l’urgence, la dépouille du lion, avant qu’elle ne soit emportée. Animés d’une passion commune pour les fauves et leur sauvagerie, ils saisissent l’occasion d’observer, sans doute d’assez près, le lion, et de le dessiner (le modèle mort tient la pose et montre mieux ses caractéristiques anatomiques…), accumulant de précieuses études en prévision d’œuvres ultérieures. Sans doute pourront-ils assister ensuite à une séance de dissection dans l’amphithéâtre d’anatomie, car la ménagerie est intégrée à un établissement scientifique, sous la direction de spécialistes renommées de l’anatomie comparée : Georges Cuvier, directeur du laboratoire d’anatomie comparée, et Etienne Geoffroy Saint Hilaire, zoologue, précurseur de la paléontologie, qui lui n’est pas forcément convaincu de l’utilité de l’observation du comportement de l’animal.
En effet, si le Jardin des Plantes est une des plus éminentes institutions scientifiques, il développe aussi un programme d’enseignement artistique, ce qui est moins connu, et au plus près de l’animal : des leçons gratuites de dessin et de peinture, un cours public de dessin de zoologie, dont Barye lui-même sera chargé en 1854.


A gauche : Eugène Delacroix, Deux études d’un lion écorché, 1829, mine de plomb sur papier, 24,9 cm x 19,2 cm, (Paris, Musée du Louvre, arts graphiques). A droite : Louis-Antoine Barye, Lionne de l’amiral Rigny, 1828, mine de plomb sur papier,14,8 cm cx 19,6 cm (Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts)
Le Museum conserve aussi une collection d’œuvres présentant plantes et animaux naturalisés, que les naturalistes et les dessinateurs peuvent étudier ou copier à des fins scientifiques ou artistiques. C’est tout à la fois un lieu de diffusion des connaissances et un lieu de conservation. Mais sa collection fondamentale, celle qui contribue intensément à l’étude de la nature, reste celle des animaux vivants captifs de la ménagerie. Issue de la Révolution, projetée dès 1792, cette ménagerie est voulue par Bernardin Saint-Pierre[2], intendant du Jardin des Plantes dans la continuité de l’œuvre de Buffon, afin de permettre aux artistes de travailler sur l’original plutôt que sur la copie- c’est son propos polémique sur le lion baroque de la sculpture de Pierre Puget, Milon de Crotone, 1683, qui sert d’argument décisif- la ménagerie[3] est finalement ouverte en 1794 et elle ouvre aussi aux scientifiques la possibilité d’étudier le comportement des animaux, , et aux artistes de travailler d’après le vivant.

Pierre Puget, Milon de Crotone, 1683, marbre (Paris, Musée du Louvre)
Qu’il soit vif ou mort, le modèle animal est mis à disposition des artistes qui représentent la nature, dans un contexte où l’imitation de celle-ci reste au cœur de la théorie classique de l’art.
L’historien d’art peut se demander comment et dans quelle mesure la ménagerie favorise chez les artistes le développement d’une représentation naturaliste de l’animal vivant ou mort, pour mieux interroger leur propre rapport à la nature et en tirer des modes de figuration originaux de l’animal ? L’histoire de la représentation artistique de l’animal est une histoire de la vision rapprochée, qui relève selon Daniel Arasse situe d’une « histoire du détail » en peinture : « c’est souvent en définitive, moins la vérité de la représentation en elle-même qui retient alors l’artiste que sa vérité en peinture, en fonction de son intégration dans l’ensemble ou le détail s’insère »[4].
Rappel sur l’histoire des ménageries
Le mot ménagerie n’apparaît qu’au XVIIe siècle. On parlait auparavant de « sérails » par exemple. Les artistes, quand ils ont le privilège exceptionnel d’accéder à ces collections princières, dessinent d’après nature pour mieux imiter capter les formes et les volumes, traduire les attitudes des animaux en satisfaisant les attentes des cours aristocratiques. Sous leurs yeux, se déploient la sauvagerie et la beauté animales, mais aussi les rapports diplomatiques entre les animaux, qui les invitent à traduire aussi une émotion esthétique.
Il faut rappeler – à l’heure de la disparition des ménageries et de la transformation des zoos sous la poussée de la conscience de la condition animale – certains animaux sont omniprésents dans la vie quotidienne, du Moyen Age à la fin du XVIIIe s (vie domestique et chasse).
Il faut également rappeler l’existence de ménageries ambulantes qui donnent par exemple l’occasion à Léonard d’esquisser une tête d’ours, qu’il réutilisera dans La dame à l’hermine.


A gauche : Léonard de Vinci : Étude de tête d’ours, vers 1480, pointe d’argent sur papier (New-York, coll. Priv.). A droite, La dame à l’hermine, 1488, huile sur panneau de bois (Cracovie, Musée Czartorisky)
Mais il faut surtout insister, à partir du XVIe siècle sur le rôle des ménageries princières où se développent les collections d’animaux curieux, par goût de l’exotisme, du rare et du précieux (le mot apparaît à la même époque), sans aucun usage concret donc : les animaux en quelque sorte sont des objets de magnificence qui traduisent le prestige des grands et des puissants : la ménagerie est en effet un privilège princier (Jan Brueghel l’ancien (peintre flamand- XVe-XVIe s, qui a écrit dans sa correspondance qu’il travaillait d’après nature := se revendique comme peintre de naturalia) : les archiducs Albert et Isabelle dans le jardin de leur château à Coudenberg, 1620-1629, huile sur bois, Anvers Rubenhuis. Image harmonieuse d’espèces qui coexistent en liberté. Les animaux exotiques sont très rares en Europe.

Jan Brueghel l’Ancien, Les archiducs Albert et Isabelle en promenade dans le parc du palais de Coudenberg, début XVIIe s, huile sur toile (Anvers, Rubenshuis)
Le guépard, vedette des ménageries princières, d’une des premières représentations de ménageries avec son dispositif architectural, par Jacopo Bellini en 1440- guépard au centre à comparer avec les guépards inclus dans la procession des Mages de Gozzoli au milieu du tout le luxe de la cour des Medicis qui emprunte à son livre de modèles), herbivores (chameaux, lamas). On ajoute Deux études de guépard de Giovannino de Grassi pour leur beauté.


A gauche : Jacopo Bellini, Esquisse d’une ménagerie, 1440, dessin (Londres, British Museum). A droite : Giovannino de Grassi, Deux études de guépard, vers 1400-1410 (Londres, British Museum
La rareté de ces animaux est essentielle dans la constitution des ménageries princières : car de fait, ces animaux-là sont aussi précieux que des œuvres d’art et comme elles se rangent dans des collections — avec cette différence majeure que leur espérance de vie en captivité, avec des soins hasardeux, est brève. Cela n’empêche pas les souverains lorsqu’ils mènent une vie itinérante, de se déplacer avec leur ménagerie (Antoine Caron). Cortège royal ordonné
Pour se faire une idée de cette rareté :
Rhinocéros (2 specimens vivant au XVIe)
crocodiles à Versailles en 1640,
orangs-outans en Hollande au même moment
éléphants (2 à Versailles dans les années 1660-1670, un autre en 1775)
kangourous en Angleterre au XVIIIe
girafe dont Laurent de Médicis possédait un spécimen à Florence en 1486 (Vasari, Les ambassadeurs présentant leurs hommages à Laurent le Magnifique, 1556-58, Florence Palazzo Vecchio- hommage qui aurait été rendu dans la 2è moitié XVe), pour la 1ère fois en France en 1826.

Antoine Caron, Départ de la cour du Château d’Anet, ou Le voyage, vers 1570 dessin préparatoire pour l’un des tapisseries des Valois, encre brune, lavis brun, pierre noire (Paris, Musée du Louvre)
Le faux et le vrai vif
Reprenons l’hypothèse de D. Arasse qui ramène l’art animalier au cœur de l’histoire de l’art du détail : l’animal de ménagerie, en tant qu’objet de représentation, est l’une des figures qui déclenche l’avènement d’une vision rapprochée naturaliste dans les arts figuratifs, et donc le dépassement du symbolisme schématisant qui prévaut au Moyen Âge, mais avec une ambiguïté entre ce qu’on peut nommer le vrai et le faux vif.
Comme témoignage du vrai vif, les lions de Dürer, vrais par l’ennui qui les accable et le célèbre éléphant de Rembrandt plus vrai que nature.
Et pour montrer que de l’observation directe à l’imagination qu’excite l’animal chez l’artiste, de la nature à la poésie, il n’y a parfois qu’un pas, ainsi la plus splendide représentation d’animal de ménagerie, exécutée par l’un des artistes maîtrisant le plus le réalisme figuratif (cf. le lièvre ou la touffe d’herbe), est le Rhinocéros d’Albrecht Dürer (1515, gravure sur bois sur papier, Paris BNF) manifeste un irréalisme fantaisiste : un rhinocéros unicornis (espèce aujourd’hui en voie de disparition), considéré comme un animal extrêmement dangereux capable de vaincre un éléphant (récit de Pline).

Albrecht Dürer, Rhinocéros, 1515, gravure sur bois (Londres, British Museum)
Un étrange animal, cadeau diplomatique offert par le Sultan de Cambay au roi du Portugal Manuel Ier, débarque le 20 mai 1515 au port de Lisbonne. Mais Dürer ne travaille pas de visu, car il ne dispose à Nuremberg que d’un croquis de l’animal accompagné d’une description écrite que lui envoie un marchand germanophone installé à Lisbonne. Il transpose l’animal en une sorte de gigantesque crustacé armé d’une carapace avec une peau plissée, des écailles de reptile sur les pattes, agrémenté d’une queue d’éléphant, arborant une corne torsadée qui l’apparente à la licorne ou au narval, animaux légendaires, et d’une deuxième petite corne torsadée au niveau du garrot. Le succès de la gravure de Dürer est tel, que ce « Rhinocérus » chimérique sert, jusqu’au XVIIIe s, d’illustration aux ouvrages de zoologie moderne.
Du modèle naturel au modèle artistique à la ménagerie de Versailles
C’est au XVIIe siècle, d’abord dans les Flandres, ensuite en France, lorsque sont appelés à la cour du roi à Versailles des artistes flamands, que se constitue un art animalier, dont la ménagerie de Louis XIV à Versailles fournit les sujets. Versailles est un domaine royal où les animaux sont omniprésents (chasse, ferme, animaux de compagnie, de ménagerie et de parc), auprès d’un roi « collectionneur de beautés animales »[5].Commandée par Louis XIV à Louis le Vau, 1er architecte de Versailles, qui la construit entre 1662 (donc avant même la construction du nouveau château royal) et 1668, au bout du grand canal : des animaux exotiques, rares, curieux habitent ce lieu de représentation. Ménagerie achevée en 1668-69, comme le pendant pacifique du « sérail de bêtes féroces », aménagé dans le parc du Château de Vincennes, et construit par Mazarin dès 1654.
A Versailles, une scénographie originale de panoptique et mise en ordre de la nature, comme pour le jardin, procure une vue d’ensemble sur les enclos des animaux :

Vue et perspective du salon de la ménagerie de Versailles, Pierre Aveline (?), XVIIe s (Paris, BNF)
Une fois passé le château un édifice central octogonal, comportant un rez-de-chaussée aménagé en grotte avec jets d’eau, et au 1er étage un grand salon comportant 7 portes-fenêtres sur balcon continu qui permet de regarder les animaux sans danger, entouré de 7 enclos fermés de grilles de fer, au sol d’herbe ou de sable. (voir Pierre Aveline, Vue et perspective du salon de la ménagerie de Versailles, XVIIe s, Paris, BNF et voir restitution sur le site du château de Versailles). Lieu de divertissement, de splendeur et d’ostentation depuis lequel on peut s’émerveiller de la beauté animale. Ces cours portent le nom des espèces majoritaires dans l’enclos, animaux civilisés et ordonnés : par ex quartier des belles cigognes. Un lieu depuis lequel embrasser tous les animaux d’un seul regard : idée neuve en Europe. La récente exposition Les animaux du roi [6] a montré que la ménagerie de Versailles, conçue à la manière d’une cour, selon le modèle d’un univers pacifié et maîtrisé (« un processus de civilisation »), auquel s’opposent le monde de la Fable, peuplé de sculptures de plomb dans le bosquet du Labyrinthe (représentant des bêtes vicieuses et belliqueuses ex). Des comportements animaux opposés auxquels on prête désormais attention.
Ainsi la ménagerie contribue à l’émergence d’une nouvelle sensibilité, en réaction à l’idée cartésienne de l’animal-machine que l’observation directe des animaux contredit.


A gauche Pieter Boel, Grue à aigrette, huile sur toile, 3e quart XVIIe (Paris Musée du Louvre). A droite : Manufacture des Gobelins, Tapisseries des mois et des Maisons royales (12 pièces), château de Mariemont, mois d’août
Importance du travail sur le vif à proximité des animaux pour capter les attitudes et les caractéristiques. Les beaux oiseaux occupent une place majeure (à l’imitation de la ménagerie de l’archiduc Albert à Bruxelles peinte par Brueghel), par exemple le casoar (arrivé à Versailles en 1664) – Pieter Boel, étude d’un casoar et d’une corneille blanche blanc, ou encore de grands oiseaux aquatiques, Pieter Boel, Grue à aigrette, ennoblie par sa couronne. Boel reconnaissable à ses aplats de couleur ocre-rouge pour montrer les spécificités anatomiques des animaux et les faire ressortir du fond ; possibilité de créer des effets de lumière à l’aide de la couleur. Ces peintres doivent constituer un répertoire de formes et de caractères destinées aux artistes de la manufacture royale des Gobelins. Des cartons pour les Tapisseries des mois et des Maisons royales (12 pièces), château de Mariemont, mois d’août : aigrette, faisan et porc-épic évoluent en liberté au premier plan, au service de la gloire du roi et du plaisir des spectateurs.
Mais l’artiste profite toujours de la nature pour développer un programme artistique original. L’animal est à la fois l’objet et le prétexte de l’art.
L’exemple le plus fameux est le premier peintre du roi, Charles Le Brun, qui fournit les modèles de composition de ces tapisseries et en dirige l’exécution aux Gobelins, poursuit une œuvre plus étonnante encore pour nous, en puisant dans ce corpus d’images animalières disponibles. XVIIe s : est le moment où la physiognomonie (en fait un faux-savoir, reposant sur la croyance en la relation analogique du psychisme et de la physionomie qui a débuté à la Renaissance) entre dans le domaine artistique.



À gauche :Pieter Boel, études d’ours. A droite : Charles le Brun, Huit yeux d’ours, trois têtes d’ours et deux têtes d’hommes leur ressemblant (Paris, Musée du Louvre)
Les études de Tête d’ours de Pieter Boel – des études tout à fait naturalistes — fournissent des modèles d’interprétation des passions humaines reposant sur l’analogie de l’homme et de l’animal, selon le présupposé d’une analogie entre les caractéristiques physiques et psychologiques des individus. L’ours est l’animal déchu auquel on fait une réputation de paresse. L’étrange homme à tête d’ours représente le naturel nonchalant. Et donc on bascule de la représentation naturaliste de l’animal au fantasme – pris très au sérieux — d’un être hybride, mi-homme mi-animal, type de la paresse.
Mais la ménagerie de Versailles n’intéresse plus après la mort de Louis XIV : elle a produit tous ses effets politiques et artistiques. Et la Révolution finit par chasser les derniers « animaux » occupant le palais : un satiriste traduit la chute de la monarchie en animalisant les corps royaux et signe sa désacralisation par l’analogie zoologique : Les animaux rares ou la translation de la ménagerie royale au Temple (vers 1792,gravure à l’eau-forte et aquatinte, Paris, Musée Carnavalet[7]) qui suffit à dire la bestialité de Louis XVI en dindon gras -un animal castré- la voracité de Marie-Antoinette en louve et les enfants en louveteaux.

Les animaux rares, La translation de la ménagerie royale au Temple, vers 1792, gravure à l’eau-forte et aquatinte (Paris, Musée Carnavalet )
Conclusion
Pour conclure en revenant à nos deux artistes rugissant Barye et Delacroix, ils partagent tous deux l’attrait pour la représentation de la cruauté et de la violence. En fait, l’animal identifié à cette férocité est le prétexte pour traduire l’animalité humaine et projeter sur l’animal la violence et les passions humaines.
Barye qu’on surnomme le « Michel-Ange de la ménagerie » est accusé par les membres de l’Institut après son triomphe de 1833 avec un plâtre représentant la lutte entre un lion et un serpent d’avoir pris « le jardin des Tuileries pour une ménagerie ».
Dans cette histoire de l’art au prisme des ménageries, deux dimensions pour nous frappent par leur absence. D’une part la dissimulation de l’encagement de l’animal qui constitue la réalité de la ménagerie. D’autre part l’absence d’inversion des points de vue où l’animal regarde l’homme et l’artiste qui l’observent, ou alors seulement, du moins au XVIII et au XIXe siècles, à travers les arts mineurs.


A gauche : Honoré Daumier, O qu’ils sont laids, Les orangs-outans, 1836, lithographie colorée à la main A droite : Jean-Jacques Grandville, vignette, pour Scènes de la vie privée et publique des animaux, étude de mœurs contemporaines, 1840-1842, avec la collaboration d’écrivains (dont Balzac).
En revanche, c’est la considération éthique qui prendra le pas dans l’art contemporain pour interroger la recentrer autrement l’art sur l’animal.


A gauche : Otto Dill, Tiger im Käfig, v. 1928, Munich. A droite : Gilles Aillaud, Lions en cage, 1972.
[1] Cité notamment par Thierry Laugée, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01075675/document
E. Delacroix, Lettre à Antoine-Louis Barye, Correspondance générale, I, p. 225. Th. Laugée souligne qu’on ne connaît aucun dessin de l’un ou de l’autre artiste qui renvoie à ce lion en particulier. La lettre célèbre est conservée dans le fonds d’archives Barye, récemment acquises par l’INHA. Une autre datation de ce billet pourrait être 1829 ou 1837, moment ou d’autres lions, dessinés par Delacroix, sont morts à la ménagerie.
[2] « Mais d’après quel plâtre Puget a-t-il sculpté le lion dévorant qui déchire les muscles de Milon de Crotone ? Artistes, poètes, écrivains, si vous copiez toujours, on ne vous copiera jamais. Voulez-vous être originaux, et fixer l’admiration de la postérité sur vos ouvrages ? N’en cherchez les modèles que dans la nature. »
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96690778/f22.item.texteImage
Bernardin de Saint Pierre, Mémoire sur la nécessité de joindre une ménagerie au Jardin National des Plantes de Paris, p. 14
[3] Les animaux y sont assez immobiles pour être dessinés puisque ce sont des animaux tenus enfermés dans un espace exigu. On ouvre d’abord une ménagerie provisoire de 58 animaux (mammifères et oiseaux[3]), puis on la transforme en ménagerie pérenne en 1804.
[4] Daniel Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture, Paris, Champs-Flammarion, p. 129.
[5] Catal. Les animaux du roi, dir. N. Milovanovic et A.Maral , p. 13.
[6] Château de Versailles, oct 2021- février 2022- commissariat N. Milovanovic et A.Maral.
[7] Citée dans Hommeanimal, Laurent Baridon, Martial Guédron, « L’homme au miroir de l’animal », p. 26, catalogue d’exposition, Musées de Strasbourg, Adam Biro, 2004
Les objet sont-ils objectifs ? Sever Martinot-Lagarde. 5-12-22
Introduction
Avant d’en venir au sujet de cette conférence, c’est-à-dire le rôles des objets dans la dramaturgie, je ferai un petit détour par la philosophie médiévale et la question du langage. Au début du XIVe s, le philosophe franciscain Guillaume d’Ockham soutient la thèse, que nous appelons « nominaliste », selon laquelle les concepts abstraits universaux, tels que « humanité », « beauté », « justice » ne sont que des termes conventionnels qui ne renvoient à aucune entité réelle. Si « mourir » est un événement bien attesté dans la vie humaine, « la mort », en soi, n’existe pas. Ce n’est qu’un mot. Autrement dit, le langage, en formant des noms pour désigner des idées abstraites, nous trompe en nous faisant imaginer des êtres purement illusoires. Parler de la mort nous conduit à nous représenter une chose terrifiante, qui prend par exemple la forme d’un squelette malveillant, armé d’une grande faux. Le langage donc nous trompe et nous fait croire en des chimères. Le langage est source d’illusion. D’une certaine manière les mots sont comme des billets de banques dont la valeur, théoriquement, devrait renvoyer à une somme équivalente en lingots d’or conservée dans les coffre de la banque centrale. Or, de même qu’il est très facile de faire tourner la planche à billets et de produire des bouts de papier qui ne renvoient à aucune espèce sonnante et trébuchante. Le langage produit également une inflation de mots, qui peuvent être détachés de toute référant réel. Certains mots donc, sont de la fausse monnaie.
Pour élargir cette question de la validité du langage, on voit bien que le problème est qu’il permet de dire ce qui n’est pas comme si cela était, de faire exister dans notre esprit des choses qui n’existent pas dans la réalité. Pour le dire plus simplement, le langage peut-être la source de deux formes d’illusion: l’erreur, si l’illusion est involontaire ; ou le mensonge, si l’illusion est créée intentionnellement.
Au XVIIIe s, un savant imaginaire, rencontré par Gulliver lors de sa visite de l’Académie de Lagado , propose une solution radicale pour remédier à ce problème : il suffit de supprimer le langage et de s’exprimer en montrant les choses elles-mêmes que l’on sortirait de sa proche ou d’un grand sac à dos :
« L’autre allait plus loin, et proposait une manière d’abolir tous les mots, en sorte qu’on raisonnerait sans parler ; ce qui serait très-favorable à la poitrine, parce qu’il est clair qu’à force de parler les poumons s’usent et la santé s’altère. L’expédient qu’il trouvait était de porter sur soi toutes les choses dont on voudrait s’entretenir. Ce nouveau système, dit-on, aurait été suivi, si les femmes ne s’y fussent opposées. Plusieurs esprits supérieurs de cette académie ne laissaient pas néanmoins de se conformer à cette manière d’exprimer les choses par les choses mêmes, ce qui n’était embarrassant pour eux /, que lorsqu’ils avaient à parler de plusieurs sujets différents ; alors il fallait apporter sur leur dos des fardeaux énormes, à moins qu’ils n’eussent un ou deux valets bien forts pour s’épargner cette peine : ils prétendaient que, si ce système avait lieu, toutes les nations pourraient facilement s’entendre (ce qui serait d’une grande commodité), et qu’on ne perdrait plus le temps à apprendre des langues étrangères. » (Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver, « Voyage à Laputa, aux Balnibarbes etc. », chapitre V, visite de l’Académie de Lagado)
Certes la méthode est un peu encombrante, car il est peu commode de sortir une baleine de sa poche pour parler de baleine mais elle a l’avantage de supprimer l’erreur et le mensonge. « Les choses ne mentent pas » pourrait-on dire, en pastichant Philippe Pétain.
Il se trouve que cette question du rapport entre les mots et les choses est au cœur de la théâtralité, puisque le théâtre, comme chacun sait, met en scène des mots, mais aussi des acteurs en chair et en os qui évoluent sur la scène en manipulant des objets. Comment donc le théâtre pense-t-il le rapport des mots et des choses ?
I- L’illusion des mots, le poids des objets
Il semble d’abord que le théâtre a toujours donné raison, par avance, aux académiciens de Lagado. Le théâtre n’a eu de cesse de démontrer la facticité des mots : comme le dit Hamlet : « Words, words, words ». Dans La Nuit des Rois (acte III, sc 1) de Shakespeare, le bouffon Feste déclare qu’il n’est pas le fou de Lady Olivia, mais son « corrupteur de mots » car dit-il « une phrase n’est qu’un gant de chevreau pour un esprit agile », un gant que l’on peut retourner sens dessus dessous. Dans L’Illusion comique de Corneille (II, 3), Isabelle réplique à un amoureux éconduit qui la pourchasse de ses serments d’amours plaintifs et de s es reproches :
« Nous donnons bien souvent de divers noms aux choses,
Des épines pour moi vous les nommez des roses,
Ce que vous appelez service, affection
Je l’appelle supplice et persécution. »
Si au départ ces vers d’Isabelle ne semblent désigner que la diversité des points de vue, très vite, Adraste, s’entêtant à déclarer qu’Isabelle ne peut qu’être flattée de ses avances, corrompt sciemment le langage en lui faisant dire le contraire de la vérité : il nomme volontairement « roses » ce qu’il sait n’être qu’« épines ».
Le théâtre souvent illustre cette tromperie des mots. L’erreur peut être involontaire, comme dans le cas du quiproquo où un même mot est compris de façon radicalement différente par les personnages qui croient pourtant parler de la même chose. Le procédé est connu, mais je ne résiste pas à l’envie vous montrer un passage célèbre de L’Ecole des femmes, où vous reconnaîtrez une célèbre actrice à ses débuts : Isabelle Adjani face à Bernard Blier dans L’Ecole des femmes, film de Raymond Rouleau, https://www.cyrano.education/content/lecole-des-femmes-42994, de 31.43 à 32.26.
Les mots sont aussi le véhicule du mensonge le plus élémentaire : dans l’Electre de Sophocle, le Pédagogue trompe Clytemnestre et tout le palais de Mycènes en racontant la mort d’Oreste, avec beaucoup de détails réalistes qui donnent l’apparence de la vérité à son récit, alors que tout y est faux.
Le cas du langage à double entente illustre de façon plus subtile la corruption des mots : toujours dans Electre, lors de la scène finale, le cadavre de Clytemnestre assassinée est exposé devant tous, mais voilé. Egisthe s’approche du corps qu’il croit être celui d’Oreste et il interroge brutalement Electre. Celle-si répond alors à l’amant de sa mère de façon apparemment soumise mais ironiquement tragique, puisqu’elle lui annonce à mots couverts qu’il va bientôt être assassiné à son tour. Projection d’Electre, mise en scène d’Antoine Vitez, réalisation Hugo Santiago, 1986, DVD Trois fois Electre, La Maison d’à côté, Imec, INA Editions, de 1.33.21 à 1.33.41 :
Egisthe : Qui de vous sait où se trouvent ces étrangers de Phocide qui sont venus annoncer qu’Oreste est mort dans un accident de char ? Réponds-moi. Oui, toi qui faisais l’effrontée autrefois. J’imagine que la chose t’intéresse, que tu sais cela.
Electre : Oui, je sais tout. Comment faire autrement ? C’est ce que j’ai de plus cher au monde.
Egisthe : Eh bien où sont-ils ces étrangers, enseigne-moi ?
Electre : Dans la maison, ils ont été reçus en amis.
Egisthe : Ils ont vraiment annoncé la mort d’Oreste ?
Electre : Non, ils l’ont prouvée, autrement que par des mots.
Egisthe : Alors je peux en être sûr ?
Electre : Tu peux même voir, mais c’est un pénible spectacle.
(Sophocle, Electre, exodos, traduction d’Antoine Vitez)
De façon plus perverse encore, Iago trompe Othello en ne lui disant que la plus stricte vérité :
« Oh prenez garde monseigneur, à la jalousie ! C’est le monstre aux yeux verts qui produit l’aliment dont il se nourrit ! Ce cocu vit en joie qui, certain de son sort, n’aime pas celle qui le trompe ; mais, oh ! Quelles damnées minutes il compte, celui qui raffole, mais doute, celui qui soupçonne, mais aime éperdument ! » (traduction François-Victor Hugo)
C’est en effet en lui peignant les effets néfastes et bien réels de la jalousie que Iago distille dans l’esprit d’Othello l’idée que Desdémone pourrait lui être infidèle. Il le rend jaloux en le mettant en garde contre la jalousie !
On voit donc bien que le langage est source d’illusion, qu’il s’agisse d’erreur involontaire ou de tromperie caractérisée. Le langage au théâtre se trouve donc souvent décrédibilisé. Ainsi, dans la comédie de Corneille, Le Menteur, le héros est un mythomane qui s’enferre tellement dans ses mensonges, qu’à la fin plus personne ne veut le croire, même quand il dit la vérité.
La solution passera donc par les objets, dont la matérialité apporte une preuve concrète et un témoignage irréfutable de la vérité. Ainsi dans la scène de reconnaissance, théorisée par Aristote, il faut le plus souvent recourir à un objet pour mettre fin à l’illusion. Dans Electre, toujours, lorsqu’Oreste révèle sa vraie identité à sa sœur, il doit exhiber sous ses yeux le sceau d’Agamemnon pour qu’elle accepte enfin de le croire : « Regarde cette bague de notre père, et tu sauras si je dis vrai ». C’est la première d’une longue série d’interjections (« oh ! mais c’est la croix de ma mère ! ») qui permettront de mettre fin commodément aux intrigues les plus complexes, des comédies de Molière jusqu’aux meilleurs mélodrames du XIXe s. « Hélas ! À voir ce bracelet, c’est ma fille que je perdis à l’âge que vous dites », s’écrie Argante reconnaissant Zerbinette pour sa fille à la fin des Fourberies de Scapin.
II- Les objets nous trompent
Pourtant les objets eux-aussi peuvent être trompeurs. Tout comme les mots, les objets sont d’abord source d’erreur involontaire et de quiproquo : dans la tragique histoire de Pyrame et Thisbé, que Shakespeare met en scène de façon parodique dans Le Songe d’une nuit d’été, les deux amants séparés par l’hostilité de leurs familles s’enfuient de chez eux et se donnent rendez-vous dans une clairière. Thisbé arrive en premier, mais se retrouve nez à nez avec un lion. Dans sa fuite elle laisse tomber son écharpe que le lion déchiquette à belles dents avant de quitter la place. A son arrivée, Pyrame trouve l’écharpe déchirée. Il imagine aussitôt Thisbé morte et il se suicide. Lorsque Thisbé revient sur ses pas, il ne lui reste plus qu’à se se suicider à son tour. Dans Roméo et Juliette, l’écharpe est remplacée par un somnifère qui donne à Juliette l’apparence de la mort, et par une lettre qui devait prévenir Roméo et qui arrive trop tard.
Les objets peuvent aussi mentir sciemment ou être manipulés : c’est ainsi que le Pédagogue et Oreste, dans Electre, appuient le récit mensonger de la mort d’Oreste en produisant une urne funéraire censée contenir les cendres du fils d’Agamemnon. De même Iago apporte à Othello la preuve ultime, mais trompeuse, de l’infidélité de Desdémone, en dérobant à cette dernière un mouchoir qui se retrouve comme par hasard entre les mains de Cassio. Bref, si Electre avait été baroque, elle se serait méfiée du sceau d’Agamemnon brandi par Oreste : si une urne pouvait lui mentir, pourquoi une bague serait-elle moins douteuse ?
Les objets ne mentent pas, disions-nous ? C’est donc une illusion dont nous devons nous débarrasser. Leur matérialité est trompeuse, et leur prétendue objectivité dissimule mal le fait que les objets sont profondément subjectifs.
III Les objets sont subjectifs
Dans une conférence intitulée « Sémantique de l’objet » (1964), Roland Barthes explique qu’ « il y a toujours un sens qui déborde l’usage de l’objet ». En effet la signification d’une Rolex ne se limite pas à son usage qui est de donner l’heure. La Rolex est surtout un signe qui sert à transmettre un message : c’est un moyen pour son possesseur d’affirmer sa richesse et sa réussite sociale. De même au théâtre, il y a toujours de l’humain qui déborde de l’objet.
Les objets au théâtre caractérisent leur possesseur, mieux qu’une longue description romanesque ne pourrait le faire. Ainsi dans Mademoiselle Julie de Strindberg, le fait que le valet Jean ne boive que du vin de Bourgogne, nous renseigne sur ses prétentions à l’élévation sociale, tandis que le fait que l’aristocrate Julie déclare préférer la bière, nous renseigne sur son désir de « faire peuple » et sa fascination trouble pour la déchéance sociale. Plus spectaculaire encore, au dénouement de la pièce, Jean prévoit de s’enfuir en enlevant Julie, avec qui il a couché ; mais il suffit d’un coup de sonnette et de la vue des bottes de Monsieur, le père de Julie, pour que le valet soit renvoyé à sa condition d’esclave et se retrouve soudain paralysé. L’objet métonymique (les bottes) s’est substitué au personnage absent: Monsieur.
On pense ici au tableau de Van Gogh représentant une paire de chaussures. Ces chaussures ont fait couler beaucoup d’encre philosophique depuis Heidegger jusqu’à Derrida, mais toutes ces interprétations pointent le fait que le pathétique soulevé par la peinture vient de ce qu’elles nous font imaginer de la vie du possesseur de ces chaussures, à la fois absent du tableau et omniprésent.
De la même façon dans Les Paravents de Jean Genet, le colon Sir Harold surveille ses ouvriers algériens dans un champ. Toutefois pour continuer à exercer la terreur sur ses ouvriers et s’épargner la peine de les surveiller, il lui suffit de la présence de son gant :
« Habib : Vous partez déjà, Sir Harold ?
Voix de Sir Harold, de la coulisse : Pas tout à fait. Mon gant vous gardera.
Un merveilleux gant de pécari jaune arrive, jeté de la coulisse. Il reste comme suspendu dans l’air, au milieu de la scène.
Quoi de mieux que les bottes du maître ou son gant, symboles de la sa puissance et de sa violence, pour dire l’aliénation de l’esclave.
De même dans Les Bonnes de Jean Genet, Solange et Claire n’ont besoin que des robes de Madame, d’une sonnette et d’un gant de cuisine, pour se livrer avec délice et terreur aux jeux sadomasochistes de la domination et de la soumission, de l’orgueil et de l’humiliation. Il y a toujours de l’humain qui déborde de l’objet, particulièrement parce que les objets sont des surfaces sur lesquels nous projetons nos angoisses :
« Claire : Tu sais ce que je veux dire. Tu sais bien que les objets nous abandonnent.
Solange : Les objets ne s’occupent pas de nous.
Claire : Ils ne font que cela. Ils nous trahissent. Et il faut que nous soyons de bien grands coupables pour qu’ils nous accusent avec un tel acharnement. »
Conclusion qui n’en finit pas
Il semble donc que nous ayons à conclure tragiquement que tout nous trompe, tout nous ment, tout nous angoisse… Les objets ne sont pas plus objectifs, ni plus certains, que les paroles et nous devons adopter la leçon du scepticisme selon laquelle l’homme ne peut probablement pas atteindre la vérité. Il ne nous reste plus qu’à accepter le doute universel, notre incapacité à démêler le vrai du faux, et dire avec Montaigne : « Que sais-je ? », avec Calderón que « la vie est un songe », ou avec Shakespeare que le monde entier n’est qu’une scène de théâtre.
Toutefois, pour terminer sur une petite note d’espoir, ne pourrait-on penser que la vérité peut surgir, même du fond de la tromperie et de l’illusion ?
Dans Les Fausses confidences (1637), Marivaux renouvelle brillamment cette dialectique de l’illusion et de la vérité. Dans cette pièce, le valet Dubois manipule la riche veuve Araminte pour qu’elle tombe amoureuse de Dorante. Dorante, qui était auparavant le maître de Dubois, est un jeune homme de bonne famille ruiné. Il entre au service d’Araminte, dont il est amoureux, en qualité d’intendant pour se rapprocher d’elle. En vérité, Dubois n’a pas grand chose à faire pour qu’Araminte tombe amoureuse de Dorante, car dès le premier coup d’œil, Araminte est charmée par son nouvel intendant. Pourtant les machinations de Dubois sont nécessaires, car Araminte ne peut se permettre d’être amoureuse de son employé. Les conventions sociales de l’époque empêchent une telle transgression des barrières de classe. Il faudra donc beaucoup de ruse à Dubois pour obliger Araminte à cesser de se mentir à elle-même et accepter qu’elle aime Dorante. En digne héritier de Iago, Dubois manipule Araminte en ne lui disant que la vérité. Dès le départ, il lui annonce que son nouvel intendant est amoureux d’elle et il lui rappelle qu’elle se doit de le renvoyer sur le champ. Les « confidences » de la pièce ne sont donc pas « fausses » et trompeuses dans leur contenu, mais dans leurs intentions.
Araminte trouve toujours des prétextes pour garder son bel employé, et il faut donc que Dubois mette en place de subtiles machinations afin de rendre public l’amour de Dorante pour Araminte et forcer Araminte à voir clair en elle-même. C’est en effet le regard que les autres portent sur elle qui lui offre le miroir révélateur dont elle a besoin. Car c’est en se disant que les autres risquent de penser qu’elle est amoureuse, qu’elle prend conscience qu’en effet, elle est amoureuse :
« Araminte à Dorante: Vous donner mon portrait ! Songez que ce serait avouer que je vous aime !
Dorante : Que vous m’aimez, Madame ! Quelle idée ! Qui pourrait se l’imaginer ?
Araminte, d’un ton vif et naif : Et voilà pourtant ce qui m’arrive. »
Pour manipuler Araminte, Dubois a recours à deux objets : un portrait et une lettre prétendument écrite par Dorante et en réalité forgée de toutes pièces. Ces deux objets tombent comme par hasard entre les mains de qui il ne faut pas (des gens indiscrets qui en font grand bruit). Donc apparemment ils sont manipulés maladroitement, mais en réalité ils ont été manipulés avec beaucoup d’adresse puisqu’ils arrivent précisément entre les mains de ceux que visaient Dubois, tout en ayant l’air d’y être arrivé par un malencontreux hasard. Ces objets révèlent donc à toute la maisonnée l’amour de l’intendant pour sa maîtresse et la complaisance de cette dernière, qui se décide enfin à l’épouser.
J’avais commencé cet exposé par une digression philosophique, je conclurai par trois équations mathématiques :
Nous avons vu que dans la tradition théâtrale :
un vrai objet + manipulé de façon maladroite = illusion
(par ex. la lettre de Juliette qui arrive trop tard)
ou un vrai objet + manipulé avec des intentions trompeuses = illusion
(par ex le mouchoir de Desdémone.
Chez Marivaux
un faux objet + manipulé avec des intentions trompeuses = vérité
(c’est la fausse lettre de Dorante)
Donc, du fond même du mensonge et de la subjectivité des objets, peut surgir la vérité la plus objective! Ce qui sépare Marivaux de Shakespeare, c’est bien sûr Descartes, c’est-à-dire la confiance retrouvée dans les pouvoirs de la raison pour nous permettre d’atteindre la vérité, mais aussi l’idée que la certitude doit surgir du fond même du doute systématique et de la prise de conscience de nos illusions.
La physique du sable. 29-11-22. Abdelhak Bakkali.
Sur la Chapelle des Mages du palais de Cosme l’Ancien de Médicis, à Florence. 22.11-22
Sur la Chapelle des Mages du palais de Cosme l’Ancien de Médicis, à Florence.
Philippe Ruiz

Entre 1449 et 1459 (dates communément admises), le peintre Benozzo Gozzoli réalise pour le maître de Florence, Cosimo dei Medici, un programme iconographique peint à fresque sur les murs de la chapelle familiale du palais tout juste sorti de terre.
Nous savons qu’en 1459, très fier du résultat, Cosimo fait les honneurs de sa chapelle toute neuve au jeune Galeazzo Maria Sforza, fils du seigneur de Milan, ainsi qu’au pape Pie II, un Siennois humaniste érudit ; la crème de l‘élite de cette Italie du second XVe siècle.
Le thème de ce décor peint à même les murs : le cortège des Mages venus adorer l’Enfant Jésus, dont la nativité est représentée sur un retable de Filippo Lippi (ou plus certainement une copie). Cette œuvre de Lippi suffirait à faire de la chapelle un endroit exceptionnel, mais on en vient presque à l’oublier tant l’oeil est attiré par le chatoiement des étoffes précieuses, l’abondance des personnages, le pittoresque des animaux, des végétaux, des paysages, en une explosion de couleurs contenues dans des formes délicates.
Le style de Gozzoli n’est pourtant pas spécialement novateur (on parle à son sujet de « gothique international », ce qui devrait le faire disparaître derrière la force d’innovation, la douce sensualité, la maîtrise de l’espace de Lippi).
Et il n’en demeure pas moins que son Cortège des Mages happe le regard, fascine, ravit les millions de visiteurs qui passent par ce tout petit oratoire et qui mettent bien tout le reste du parcours dans le palais à encaisser cette overdose de couleurs, de beau seigneurs chamarrés, d’animaux rares et magnifiques, d’expressions énigmatiques.
On perçoit confusément qu’il y a tant à comprendre dans ces quelques mètres carrés, qu’on a forcément « manqué » quelque chose. L’invitation à aller plus ultra, comme l’Ulysse de Dante, est évidente, encore faut-il savoir quel chemin emprunter.
Essayons d’en éclairer quelques jalons.
Gozzoli accomplit tout d’abord une narration picturale facilement accessible à tout Occidental du XVe siècle. L’épisode de l’adoration des Mages, au début des évangiles synoptiques, est très connu de tous les fidèles, les moins dégrossis compris. Et il n’y a rien d’extraordinaire dans l’iconographie retenue par le peintre : les mages sont de grands seigneurs, des « rois », leur cortège est surabondant, les présents sont somptueux, les animaux souvent exotiques. Entre les affres de la recherche d’un coin d’étable où accoucher et l’horreur de la fuite en Egypte et du massacre des Innocents, un moment de rêve. Gozzoli y ajoute, un peu cuistre, quelques grands classiques de cette peinture gothique de la fin du moyen-âge : trois Mages pour représenter les trois âges de la vie, une nature qui illustre les quatre saisons, une faune qui vient des trois parties du monde (Europe, Asie, Afrique). Cela, tout un chacun peut le percevoir avec la culture commune des Occidentaux de ce temps. C’est déjà un peu dense, mais tout le monde suit.
Il faut être un Florentin du Quattrocento pour saisir un autre niveau de narration. En 1439, une récurrence de la peste oblige les évêques italiens, les légats du Pape et les membres de la délégation byzantine, parmi lesquels l’empereur lui-même et le patriarche de Constantinople, à quitter Ferrare, dans la plaine du Pô. Ce concile avait pour but de refaire l’union entre Grecs et Latins devant la menace d’une imminente conquête de la seconde Rome par les Turcs ottomans. Le pape parvient à négocier la promesse d’une croisade de secours contre la réunification des Eglises.
Fuyant Ferrare, les pères conciliaires acceptent l’hospitalité que Cosimo, maître de la ville depuis 1434, s’est empressé de leur offrir. C’est pour lui une heure de gloire, la consécration de sa réussite personnelle comme la validation de ses talents de diplomate. Il rend un énorme service au pape (dont il est aussi le banquier…), à la chrétienté, à l’humanité. Ce concile est un moment important de notre histoire culturelle, mettant en contact rapproché et durable intellectuels grecs et humanistes italiens ; mais quant à son objet initial, c’est un échec. Les Constantinopolitains n’acceptent pas la tutelle romaine induite par les canons du concile ; Le sac de leur ville par les Vénitiens en 1204 ne passe toujours pas… Ce que Cosimo veut retenir de l’évènement, c’est le luxe du cortège, le déploiement de faste déployé par l’ambassade byzantine (inversement proportionnel aux réels moyens de ces Byzantins au bord de l’abîme). Et c’est bien cela que rend Gozzoli : le Basileus Jean (l’homme mûr sur un étalon noir), le patriarche Joseph (le vieillard sur une mûle) et leur suite. Un moment de l’histoire récente de Florence, qui se superpose à l’Histoire Sainte originelle. L’orgueil urbain des Florentins s’en trouve grandement flatté.
Reste que le dernier Mage ne colle pas vraiment avec la composition de l’ambassade grecque. Les Florentins qui fréquentent quelque peu le cercle du pouvoir médicéen sont, eux, capables de dire qui est ce beau jeune homme. Cosimo a deux petits-fils, Laurent (futur maître de la ville, poète licencieux, mécène fastueux) et Julien, assassiné quelques années plus tard lors de la conjuration des Pazzi. Julien est aussi beau et blond que Laurent est brun et laid. Et s’il est à la place du dernier mage, c’est parce qu’il permet à Gozzoli de superposer un troisième récit aux deux premiers. Les choses se compliquent quelque peu.
Derrière le dernier Mage, un peu jeune pour l’histoire, se trouve une foule de personnages, massés en une cavalcade compacte, sur au moins quatre rangs. Et les Florentins de l’élite (ou les membres de la famille, laquais et soubrettes compris) mettent facilement un nom sur tous ces visages. Cosimo lui-même, sur un âne roussin, et dont la position des mains constitue une manière de coming out. A cette époque, la profession de banquier n’a pas bonne réputation, et l’argent salit ceux qui le manipulent. Il est très délicat de montrer trop ostensiblement sa richesse, sauf à être de sang royal ou princier. Et cette mesure dans l’expression de la réussite se retrouve jusque dans l’austère majesté du palais que Cosimo fait édifier par Michelozzo di Bartolomeo. Majestueux mais sobre ; la puissance sans le luxe. C’est le code des parvenus de ce temps : pas de bling bling.
Dans la chapelle en revanche on peut se lâcher ; c’est, avec le studiolo du maître, le lieu le plus intime du palais. Le cercle de famille y a sa place, on est entre soi. C’est ici que Cosimo peut se faire représenter comme un manieur d’argent : en train de compter… avec ses doigts. C’est obscène, mais c’est la réalité que connaissent tous les Medici.
Et c’est aussi dans la foule des familiers qui se presse derrière lui qu’on aperçoit un visage juvénile, au regard pourtant acéré, et qui accroche l’oeil du visiteur. Gozzoli signe deux fois son œuvre ; par l’auto-portrait de trois-quart, tourné vers l’extérieur, auquel vont nous habituer nombre de peintres de l’âge moderne (mais ici c’est peut-être une première). Et par ce flamboyant bonnet écarlate, à la base duquel, pour que tous comprennent, il a écrit ; OPUS BENOTII (c’est Benozzo qui l’a fait). Le lien entre le commanditaire de l’oeuvre et l’artiste est très explicitement mis en scène. On connaît des peintures religieuses où celui qui paie le tableau se fait représenter en prière aux pieds de la Vierge ou de la Croix. L’inclusion de toute la famille Medici dans le cortège, ainsi que la représentation du lien entre l’artiste et son mécène, cela est en revanche très nouveau. Et dit beaucoup d’une relation qui devient classique et décisive dans la production artistique de la Renaissance européenne.
Chiara Frugoni, qui par un hasard presque miraculeux avait accompagné le groupe de mes étudiants lors de ma première visite à la Chapelle des Mages nous avait dit avant de nous faire entrer : « il faut voir ces fresques avec l’oeil d’un enfant, et les comprendre avec la tête d’un Machiavel. »
Bibliographie :
– Richard Turner, La Renaissance à Florence, Flammarion, Paris, 1997.
– Cristina Acidini Luchinat (dir.), Benozzo Gozzoli. La Capella dei Magi, Electa, Milano, 1993.
La bêtise, son territoire, ses ruses, son génie. Maryse Palévody. 16-11-22
La bêtise, son territoire, ses ruses, son génie.
Maryse Palévody
Qu’est-ce que la bêtise ? ou plutôt, comme se le demande Robert Musil : « Qu’est-ce au juste que la bêtise ? » (Robert Musil, conférence à Vienne en mars 1937, De la bêtise). Car on sait reconnaître la bêtise, à coup sûr, mais peut-on au juste la définir ?
Michel Audiard dans La Grande Sauterelle de Georges Lautner, 1967, n’y va pas par quatre chemins :
« C’que tu peux être con. T’es même pas con t’es bête. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Si ça se trouve t’as même pas de cerveau, et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents… »
Le Grand Robert, lui, parle de défaut d’intelligence et de jugement ; d’action ou de parole sotte ou maladroite ; d’absence de mobilité d’esprit. Les contraires sont, sans surprise, l’intelligence, l’esprit, la finesse, le bon sens ; mais aussi l’adaptation, la curiosité, la tolérance.
Le Littré nous dit que le mot « bêtise » est récent ; autrefois (XVe-XVIe s.), on disait besterie.
Être bête, c’est donc faire la bête, comme en témoignent certaines expressions (« bête à manger du foin ») ; l’âne, l’oie, arrivant en tête du bestiaire de la bêtise. Dès le moyen-âge, le mot bête s’applique métaphoriquement à l’homme pour évoquer son caractère instinctif, irrationnel, dominé par la physiologie. Montaigne, Pascal par exemple, opposent deux attitudes, toutes deux dangereuses, « faire l’ange » ou « faire la bête ». La « bête humaine » qui désigne le personnage de Jacques Lantier, assassin compulsif, dans le roman éponyme de Zola, dit assez la dérivation sémantique du mot « bête » vers la cruauté, l’acharnement, la voracité.
Ces acceptions affleurent donc dans le mot bêtise, qui ne peut être limité à un sens bon enfant, notamment quand il est employé au pluriel : faire ou dire des bêtises. Cette bêtise accidentelle et vénielle ne nous intéressera pas ici, ni même un emploi condescendant ou euphémistique du terme :
“… faisons cette bêtise,
L’amour, et livrons-nous naïvement à Dieu.”
HUGO, La Légende des siècles, t. 4, 1877, p. 846.
Non, bien plus fascinante est la bêtise crasse, consubstantielle à l’individu, et lorsqu’elle persévère dans son être. Cf. Le Guignolo de Georges Lautner, 1980, dialogue J. Audiard :
« – Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ?
– Non.
– Un voleur, de temps en temps, ça se repose. »
Entendons-nous bien, analyser les fondements et les manifestations éclatantes de la bêtise est faussement un projet réjouissant, comme si l’exposé avait une vertu prophylactique : analyser la bêtise, serait la considérer à bonne distance, et s’en immuniser, une sorte de « geste barrière » de l’intelligence satisfaite. Parler de la bêtise dans ce temple de l’intelligence, en connivence avec son auditoire, c’est prendre le risque de la regarder de haut, dans une pernicieuse stratégie du décalage, et manquer son but par orgueil. La bêtise est d’évidence, comme le bon sens chez Descartes, « la chose du monde la mieux partagée. » Il convient donc de ne se situer ni au-dessus ni à côté de son sujet.
Bêtes à pleurer
Dans les Fables de La Fontaine, certains animaux ou certains hommes, bêtes comme leurs pieds, commettent d’irréparables boulettes faute d’avoir la tête bien faite : tel ours pour chasser une mouche sur le nez d’un jardinier s’arme d’un pavé et lui fracasse la tête, tel paysan éventre la poule qui lui donne chaque jour un œuf en or, tel volatile sur un arbre perché, pour son péché mignon de flatteries, laisse choir son alléchant fromage. L’avarice, la vanité, et tous les autres péchés capitaux sont solubles dans la bêtise qui sanctionne l’universelle dupe qui n’a plus que ses yeux pour pleurer.
Aux XVIIe et XVIIIe s. le péché capital est la bêtise sociale de celui qui se donne en ridicule en société. Molière nous en a donné un fameux exemple avec le personnage du « trois fois sot » Trissotin dans Les Femmes savantes. Typiquement ce lourdaud n’a pas d’intelligence sociale, il est le contraire du bel esprit de salon. Plus tard, Rousseau dit de lui-même qu’il est « bête » en société, parce qu’il ne sait pas quoi dire.
Flaubert dans l’un de ses Trois contes, Un cœur simple, invente le personnage de la servante Félicité qui est sotte, crédule, mais sa simplicité est sans malice. Sa bêtise est passive, elle pourrait progresser : lorsqu’elle cherche la maison où habite son neveu Victor à Cuba, elle est déçue de ne pas la voir sur les cartes que lui montre un avocat :
« Il avait un beau sourire de cuistre devant l’ahurissement de Félicité […] Une candeur pareille excitait sa joie. »
Mais il suffirait qu’il lui explique. Sa bêtise à elle est pardonnable et amendable ; elle est simple mais récupérable ! C’est le savant ici qui est bête et méchant, on y reviendra…
Flaubert a de la sympathie pour la pauvre Félicité, et pour cause. Sartre dans la somme qu’il consacre à Flaubert, L’Idiot de la famille, relate une anecdote familiale touchant le jeune Gustave :
« Ma grand-mère [c’est la nièce de Flaubert qui parle] m’a raconté qu’il restait de longues heures un doigt dans sa bouche, absorbé, l’air presque bête. »
Il paraît même qu’un vieux domestique le faisait tourner chèvre en lui disant : « va voir… À la cuisine si j’y suis. »
On peut avoir de l’indulgence par rapport à cette forme de bêtise qui ne pense pas à mal, qui peut néanmoins devenir nuisible, parce qu’elle est influençable. En revanche, la bêtise est irrécupérable et impardonnable quand elle s’obstine.
« La bêtise est quelque chose d’inébranlable […] Elle est de la nature du granit, dure et résistante » (Flaubert, Correspondance)
Typiquement, Molière présente des personnages dont l’obstination, le comportement répétitif, les tics gestuels et linguistiques, nous les font apparaître bêtes (ex. Harpagon : « Hélas ! Mon pauvre argent ! »). Leur persévérance, dans l’erreur et l’aveuglement, est comique, parce que nous y voyons leur incapacité d’adaptation. La force d’inertie qui se dégage de leur fonctionnement mécanique est d’ailleurs pour Bergson (Le Rire) l’un des ressorts essentiels du rire, avec la célèbre formule : « de la mécanique plaquée sur du vivant ».
La bêtise est butée, figée dans ses certitudes, son conservatisme ; elle est douée d’une puissance d’enlisement qui ne laisse pas de possibilité de l’ébranler, de la retourner. Le problème avec la bêtise n’est pas tant les erreurs qu’elle véhicule, mais le fait que l’imbécile est tout à fait assuré des inepties qu’il profère. Flaubert propose, entre autres, dans son Dictionnaire des idées reçues, la définition suivante :
« Bossus. Ont beaucoup d’esprit. — Sont très recherchés des femmes lascives. »
Ce n’est pas tant la fausseté de cet énoncé qu’il faut réfuter (pourquoi d’ailleurs les bossus n’auraient-ils pas effectivement beaucoup d’esprit ? quant à la deuxième proposition, je n’ai pas d’avis…), mais bien plutôt ce qui en fait une idée reçue et non discutée, son évidence convenue. Le contraire de la bêtise n’est pas l’intelligence (c’est tout de même mieux s’il y en a), mais le doute, la prudence de la pensée. Montaigne dans ses Essais, III, 8, « De l’art de conférer » disait bien :
« L’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise. »
Ou encore le grand Barthes (dont seule la mort fut bête), colloque de Cerisy, 1977 :
« La bêtise n’est pas liée à l’erreur. Toujours triomphante (impossible à vaincre), son triomphe relève d’une force énigmatique : c’est l’être-là tout nu, dans sa splendeur. D’où une terreur et une fascination, celle du cadavre […]. Donc elle est là, obtuse comme la Mort. »
Dans cet éthos du crétin ou de l’idiote satisfaits, contents de soi, se glisse le stéréotype du bourgeois, modèle inépuisable de la bêtise en littérature. Flaubert n’a de cesse de stigmatiser cette boursouflure de la bêtise humaine, qu’il remarque notamment comme un effet indésirable du tourisme de masse naissant en Egypte, comme ici ce rituel idiot qui consiste à laisser sa marque sur les monuments :
« A Alexandrie, un certain Thomson, de Sunderland, a sur la colonne de Pompée écrit son nom en lettres de six pieds de haut. Cela se lit à un quart de lieu de distance. Il n’y a pas moyen de voir la colonne sans voir le nom de Thomson, et par conséquent sans penser à Thomson. Ce crétin s’est incorporé au monument et se perpétue avec lui.
Tous les imbéciles sont plus ou moins des Thomson de Sunderland. […] ils sont si nombreux, ils reviennent si souvent, ils ont si bonne santé ! En voyage on en rencontre beaucoup. » (Correspondance)
Ces bourgeois en voyage représentent la bêtise collective, qui devient alors une classe émergeante. Flaubert a la hantise de ce qu’il appelle « l’infinie stupidité des masses ». Cette bêtise-là sous ses dehors inoffensifs, est une force agissante et sourde, qui recèle un gouffre de brutalité passive.
Une autre forme de bêtise est plus sûre d’elle, triomphante, redoutable parce qu’elle sait s’adapter, sonder le milieu ambiant et en tirer profit.
Bêtes et méchants
On se souvient du film Dupont-Lajoie d’Y. Boisset (1974) qui s’attaque, sur fond de racisme, à la bêtise ordinaire d’honnêtes citoyens prêts à accuser des ouvriers maghrébins du meurtre le plus ignoble. Terrible est cette bêtise qui s’attaque au plus faible, parfaitement nuisible quand elle est consensuelle et se croit subversive, sur l’air de : « on ne nous la fait pas » et « on ne nous dit pas tout ».
Terrible est aussi la bêtise sous l’enveloppe respectable de l’intelligence. Le pharmacien Homais dans Madame Bovary, a la bêtise de celui qui s’en croit à l’abri, son intelligence le rend bête dans son désir forcené d’ascension sociale, sa pédanterie de petit bourgeois qui a des prétentions scientifiques et politiques. Pourtant l’excellence d’Homais affichée en lettres d’or sur son officine, le ramène à une humanité moyenne, celle du type ordinaire qui ne supporte pas la solitude et ne peut que s’agréger à autrui pour y trouver le reflet espéré de sa supériorité. On ne peut être bête tout seul.
L’ironie de l’histoire
Se sentir intelligent, c’est adopter une posture aristocratique ostracisant le crétin. Pour les organisateurs du dîner de cons dans le film éponyme de Francis Veber, en 1998, offrir à la risée publique un beau spécimen d’imbécile, est le plus sûr moyen de paraître spirituel.
« Y’a pas de mal à se moquer des abrutis. Ils sont là pour ça, non ? » (personnage de Pierre Brochant, éditeur)
Mais à force de bourdes à répétition du nigaud de service, joué par J. Villeret, on perçoit la signification réversible du bêtisier. Finalement la bêtise de l’autre s’annule dans le jugement discriminant porté sur lui : stigmatiser la bêtise d’autrui, c’est se considérer prémuni, ce qui est un manque caractérisé de jugement et de prudence. Ainsi, on est toujours la bête de quelqu’un, le jugement sur la bêtise se neutralise dans l’indifférenciation.
Notre lieu commun
Parler de la bêtise, c’est l’illusion du discours sur l’autre. En cherchant l’autre, on ne trouve que son alter ego : « Madame Bovary, c’est moi ! » Mais Charles Bovary, Homais, c’est sans doute un peu moi aussi. En identifiant la bêtise ordinaire, en analysant ses ressorts, je me retrouve, et regarde l’autre comme dans un miroir. La bêtise est notre lieu commun, dont la première manifestation et la preuve évidente de son universalité, est de croire qu’on y échappe. Elle a son discours, la doxa, les idées reçues, c’est-à-dire le discours qui compense le manque de discours, c’est dire quand on n’a rien à dire, et fournir à l’échange social.
Nathalie Sarraute à travers ce qu’elle appelle les « tropismes » met en évidence toutes les conventions sociales, les stéréotypes par lesquels nous sommes traversés, et qui bloquent l’intelligence de situation. Tropismes, X :
« Elles allaient dans des thés. Elles restaient là, assises pendant des heures, pendant que des après-midi entières s’écoulaient. Elles parlaient : ‘’Il y a entre eux des scènes lamentables, des disputes à propos de rien. Je dois dire que c’est lui que je plains dans tout cela quand même. Combien ? Mais au moins deux millions. Et rien que l’héritage de la tante Joséphine… Non… comment voulez-vous ? Il ne l’épousera pas. C’est une femme d’intérieur qu’il lui faut, il ne s’en rend pas compte lui-même. […]’’ On le leur avait toujours dit. Cela, elles l’avaient bien toujours entendu dire, elles le savaient : les sentiments, l’amour, la vie, c’était là leur domaine. Il leur appartenait.
Et elles parlaient, parlaient toujours répétant les mêmes choses, les retournant, puis les retournant encore, d’un côté puis de l’autre, les pétrissant, roulant sans cesse entre leurs doigts cette matière ingrate et pauvre qu’elles avaient extraite de leur vie […] jusqu’à ce qu’elle ne forme plus entre leurs doigts qu’un petit tas, une petite boulette grise. »
Le langage est enlisé, laminé par l’usage commun, jusqu’à la bêtise ; les conversations sont le théâtre social de la bêtise.
Le malheur de « voir la bêtise et de ne plus la tolérer »
Evidemment, il est un peu décourageant d’envisager la bêtise comme notre lieu commun. On n’est pas tout à fait prêt à partager ce pot commun de la bêtise. Le jugement critique, la lucidité, peuvent-ils nous sauver ?
Flaubert pose tout particulièrement ce problème dans Bouvard et Pécuchet, auquel il appose en 1879 le sous-titre d’ « encyclopédie de la bêtise humaine ». Dans ce roman, avant le chapitre VIII, la bêtise des deux compères coïncide à l’incompréhension de ce qu’ils lisent dans leurs livres. Ils multiplient les erreurs de jugement, interprètent de travers les lois scientifiques, se trompent dans leur application. Mais à partir du chapitre VIII qui se termine sur le savoir philosophique, la bêtise se déplace : elle n’est plus définie à partir des contenus savants mal digérés, mais comme une contrepartie malheureuse inhérente à l’exercice intellectuel. On lit à la fin du chapitre :
« Alors une faculté pitoyable (= digne d’être prise en pitié) se développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer. »
Bouvard et Pécuchet développent alors une hyper sensibilité qui les conduit à « apercevoir partout la bêtise », ce qui, dit le narrateur, fait le malheur des deux « bonshommes » :
« Des choses insignifiantes les attristaient : les réclames des journaux, le profil d’un bourgeois, une sotte réflexion entendue par hasard. »
Leur bêtise tient donc à la fois à leur désir encyclopédique, puisque l’accumulation indifférenciée de savoirs et d’expériences implique la paralysie de tout jugement, mais la bêtise tient aussi à leur volonté de se distinguerde la bêtise des bourgeois de Chavignolles. Bouvard et Pécuchet vivent alors une vraie crise de la pensée, jusqu’à la mélancolie et la tentation du suicide. Pour y échapper, il faudrait renoncer à l’ambition d’un savoir total, et accepter pour soi, comme pour l’autre, une bêtise innée à toute créature. Il s’agirait de retrouver une sorte d’ignorance positive à la façon de Socrate, qui diffère de la simplicité brute et paresseuse. Savoir repérer, certes, les idées courtes des « nigauds [qui] forment la masse électorale », mais sans adopter une position extérieure et supérieure de vérité, menacée de devenir à son tour un stéréotype.
L’enjeu est discursif : l’affirmation nue, les sentences, sont le terreau d’une bêtise circulaire et proliférante, alors que le questionnement, l’incertitude énonciative, constituent une possibilité de jeu et de libération face à la bêtise. Flaubert notamment avec le fameux discours indirect libre, ne tient pas la bêtise à distance comme avec des pincettes, il l’intègre à la voix narrative. Barthes, pour sa part, après avoir déclaré une haine mortelle envers la bêtise, est finalement dans les Fragments du discours amoureux ou dans son espèce d’autobiographie Roland Barthes par Roland Barthes à la recherche d’une écriture oblique qui évite de se laisser prendre au piège de l’affirmation et du jugement, et admet la possibilité d’une bêtise innocente et dédramatisée, qui serait en tout cas un moyen de résistance contre l’impérialisme des idées.
Pas si bêtes
Balzac, dans les Illusions perdues, décrit ainsi l’un de ses personnages, un opportuniste nommé justement Finot :
« Sous sa fausse bonhomie, […], sous son ignorance et sa bêtise, il y a toute la finesse du marchand de chapeaux dont il est issu. »
“Finesse” de la bêtise et de l’ignorance : avec un puissant instinct de conservation et d’adaptation, elle a des ressources infinies, elle fait fructifier le vide. On hésite parfois à crier au génie. Cf. Nabila : « T’es une fille, t’as pas d’shampoing ?! Allo ! » On hésite à crier au génie. Qui est le plus bête, de Nabilla ou de la société de production qui la met en scène, et croit pouvoir impunément humilier les plus beaux spécimens de la bêtise ? Nabilla est devenue millionnaire en déposant sa phrase culte à l’Institut national de la propriété industrielle. La bête n’est pas si bête. Ni folie ni aliénation ni déficience, la bêtise s’autorise parfois des accès de raison et de calcul, et tire son épingle du jeu, quand l’intelligence raisonnable peut sembler « handicapée », limitée, disons timide.
Mais l’enrichissement obscène de youtubeurs analphabètes ne peut certes suffire pour regarder la bêtise avec bienveillance ou attendrissement.
L’adolescence est souvent qualifiée d’âge bête, période d’oppositions et de transgressions, à l’envers de l’éducation reçue. Alors que l’enfant est intelligent, l’adolescent deviendrait provisoirement bête. Cet âge « ingrat », analysé à partir du XXe s. dans la littérature scientifique, n’est pas bête en réalité, c’est la période pendant laquelle l’adolescent fait ses propres découvertes en désapprenant ce qui lui a été inculqué ; c’est l’âge de l’exploration pour une connaissance à soi, qui permet au jeune de se distinguer de ses parents.
Or, on peut extrapoler et envisager la bêtise, à tout âge, comme une façon de désapprendre pour explorer les potentialités de l’esprit, une innocence qui permet d’observer et d’assumer des responsabilités nouvelles, ou de découvrir de nouveaux horizons spirituels.
Dans La Tentation de Saint-Antoine de Flaubert, l’ermite Antoine se rêve en catoblépas, animal fabuleux qui par la complexion absurde de son corps (« buffle noir, avec une tête de porc tombant jusqu’à terre, et rattachée à ses épaules par un cou mince, long et flasque comme un boyau vidé »), symbolise la bêtise. Or Antoine s’incorpore au rêve du catoblépas :
« Gras, mélancolique, farouche, je reste continuellement à sentir sous mon ventre la chaleur de la boue. Mon crâne est tellement lourd qu’il m’est impossible de le porter. Je le roule autour de moi, lentement ; et la mâchoire entr’ouverte, j’arrache avec ma langue les herbes vénéneuses arrosées de mon haleine. Une fois, je me suis dévoré les pattes sans m’en apercevoir. »
Le rêve de devenir catoblépas est un rêve de régression et de dépouillement, qui permettrait d’atteindre ce que M. Foucault appelle « la stupide sainteté des choses. » (Travail de Flaubert, « La bibliothèque fantastique »).
Enfin, ne nous quittons pas sans évoquer la bêtise sublime de l’amoureux, l’éternel innocent, toujours inexpérimenté malgré la succession des rencontres. Son savoir ne lui sert à rien, il est contraint à la répétition. Son langage est pauvre, redondant, tautologique : il aime parce qu’il aime. Il ne sait dire que : « parce que c’est elle, parce que c’est lui, parce que c’est moi. » Être amoureux, c’est être « bête » !
Il y a dans les Fragments d’un discours amoureux de Roland Barthes, l’idée que l’amour est l’acceptation d’une forme d’innocence stupide, de l’ordre du saisissement :
« La bêtise c’est d’être surpris. L’amoureux l’est sans cesse ; il n’a pas le temps de transformer, de retourner, de protéger. Peut-être connaît-il sa bêtise, mais il ne la censure pas. »
Conclusion ?
Je m’en garderai bien, laissant décidément à l’incontournable Flaubert, le mot de la fin :
« L’ineptie consiste à vouloir conclure. […] Oui, la bêtise consiste à vouloir conclure. » (Correspondance)
L’objet du grenier n°3 : Jeanne d’Arc a fait la rentrée du lycée en 1884. Marie Perny. 31-05-2022.
L’objet du grenier n°3 : Jeanne d’Arc a fait la rentrée du lycée en 1884.
Marie Perny

Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France, Delagrave, 1884
Le troisième objet qui est au cœur de cette dernière midi-conférence est peut-être le plus ordinaire des objets pédagogiques de cette série « l’objet du grenier ». Il s’agit d’un livre, format in-octavo (comprendre format livre de poche), de 364 pages. C’est un livre d’Histoire : une biographie de Jeanne d’Arc, rédigée par un certain Joseph Fabre, éditée chez Delagrave, en 1884.
Il est issu de la toute première bibliothèque de notre lycée, qui ouvre, faut-il le rappeler, en 1884 et qui est alors le premier lycée public de filles de Toulouse, en application de la loi de 1880 sur l’enseignement secondaire public pour les filles.
Comme l’équilibriste et l’Omphale de plâtre, c’est donc un objet pédagogique des origines qui accompagne notre établissement depuis son ouverture jusqu’à nos jours.
Considérons plus attentivement sa reliure : une reliure rigide, recouverte d’une toile enduite, brune. Le titre de l’ouvrage figure sur la tranche, en doré, ainsi que deux étiquettes partielles, collées l’une sur l’autre, avec des numéros d’inventaires anciens. La dorure de la couverture a disparu mais l’on peut distinguer l’élégante estampille qui marque tous les ouvrages de la première bibliothèque du lycée jusque dans les années 1930 : dans un entrelacs végétal, le nom du lycée « LYCEE de Jeunes Filles TOULOUSE ». (figure 1)
La bibliothèque du Lycée de filles de Toulouse et l’ouvrage de Joseph Fabre
En 2017 a été réalisé par une douzaine d’étudiants d’hypokhâgne l’inventaire des ouvrages de cette toute première bibliothèque de notre établissement qui sont tous rassemblés dans diverses pièces de l’Hôtel Dubarry et dont on ignore le nombre de livres initial. Sur plus de 1000 livres répertoriés dans l’Hôtel Dubarry, 715 datent d’avant 1940 et 546 portent l’estampille du lycée : l’estampille est systématiquement portée jusqu’en 1909, plus rarement au-delà et jamais après 1932. Il s’agit donc d’une pratique des premières années du lycée.
Tous ces livres étaient regroupés dans la bibliothèque du lycée que l’on voit sur le plan de 1886 : une salle carrée située au rez-de-chaussée, sur un emplacement qui n’existe plus et se trouverait aujourd’hui dans la cour devant les bureaux de l’actuel vie scolaire. (figure 2).
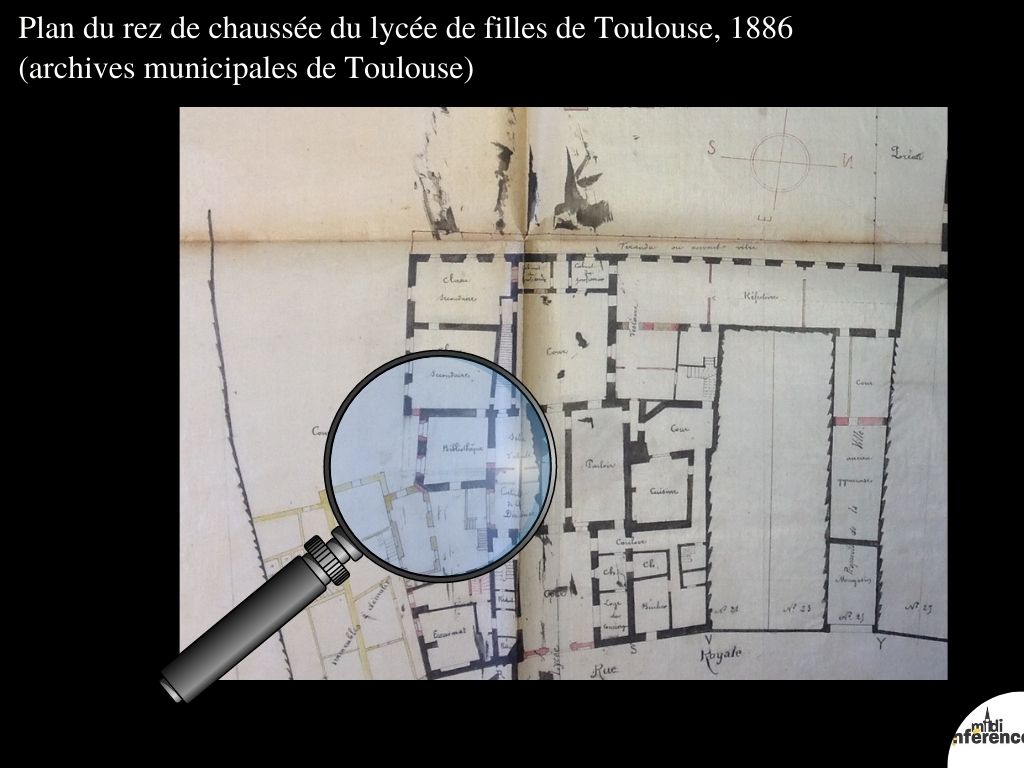
L’ouvrage de Joseph Fabren’est pas un manuel scolaire : il n’y a pas la simplification didactique que l’on trouve dans les manuels contemporains, notamment celui d’Ernest Lavisse, qui fait de Jeanne d’Arc l’un des rares portraits de femmes d’envergure nationale. On n’y trouve pas non plus d’images.
Joseph Fabre est né en 1842, à Rodez. Agrégé, il enseigne la philosophie (Louis-le-Grand) avant d’être élu député de l’Aveyron, en 1881, au sein du parti radical républicain, l’un des partis qui fondent de manière décisive la IIIe République. Quand son ouvrage sur Jeanne d’Arc paraît en 1883, il est à la fois auteur et homme politique, une double-dimension qui sous-tend le contenu de l’ouvrage. (figure 3)

C’est la 3e édition que nous possédons. Elle se compose de quatre parties qui abordent successivement la bergère, la guerrière et la martyre et qui propose un ensemble de réflexions sur certains aspects de la vie de Jeanne mais aussi sur l’état de l’historiographie de l’époque sur la question. Le style est assez enlevé, narratif, raisonnablement lyrique, et l’auteur reprend les sources brutes qu’il a pu consulter, notamment des passages entiers des interrogatoires de Jeanne lors de son procès.
Il n’est pas possible dans cet exposé de faire l’histoire de Jeanne d’Arc, née en 1412 à Domrémy (actuelle Lorraine) et morte à Rouen, en 1431, sur le bûcher, dans le contexte de la Guerre de Cent ans qui oppose roi d’Angleterre et roi de France pour la maîtrise du trône de France. Tout est étonnant dans cette histoire: sa fulgurance, le fait qu’une jeune fille parte à la guerre au nom de Dieu, qu’elle soit écoutée et suivie, qu’elle participe au réveil du camp de Charles VII, mais aussi son procès et l’aplomb avec lequel elle fait face à ses juges. Et sa fin est terrible. Pour l’histoire de la Jeanne d’Arc du XVe siècle, je renvoie aux travaux de Colette Beaune, notamment Jeanne d’Arc. Vérités et légendes qui dans des chapitres courts et efficaces, détricote les mythes et rétablit les vérités autour de ce personnage.
En effet, il est nécessaire de démêler plusieurs éléments quand on aborde Jeanne d’Arc : dès son vivant, elle est au cœur de rumeurs et de visions divergentes. Sainte guerrière qu’il faut suivre ou instrument du diable qu’il faut anéantir. Mais Jeanne d’Arc est aussi le produit du XIXe siècle, qui s’en est emparée et qui l’a façonnée selon plusieurs traditions (je renvoie aux importants travaux de l’historien Gerd Krumeich à ce sujet).
Jeanne d’Arc a cela de particulier que tout le monde s’en réclame : elle est la bergère fille du peuple en qui les républicains se reconnaissent ; elle est cette jeune fille humble guidée par Dieu dont elle entend les voix des émissaires (saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite) et qui se met au service du roi Charles VII. Sa mort relève autant du sacrifice propre aux martyrs et donc aux saints, que de l’exécution injuste et arbitraire, qui fait d’elle une victime du fanatisme et de la trahison.
Ouvrir le livre de Joseph Fabre, c’est plonger dans la virulence du débat qui oppose deux France, la France républicaine et la France cléricale, en un moment décisif où la République s’enracine dans un pays à l’histoire politique houleuse, sans cesse menacée par le conservatisme monarchique et clérical.
1. Un ouvrage qui s’inscrit dans la continuité des travaux décisifs menés sur Jeanne d’Arc au XIXe siècle
L’ouvrage de Joseph Fabre n’est pas le premier à proposer une synthèse de la vie de Jeanne d’Arc et il est profondément influencé par les travaux majeurs de deux figures importantes de l’histoire et de la science historique au XIXe siècle, deux Jules : Jules Michelet et, moins connu, Jules Quicherat.
Dans les pas de Jules Michelet : (figure 4)
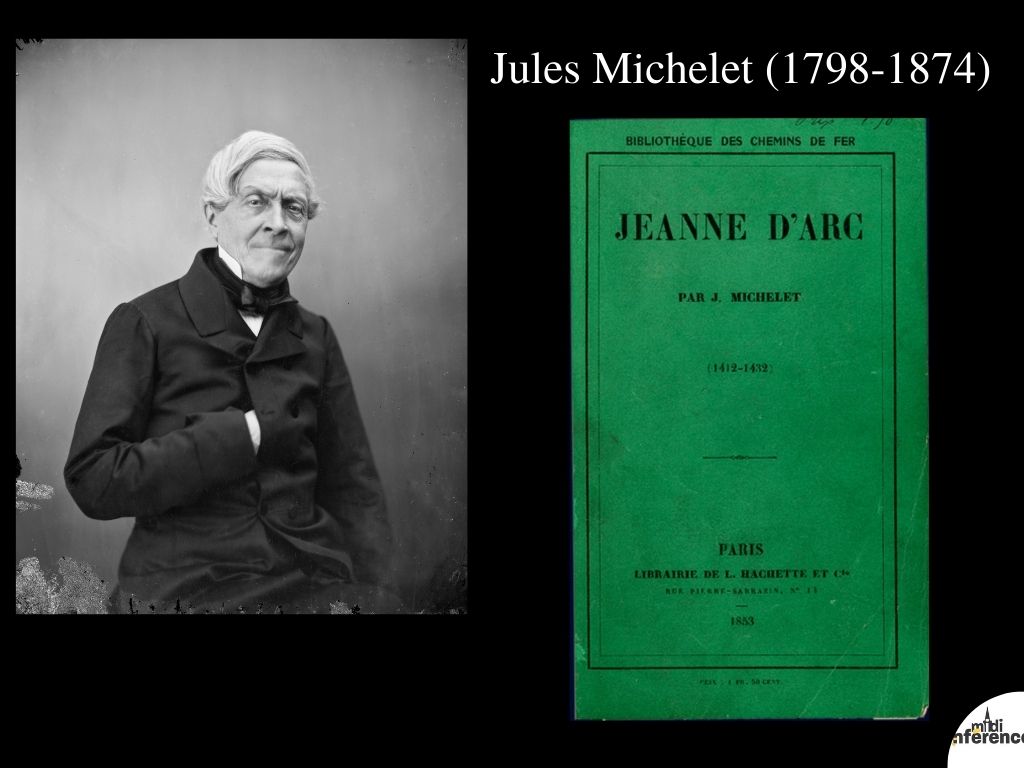
Quand Joseph Fabre naît en 1842, Jules Michelet vient de faire paraître en 1841 le 5e tome de sa colossale Histoire de France où il traite essentiellement de la guerre de Cent ans et tout particulièrement de Jeanne d’Arc. Précisons que l’oeuvre intégrale de Michelet figure aussi sur les rayonnages de la bibliothèque du lycée. Le succès de ce volume est tel que les chapitres sur Jeanne d’Arc sont tirés à part en 1853 chez Hachette, livre sans cesse réédité pendant les décennies qui suivent.
L’ouvrage de Michelet est décisif : avec le souffle d’une écriture puissante, il dresse le portrait de Jeanne, fille du peuple qui sauve le pays malgré ses élites, l’image de la force du peuple souverain en qui réside l’identité du pays ; il évoque qu’elle est « la ravissante image de la patrie » et conclue « Souvenons-nous toujours, Français, que la patrie chez nous est née du cœur d’une femme, de sa tendresse, de ses larmes, du sang qu’elle a donné pour nous. »
(Cette dernière citation était conseillée d’utiliser dans les dictées de l’école primaire de la IIIe République).
Joseph Fabre ne cache pas sa filiation à l’oeuvre de Michelet : « Voici venir Michelet, l’Homère du peuple, le Delacroix de l’histoire, le chercheur perspicace, le grand évocateur » (p. 304).
Dans la continuité des travaux de Jules Quicherat : le souci de la source (figure 5)
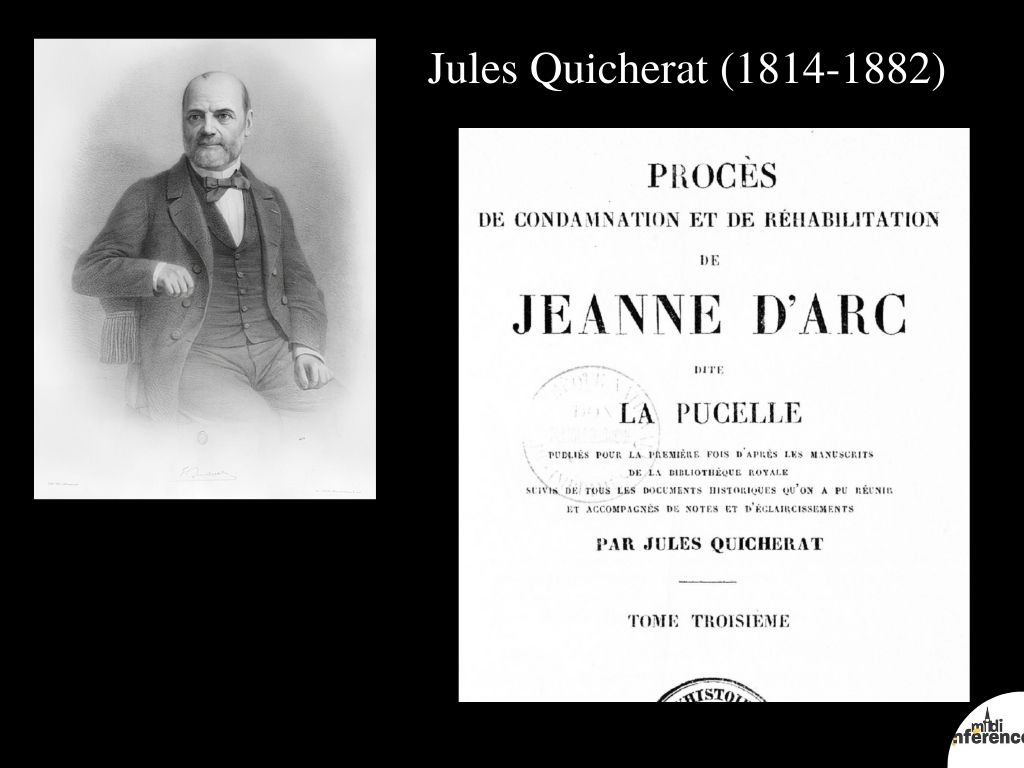
En parallèle des travaux de Michelet, un jeune chartiste, Jules Quicherat, qui a suivi les cours que Michelet donnait à la Sorbonne, est chargé en 1840 par la très officielle Société d’Histoire de France de préparer l’édition complète de tous les actes des deux procès de Jeanne d’Arc : le procès en condamnation de 1431 et le procès en réhabilitation de 1453. En 1849, ce sont cinq volumes de sources originales avec leur appareil critique qui ont déjà paru.
Joseph Fabre s’inscrit dans la continuité des travaux de Quicherat sur lesquels il s’appuie : il propose la première transcription intégrale en français des actes du procès en 1883.
Au tout début de l’ouvrage, il propose le fac-similé d’une lettre que Jeanne d’Arc adresse depuis le siège de la Charité-sur-Loire à la ville de Riom en Auvergne pour obtenir du soutien militaire, avec la signature de Jeanne d’Arc. Il dresse la transcription de cette lettre et mentionne explicitement les travaux de Quicherat qui a découvert cette lettre. On voit alors le souci d’enraciner sa pensée dans la source et donc de mener un travail précis et rigoureux, mais aussi le souci de porter les sources à la connaissance d’un lectorat élargi.
Joseph Fabre est donc l’héritier des travaux fondateurs de deux piliers de la connaissance autant que de la fabrication de Jeanne d’Arc au XIXe siècle.
Un ouvrage patriotique : « libératrice de la France », une Jeanne de la revanche ?
Michelet avait intitulé son ouvrage simplement Jeanne d’Arc. Joseph Fabre ajoute au sien un sous-titre : Jeanne d’Arc, libératrice de la France. (figure 6)

C’est qu’entre les deux biographies, il s’est produit un événement décisif : la défaite de la France face à la Prusse en 1870, qui ampute le territoire national de trois départements, l’Alsace et le nord de la Lorraine, la Moselle. A la crise militaire se conjuguent les troubles politiques avec la chute du Second Empire et les débuts difficiles d’une République qu’il reste à définir, éclaboussée par le sang de la Commune de Paris en mars 1871. Cette crise donne à la figure de Jeanne d’Arc une force renouvelée : elle incarnerait l’image de la résistance à l’envahisseur et l’espoir d’une revanche.
L’auteur fait à plusieurs reprises l’analogie entre la France occupée par les Anglais et celle occupée par les Prussiens : « En parlant de leurs maux, ces bons Lorrains avaient les larmes aux yeux. Voisins des Allemands, ils n’en étaient que plus Français. C’est à ses frontières que la patrie est la plus aimée. » (partie I, chapitre II, p. 20). Dans un chapitre intitulé « La mémoire de Jeanne d’Arc » qui conclut la troisième partie, l’auteur s’adresse directement à Jeanne dont il exhorte à l’imitation : « Oh ! Souffle-nous cette grande pitié pour la patrie, cette haine profonde pour l’envahisseur, dont tu étais animée ! Souffle-nous cette foi qui soulève les montagnes ! Et alors, aux jours où la force devra repousser la force, nos jeunes filles armeront elles-mêmes nos jeunes gens ; nos vieillards encourageront de leurs bénédictions les soldats de la patrie ; nous sentirons grandir nos âmes ; nous combattrons en héros ; et, s’il le faut, les pierres se lèveront pour chasser l’étranger. » (p.224)
C’est bien un ouvrage qui s’inscrit dans l’esprit de revanche qui anime la république républicaine des années 1880. Notons que Fabre a écrit d’autres ouvrages sur les figures de libérateurs : les libérateurs antiques (Caton, Spartacus…) mais aussi Washington, libérateur de l’Amérique.
Mais si l’ennemi de l’extérieur est dénoncé dans cette analogie Anglais/Prussiens, Fabre dénonce aussi les ennemis de l’intérieur qui sont une aussi grande menace pour le pays. En effet, il n’est pas tendre avec les hommes d’Eglise qui interviennent dans son récit. Il fait peser la responsabilité de l’arrestation de Jeanne et de sa livraison aux Anglais au clergé français : « ainsi, ce fut par l’intermédiaire de prêtres français et avec l’argent français, que les Anglais achetèrent le sang de la libératrice des Français » (p. 133). La IIIe partie, sur le procès, est une charge implacable contre le clergé accusé de duplicité avec l’Anglais : « La cupidité alléchait les uns ; l’ambition excitait les autres. Certains n’avaient qu’à écouter leur fanatisme. Plusieurs obéissaient à la peur » (p. 142).
Et face à Jeanne, seule et simple, « ils étaient là, alignés sur leurs bancs, tous ces doctes théologiens, faces sèches, regards obliques, cœurs froids » (p. 145).
Il faut ajouter une critique portée à l’encontre du roi Charles VII, dont l’auteur souligne qu’il ne fit rien pour sauver Jeanne : « Mais le roi ? Quel chagrin témoigna-t-il ? Quels efforts fit-il pour sauver celle qui avait sauvé son royaume ? Pas de trace d’aucune négociation, d’aucune offre de rançon, d’aucun fait d’armes tenté pour délivrer la libératrice. » « la plus monstrueuse ingratitude dont l’histoire présente l’exemple » (p.125).
Cette critique d’un clergé corrompu et d’une royauté lâche est à lire à la lumière du républicanisme de l’auteur. Quand l’ouvrage paraît en 1883, la République s’enracine en France, au terme d’un siècle politique des plus houleux. Et elle se construit contre le monarchisme latent, associé à l’Eglise catholique engagée en politique (ce que l’on désigne du nom de cléricalisme).
Le projet de la fête nationale autour de Jeanne d’Arc : une Jeanne républicaine de la réconciliation nationale ?
Ce livre a un objectif très concret : il accompagne un projet de loi déposé par l’auteur en tant que député de l’Aveyron le 30 juin 1884, celui de fonder une fête nationale en l’honneur de Jeanne d’Arc, ce que la préface exprime très clairement. « Oserai-je exprimer un vœu ? La République française devrait décider qu’il y aura annuellement un jour où la fête de l’héroïne sera célébrée par toute la France. » (préface, p. X)
Si l’enracinement de la République passe par le développement des institutions républicaines, comme l’école publique sous tous ses aspects, ou encore l’armée, il passe aussi par la structuration d’une identité républicaine autour d’emblèmes et de célébrations : la multiplication des statues de Marianne, l’allégorie de la République ; la proclamation d’un hymne national, La Marseillaise, en 1879 ; ou encore la proclamation du 14 juillet en tant que fête nationale en 1880. Autant de célébrations qui font de la République l’héritière directe de la Révolution française.
Fabre fait de Jeanne une figure révolutionnaire incarnant la résistance populaire face aux élites traditionnelles corrompues et, déjà, la préfiguration de la République : « C’est que le peuple se reconnut lui-même dans cette plébéienne sauvant la patrie compromise par les fautes de la noblesse et de la royauté. Lorsque la France démocratique se leva en 1792 pour repousser les cohortes de l’Europe monarchique, elle brûlait du même feu sacré qui animait la Pucelle repoussant les Anglais » (p. 222). Notons que Michelet n’écrivait pas autre chose : Jeanne d’Arc préfigurait le peuple révolutionnaire.
Fabre précise l’intention de cette fête à Jeanne d’Arc dont il porte le projet : établir une fête nationale célébrant la réconciliation du pays autour de la patrie incarnée par Jeanne d’Arc. « L’essentiel est l’établissement de cette solennité, qui rapprocherait tous les Français, hommes et femmes, républicains et monarchistes, croyants et libres-penseurs dans une même communion d’enthousiasme. La nation a déjà sa fête de la liberté. Elle aurait sa fête du patriotisme. » (préface, p. XI)
Mais ne nous y trompons pas : en 1884, la polarisation du débat politique est exacerbée comme jamais autour de la place de l’Eglise dans la société et dans les affaires du pays. Toujours associée au conservatisme et au monarchisme latent, l’Eglise est endiguée par la République qui se prémunit de son influence, en étant de plus en plus vigilante à son égard. Quand Joseph Fabre, député radical, propose cette fête nationale autour d’une Jeanne d’Arc républicaine, il s’inscrit dans cette bipolarisation et a conscience du danger que pourrait représenter une appropriation de Jeanne d’Arc par la seule Eglise catholique et par le parti clérical.
C’est qu’en effet, l’Eglise œuvre depuis plusieurs années à la canonisation de Jeanne d’Arc, considérée comme une sainte, guidée par Dieu, morte en martyre. Le mouvement est lancée dès 1849 par l’évêque d’Orléans, Monseigneur Félix Dupanloup, une figure éminente du cléricalisme français. (figure 7)

Une crise éclate en 1878, quand la IIIe République décide de célébrer le centenaire de la mort de Voltaire, mort le 30 mai 1778. Voltaire est érigé comme un précurseur de la pensée républicaine et l’on met en avant son esprit fondamentalement libre. Il est aussi la cible des attaques des monarchistes de tous bords et des conservateurs cléricaux qui accusent son œuvre d’avoir empoisonné la France et d’avoir conduit à la Révolution. Coïncidence extraordinaire de l’histoire, le 30 mai, c’est aussi la date de la mort de Jeanne d’Arc. Or, Voltaire est l’auteur d’un ouvrage, La Pucelle d’Orléans, dans lequel il n’est pas tendre avec Jeanne d’Arc.
Pour les conservateurs, monarchistes et cléricaux, la commémoration de la mort de Voltaire est une provocation et ils se rangent sous la bannière de Jeanne d’Arc, qui devient alors une figure anti-voltairienne brandie à la face de la toute jeune République. Un appel est lancé dans la presse catholique adressé « aux femmes de France » pour que celles-ci « prennent l’initiative d’une vénération solennelle » à Jeanne d’Arc afin de rappeler que seule la foi traditionnelle était capable d’incarner la patriotisme français, dont l’identité était fondamentalement catholique.
L’appel est signé par une quarantaine de femmes, toutes issues de la noblesse et des milieux conservateurs réactionnaires farouchement opposés à la République, qui constituent le « Comité des Femmes de France ».
Pour éviter que ces célébrations et contre-célébrations ne dégénèrent dans l’espace public, le gouvernement interdit toute manifestation publique quelles qu’elles soient le 30 mai : les voltairiens se replient dans plusieurs théâtres parisiens (Victor Hugo a fait un discours remarqué au théâtre de la Gaieté où il concilie Voltaire et Jeanne d’Arc dans une même défense des droits du peuple) et le Comité des Femmes de France se replie à Notre-Dame de Paris où est donnée une messe expiatoire célébrée par l’archevêque de Paris et en présence d’une quarantaine de sénateurs.
Par son projet de loi, Fabre envisage bien d’endiguer l’appropriation de Jeanne d’Arc par l’Eglise, et de célébrer non pas une sainte accomplissant la volonté de Dieu sur Terre, mais une héroïne défendant son pays. Et la dédicace de l’ouvrage prend alors une autre dimension : « Aux Femmes de France, ce livre sur Jeanne d’Arc est dédié ». (figure 8)
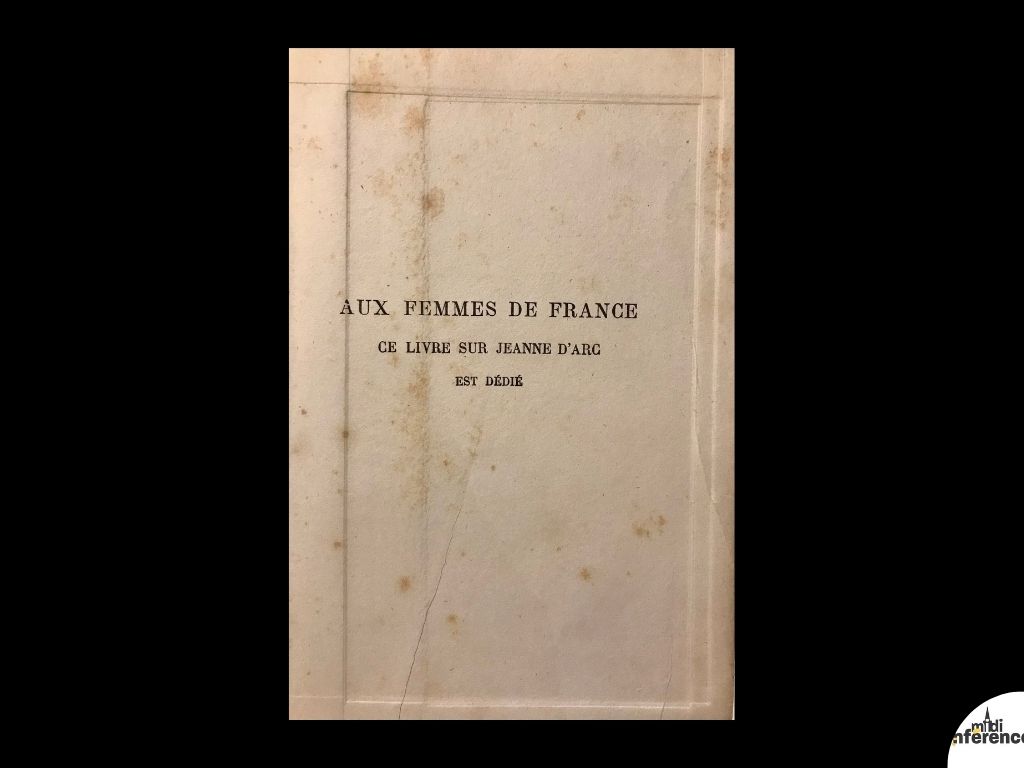
Il s’agit de libérer les femmes de France du seul comité portant leur nom collectif et incarnant un projet résolument clérical et conservateur. La création des lycées publics de filles, en 1880, relève de la même intention : inclure les femmes dans le projet républicain et défaire le quasi monopole qu’exerçait l’Eglise dans l’éducation des filles et notamment des filles de la bourgeoisie.
Ce livre est donc un livre résolument républicain dans une institution résolument républicaine, le tout dans un moment fondateur de la République.
Conclusion en trois questions :
Le projet de cette fête à Jeanne d’Arc a-t-il abouti ? La réponse est non puis oui.
En 1884, malgré la sympathie que le projet rencontre à gauche et au centre de l’hémicycle, deux difficultés sont soulevées : comment articuler cette fête avec celle du 14 juillet ? Et n’y a-t-il par un risque de collusion avec le projet de canonisation qui risque de brouiller le message donné par une telle fête ? Fabre est en fin de mandat. Il n’est pas réélu en 1885 et le projet n’est plus abordé par la Chambre.
En 1894, voilà Fabre, devenu sénateur, toujours de l’Aveyron, porte de nouveau son projet. Le climat politique est particulièrement houleux et une partie des élites conservatrices, notamment des militaires de haut rang marquent leur défiance à l’égard de la République (c’est le tout début de l’Affaire Dreyfus, qui n’est pas encore « Affaire »). La gauche républicaine prend ses distances avec l’idée d’une célébration nationale autour de Jeanne d’Arc qu’ils considèrent comme un cheval de Troie du cléricalisme dans l’édifice républicain : un anti-14 juillet que les cléricaux pourraient investir comme une contre-fête nationale. Si le projet de Fabre est voté à 146 voix contre 100 au Sénat, il n’est suivi d’aucun examen par la chambre des députés.
Il faut attendre 1920 pour que la fête nationale à Jeanne d’Arc soit votée, par une Chambre des députés à majorité de droite et du centre, la fameuse Chambre dite « bleu horizon ». Cette fête, tombée en désuétude, figure toujours au calendrier des 12 fêtes républicaines. Notons que c’est aussi en 1920 que Jeanne est canonisée et devient sainte Jeanne d’Arc.
Cette vive querelle des deux Jeanne d’Arc s’est-elle ressentie à Toulouse et plus précisément dans nos murs ?
Oui. Ces deux Jeanne d’Arc, celle de la République et celle de l’Eglise, ne sont séparées que par un mur dans le quartier où se trouve notre établissement.
Voici une photo de 1901, prise un dimanche de mai, jour du fameux et traditionnel marché à la ferraille sur la place de la basilique Saint-Sernin. On y voit la façade de l’hôtel Dubarry, alors propriété de la congrégation des Bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement, qui dirigeait un couvent et une institution d’éducation pour jeunes filles. La façade est décorée de guirlandes de fleurs et de panneaux à la gloire de Dieu et de Jeanne d’Arc, avec sans doute une représentation de Jeanne devant l’archange St-Michel. C’est ici la Jeanne des catholiques, sur la façade d’un établissement religieux qui met en avant la conception d’une France avant tout catholique. (figure 9)

Au même moment, à une trentaine de mètres de cette façade, sur les rayonnages de la bibliothèque du lycée public de filles de Toulouse, séparé du couvent par un simple mur, se trouvait le livre de Joseph Fabre proposant une autre lecture de Jeanne d’Arc.
Ce livre a-t-il été lu ? Mystère.
Les marques de compression que l’on constate sur les premières pages font penser que l’ouvrage a été longtemps conservé fermé, sur les rayonnages serrés d’une bibliothèque. On peut trouver une fiche de prêt datant de la deuxième moitié du XXe siècle (antérieure à la fin des années 1990), signe que l’ouvrage est toujours disponible au prêt auprès des élèves. Mais la fiche est vide de tout nom et de toute date. Le livre n’aurait jamais été emprunté… C’est le signe de la désaffection pour Jeanne d’Arc et du militantisme qui l’accompagnait, et peut-être aussi le signe que ces ouvrages à la couverture brune et aux ors évaporés n’exerçaient plus qu’un grand pouvoir d’indifférence auprès des lecteurs.
Enfin, nous pouvons conclure par un clin d’oeil de l’Histoire qui rapprochera l’épopée de Jeanne avec le lieu que nous fréquentons quotidiennement. A Toulouse, nous ne sommes pas dans la France johannique : tous les ans, les lieux qui font partie de la geste de Jeanne d’Arc la commémorent. Orléans la célèbre depuis 1433, Reims, Compiègne, évidemment Domrémy qui porte le nom de « Domrémy-la-pucelle ».
Quand Jeanne décide d’aller à la rencontre du roi et quitte son village, elle se rend dans la ville de Vaucouleurs où se trouve un gouverneur de l’armée royale française, Baudricourt, qu’elle parvient, non sans difficulté, à convaincre de l’escorter jusqu’au roi Charles VII.
Trois siècles après, en 1743, dans cette même petite ville de Vaucouleurs naissait une autre Jeanne, sans père officiel. La tradition veut qu’elle ait porté ce prénom en référence à Jeanne d’Arc. Cette Jeanne-ci, c’est la future Jeanne Dubarry, que le proxénète Jean Dubarry a fait sa belle-soeur mais aussi et surtout la maîtresse du roi Louis XV. Nous sommes en 1768 et c’est le début de la fortune des Dubarry, une fortune qui permet à Jean de construire l’hôtel qui porte son nom et qui constitue l’un des joyaux, fatigué certes, du patrimoine bâti de notre lycée. Le village de Vaucouleurs, une affiliation de prénoms, la proximité avec un roi, une exécution publique (Jeanne Dubarry est guillotinée en 1793), autant de points communs entre les deux Jeanne.
En refermant cet ouvrage, c’est la malle du grenier pédagogique de notre lycée que nous refermons avec précaution pour cette année !
Bibliographie indicative :
Joseph Fabre, Jeanne d’Arc, libératrice de la France : la version numérisée par la BNF est celle de 1894. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k920920s
Colette Beaune, notamment Jeanne d’Arc. Vérités et légendes, Perrin, 2004, Tempus, réédition 2012.
Claude Gauvard, Jeanne d’Arc. Héroïne diffamée et martyre, Gallimard, « L’esprit de la cité. Des femmes qui ont fait la France », 2022.
Michel Winock, « Jeanne d’Arc », dans Les lieux de mémoires (sous la direction de Pierre Nora), volume III.
Gerd Krumeich, Jeanne d’Arc à travers l’Histoire, Belin, 2017.
L’émission Du Grain à moudre sur France culture du 27 mai 2016, « Mais pourquoi Jeanne d’Arc ? » : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/du-grain-a-moudre/mais-pourquoi-jeanne-d-arc-3245560
Sur l’histoire du lycée Saint-Sernin, le livret interactif:
Les droits de l’homme en milieu carcéral. Christine Soucille. 24-05-3022

Les droits de l’homme en milieu carcéral
Christine Soucille
24-05-3022
Introduction
La prison est pour la très grande majorité de la population un univers inquiétant et mal connu, malgré l’attention médiatique dont elle est couramment l’objet.
La réalité du monde carcéral est quasi imperceptible pour celui qui n’a pas franchi les hauts murs. On ne se doute pas du drame qui se joue au quotidien derrière les barreaux ; drame dans lequel on peine parfois à distinguer les coupables, des victimes.
Depuis quelques années, la surpopulation carcérale bat des records. Et la France est régulièrement condamnée par la CHDH pour conditions de détention indignes Et pour cause, en Europe, la France est au 4ème rang des prisons surpeuplées juste après la Roumanie.
Ces condamnations sont corroborées par les rapports rédigés par les organes de contrôle qui enquêtent régulièrement sur l’état de prisons françaises (rapports parlementaires, rapports du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Libertés des droits….
Constat d’autant plus inacceptable pour un pays qui se veut « patrie des droits de l’Homme. »
Un constat qui fait écho au cri d’alarme lancé par Dominique Simonnot Controleuse générale des lieux privatif de liberté (CGLPL) qui dans une tribune publiée dans le monde au mois de février 2022 invite en ces termes les députés et les juges à se confronter à la réalité des établissements pénitentiaires elle écrit :
« Entrez dans les prisons ! Venez découvrir les colonnes de cafards qui cavalent en rangs serrés et les rats qui grignotent dans la cour ! Voyez ces trois hommes dans 4,30 mètres carrés d’espace vital. Écoutez ce que me dit celui-ci: « Je suis dans un trou qui s’appelle une prison, à trois dans une cage pour un ».
Mais dans le même temps elle écrit également :
« Venez, écoutez les surveillants, les directeurs pénitentiaires dire leur colère, leur désespoir…vous décrire leurs tâches rendues folles par la folie des cellules qui débordent ».
Ces propos nous invitent à réfléchir sur l’effectivité du respect des droits de l’homme dans les prisons françaises ? Face à une tache aussi ambitieuse mon travail n’aura pas la prétention d’être exhaustif
J’ai volontairement écarté un grand nombre de problématiques telles que l’évolution des politiques pénitentiaires ou le bien-fondé philosophique de l’incarcération.
A défaut d’exhaustivité, mon exposé se limitera à éclairer l’effectivité des droits de l’homme à partir de constats émis par les rapports officiels de diverses autorités de contrôle (Observatoire International des Prisons, la Commission nationale consultative des droits de l’homme) et la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme).
Mais cet exposé repose également sur des témoignages de détenus, de membres du personnel pénitentiaire que j’ai été amenée à côtoyer, il y a quelques années. En effet, pendant 3 ans je suis intervenue en tant que visiteuse de prison et enseignante bénévole à la prison de la santé à Paris.
Malgré ce vécu et même si certains éléments pourraient peut-être vous choquer, mon propos cherchera à être le plus objectif possible en refusant de céder ni à l’émotif ni à l’angélisme tant il est difficile de faire la part des choses une fois plongé au cœur de la spirale carcérale
1ère PARTIE Un état des lieux des prisons françaises
A Un constat : réalité de la surpopulation carcérale
Au 1er octobre 2021, la France comptait 187 centres de détention dont 81 maisons d’arrêts et une centaine d’établissements pour peine
On recense en 2022 235 000 personnes placées « sousmain de justice » (expression qui regroupe les personnes incarcérées et celles faisant l’objet d’une peine alternative à l’incarcération), toutes suivies par l’administration pénitentiaire. Il faut cependant distinguer les personnes effectuant leur peine en milieu ouvert et les détenus en milieu fermé.
Parmi celles-ci 31 mars 2022, on compte 85 136 détenus incarcérés pour environ 60000 places disponibles dans nos prisons (60 619 exactement)
Un déficit de 25000 places expliquant les condamnations récurrentes de la France par la CEDH pour fait de la surpopulation carcérale en moyenne on estime de 1700 personnes dorment aujourd’hui sur des matelas à même le sol
B D’autres chiffres accablants
Le nombre de personnes incarcérées a plus que doublé au cours des quarante dernières années.
-1/3 des détenus souffrent des troubles psychiatriques ou psychologiques graves et sont internés avec les autres détenus faute de places dans les structures adaptées.
-Parmi les 42 pays du Conseil de l’Europe, la France affiche le taux le plus élevé de suicide, soit un taux 2 fois supérieur à la moyenne européenne Une hausse des suicides en détention s’élève à plus d’une centaine par an (122 en 2021 contre 111 en 2020)
Nous interroger sur l’effectivité du respect des droits des détenus suppose de rappeler brièvement de quels droits peuvent se prévaloir les détenus.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, le détenu n’avait aucun statut juridique. Progressivement, la prison s’est « humanisée ». Aujourd’hui, un certain nombre de droits ont été reconnus aux détenus Il s’agit notamment : du droit à une vie familiale, du droit à la santé, de la liberté deconscience, droit de vote droit à un avocat…etc. Surtout la Cour européenne a rappelé à la France que le respect de la dignité et des droits fondamentaux des individus ne s’arrête pas aux portes des prisons.
Toutefois, reconnaissance ne veut pas dire effectivité. L’affirmation de ces droits et leur application sont, pour diverses raisons, parfois en décalage.
2èmePARTIE La France régulièrement condamnée pour : « traitements inhumains ou dégradants subis par les détenus en raison des conditions de détention indignes »
Ces mots sont extraits de l’arrêt J.M.B ctre France du 30 janvier 2020 par lequel la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France sur la base de l’art 3 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit aux États de pratiquer la torture ou de soumettre une personne à des traitements inhumains ou dégradants .
Concrètement que met-on derrière les termes de conditions de détentions indignes et de traitement inhumains ou dégradants ?
A Des conditions de détentions indignes
-Des expressions qui renvoient à une réalité vécue subie mais également à un encadrement juridique
En France la notion de « conditions de détentions indignes » renvoie à un état de vétusté́ et d’insalubrité́ des établissements pénitentiaires, à la promiscuité́, la présence de puces, punaises de lit, cafards et rats Personnellement lors de mes visites à la santé nous nous amusions à compter le nombre de rats qui en une après-midi traversaient en toute hâte notre parloir
-Les rapports de l’OIP (Observatoire Internationale des Prisons) ou ceux du CGLPL (Controleur Général des lieux Privatifs de Libertés) dénoncent l’insalubrité des espaces sanitaires, des espaces de douches dégradés, la présence de moisissures, l’absence d’aération, le manque de lumière dans les cellules, les difficultés récurrentes pour avoir du chauffage, de l’eau chaude, des ventilateurs
-Cette énumération non exhaustive de conditions déplorables d’hygiène et d’insalubrité́, sont connues depuis des années de la part de de l’État. Mais il est difficile d’y remédier.
En effet, les conditions de détention indignes résultent surtout de la surpopulation carcérale, un mal chronique des prisons françaises. Théoriquement en 1885 avec la loi Béranger a été posé le principe de l’encellulement individuel, sans cesse réaffirmé par les réformes pénitentiaires au XX ème et XXI ème siècles mais dont l’application a sans cesse été repoussée.
–Indignité des conditions de prise en charge de la santé en prison
Outre la vétusté des bâtiments le Comité européen de prévention de la torture qualifie également d’indignes les conditions de prise en charge des soins des détenus.
A partir de 1994, la politique de santé a été rénovée et placée sous la responsabilité des hôpitaux et non plus de l’administration pénitentiaire. Cette réforme prévoit entre autre la création d’une unité sanitaire au sein de chaque prison et la présence d’unités hospitalières sécurisées pour des hospitalisations prolongées. Pourtant ces dispositions n’empêchent pas la persistance de graves dysfonctionnements.
La Contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté Dominique Simonnot mentionne le cas de détenus qui finissent par se percer eux-mêmes l’abcès dentaires faute de pouvoir accéder à une consultation dentiste,
La Cour des comptes, (dans un rapport en 2019) à son tour, dénonce la gestion calamiteuse des politiques de prévention en matière de maladies transmissibles, véritables fléaux en prisons : le VIH, l’hépatite C, la tuberculose Ceci explique également la gestion dramatique du COVID en 2020 a débouché sur des mutineries comme à la prison d’Uzerche en Corrèze, en 2020 ; avant que les autorités ne se décident à libérer un grand nombre de détenus tant la situation était explosive.
D’autres règles, dans la prise en charge de la santé des détenus sont violées au quotidien. Par exemple, les articles 147 et suivants du code de procédure pénale prévoient la suspension de la peine d’emprisonnement du détenu lorsque son état de santé physique ou mentale est incompatible avec son maintien en détention. Or en réalité l’effectivité de ce droit est régulièrement bafouée.
Est également pointée du doigt la prise en charge médicale des détenus particulièrement surveillés (DPS). Ces derniers peuvent demeurés constamment menottés au lit d’hôpital pendant des semaines et ne peuvent consulter un médecin sans présence policière.
Mais la réalité de conditions de détention renvoie à une réalité qu’on ne peut décrire qu’avec « le poids des mots et le choc des images ».
-Pour le poids des mots je reprends ceux de de Dominique SIMONNOT (CGLPL) qui déclare à la sortie de la prison de Fresnes « ….Là-bas, les cafards sortent des plaques chauffantes…. ».,
Mais sortant de la prison de Seysses elle s’exclame : « on nous a rapporté que les détenus s’enroulent dans les draps et se mettent du papier toilette dans les oreilles pour que les cafards n’entrent pas dedans ».
-Quant au choc des images je pense que certaines parlent d’elles-mêmes ( cf : prisons de Seysses ; les Baumettes …)Souvenons-nous que la France est également condamnée pour « traitements dégradants »
B – es détenus victimes de traitements dégradants
Juridiquement on estime que peut être qualifié de dégradant « tout traitement qui humilie ou avilit un individu, porte atteinte à sa dignité́ humaine qui suscite chez l’intéressé́ des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité́ ».
Pour illustrer l’exemple de traitements indignes et dégradants vécus dans les prisons j’ai choisi de prendre comme exemple la question sensible des violences carcérales qui a notamment fait l’objet d’un rapport de l’Observatoire internationale des prisons en 2019 intitulé « Omerta opacité impunité » trois mots clés qui reflètent parfaitement le halo de violence permanent qui habite nos prisons (surtout dans les maisons d’arrêt)
Les accès de violence sont multiformes : violence entre détenus, de surveillants à détenus, de détenus à surveillants, entre détenus avec la complicité des membres du personnel pénitentiaire ce dernier phénomène s’aggravant. Ces violences s’abattent prioritairement sur les catégories les plus vulnérables de détenus (malades, étrangers, indigents en sont les premières victimes )
Cependant dans l’ensemble, ces agissements sont le fait d’une minorité́ de surveillants, au comportement isolé.
De multiples facteurs ont ces dernières années favorisé l’aggravation de ce climat de violence : une dégradation des conditions de détention, l’obsession sécuritaire au mépris du le respect des droits, des règles de discipline vécues comme incohérentes un sentiment d’arbitraire….
Il est vrai qu’en prison les règles ne sont pas les mêmes pour tous. Les détenus auxquels je rendais visite s’insurgeaient régulièrement contre les conditions de détention confortables dont jouissaient Maurice Papon ou Bernard Tapi tous deux logés dans le quartier VIP et arbitraire
La violence carcérale, connue de longue date par l’État, et celui-ci a l’obligation en théorie de protéger les détenus en tant que personne vulnérables.
Mais depuis des années la situation évolue peu : pourquoi ?
Tout simplement parce que la prison est régie par une loi d’airain qui freine toute évolution : une loi d’airain reposant d’abord sur l’omniprésence de l’omerta qui règne sur l’existence de la violence carcérale
En effet, comme le dénoncent avocats, détenus, lanceurs d’alertes, directeurs d’établissements, : tous ceux qui seraient tentés de dénoncer des violences en tant que victimes ou témoins ont souvent plus à perdre qu’à gagner.
Pourquoi cette omerta ?
Parce que dans l’univers carcéral, les conditions de vie de travail, ou de survie de chacun dépendent d’un équilibre très précaire .. Un rien et tout dérape.
Aussi la cohésion entre surveillants d’une part, et entre détenus d’autre part, est-elle très forte car la survie de chacun, en prison dépend de son appartenance à un groupe, que l’on soit détenu ou surveillants. Dénoncer, c’est trahir et prendre alors le risque d’être en permanence s’exposé à des pressions, des humiliations, des représailles (comme le transfert ou le placement au quartier disciplinaire) (ces cas sont fréquents : cf prison de Liancourt en 2006)
Il est donc rare que les témoins se portent spontanément volontaires pour témoigner dans le cadre d’une enquête. Ces violences sont d’autant plus inquiétantes qu’elles s’accompagnent d’un sentiment d’impunité envers les auteurs de violences
Une impunité résultant d’une conjonction de facteurs
– Obtenir justice pour une personne détenue victime de violences relève d’un véritable parcours du combattant : il faut pouvoir déposer plainte, étayer les faits par un certificat médical, recueillir des témoignages ou des images de vidéosurveillance. Autant d’éléments faisant souvent font défaut puisque cela suppose de franchir des d’obstacles souvent impossibles à surmonter dans l’univers contraint et fermé de la prison.
Et une fois la plainte déposée, elle débouche le plus souvent sur des classements sans suite en raison de l’inertie du parquet -S’il n’existe pas de données officielles permettant d’objectiver la part de classements sans suite dans ce type d’affaires, tous les organes de contrôle s’accordent à dénoncer l’inertie de la justice, et en premier lieu celle du parquet. Dans la grande majorité́ des cas portés à la connaissance de l’OIP, les plaintes à l’encontre de faits de violence carcérale sont classées sans suite.
-Enfin si des sanctions sont néanmoins prononcées elles obéissent souvent au principe du « deux poids deux mesures ». On constate, en effet, que le détenu, même s’il a commis des infractions de moindre gravité écope de peines bien plus lourdes que le surveillant à l’origine des faits de violence.
Examinons à titre d’exemples certaines décisions (affichées)
Tribunal de Nîmes Décembre 2018 Un détenu, qui s’oppose à un placement en cellule avec des détenus avec lesquels il était en conflit, frappe un surveillant d’un coup de pied au visage. Sept mois de prison ferme.
Tribunal de Laval, janvier 2019 Un détenu de la maison d’arrêt est condamné à sept mois de prison ferme pour avoir menacé́ et insulté deux surveillants qui lui ont confisqué du cannabis.
Tribunal de Lyon, décembre 2018 Un surveillant de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas est reconnu coupable de violences pour avoir poussé́ et frappé au visage un détenu, avoir cogné sa tête contre un mur et s’être « placé à califourchon» sur lui une fois au sol pour le frapper il écope trois mois de prison avec sursis .
Tribunal de Metz, janvier 2018. Un surveillant de la maison d’arrêt de Metz-Queuleu déjà condamné en 2015 à Nancy pour violence aggravée est à nouveau condamné pour avoir frappé́ un détenu en avril 2018 six mois de prison avec sursis et une amende.
Pourquoi une telle carence et une telle clémence de la part des autorités judiciaire et pénitentiaires ?
Ces classements sans suite, cette clémence dans les sanctions s’expliquent par la crainte des magistrats de déstabiliser l’institution pénitentiaire dans son ensemble. Ce que craint par-dessus tout, l’administration pénitentiaire : déclencher un mouvement de grève parmi les surveillants pénitentiaires : une grève, s’inscrivant le plus fréquemment dans un contexte explosif, perturbe gravement le fonctionnement de la prison. Ce bras de fer entre les surveillants et leurs syndicats, d’une part et directeurs de prisons, d’autre part sont fréquents (cf exemples rapport OIP mars 2019)
La CGLPL en 2022 rappelle, en outre, que les traitements inhumains concernent aussi les surveillants. La prison est brutale du fait qu’il s’y trouve beaucoup de monde. « Je parlerai même dit-elle de mauvais traitements sur les surveillants. En 2004 de Toulouse-Seysses, un surveillant était prévu pour cinquante détenus. Actuellement, il y a un surveillant pour 156 détenus.
Surveillant de prison est un métier ingrat dévalorisé voire aliénant. Pour m’être entretenue parfois avec quelques surveillants je dirais qu’en la matière la meilleure volonté se heurte souvent à la réalité du choc carcéral tant les conditions de travail et de vie sont éprouvantes.
Néanmoins dans un souci d’objectivité il me semble important de pour nuancer le tableau accablant que je viens de dresser des prisons françaises.
3ème partie La France tente progressivement d’évoluer vers un meilleur respect des droits des détenus
A Une amélioration des conditions matérielles de détention
Le gouvernement tente de rénover et de moderniser son parc carcéral :
-Rénovation quelques exemples : prison de la Santé à Paris prison des Baumettes (photos).
-Politique d’extension du parc carcéral avec la construction de nouveaux d’établissements pénitentiaires se succèdent depuis Plan Chalandon en 1987 (13000 places) jusqu’au projet d’Emmanuel Macron lors de son premier mandat.
– création d’UVF (unité de vie familiale) ou de parloirs familiaux pour faciliter l’effectivité des droits familiaux dans les prisons françaises (cf photos)
B La justice comme rempart à l’arbitraire
Pour prendre le contre-pied du sentiment d’impunité et d’arbitraire évoqué précédemment je voudrais montrer le juge et législateur ont progressivement facilité la mise en cause de la responsabilité de l’administration pénitentiaire, pour atteinte aux droits fondamentaux des détenus.
Certes dès 1873 dans un arrêt célèbre Tribunal des Conflits Blanco (TC 8 février 1873 Blanco).
Le juge a reconnu la possibilité de mettre en cause la responsabilité de l’administration. Pourtant il faut dire que pendant plus d’un siècle la responsabilité de l’administration pénitentiaire n’a été que très rarement mise en cause.
En effet pour que l’administration voie sa responsabilité engagée il fallait que celle-ci commette une faute grave. D’autre part, le juge administratif rechignait à examiner et à remettre en cause des décisions des autorités pénitentiaires En les qualifiant de « mesures d’ordre intérieur » (M.O.I ) il estimait qu’elles étaient insusceptibles elles étaient insusceptibles de recours.
Ce régime de responsabilité administrative à l’avantage de l’administration prévalait également à l’égard de décisions disciplinaires prises au sein de l’école, de l’armée et des hôpitaux
Mais progressivement partir de l’arrêt Marie en 1995 le juge a reconnu progressivement la possibilité de contester les décisions disciplinaires prises dans les prisons et d’engager ainsi la responsabilité de l’administration.
Il admet que certaines de ses décisions sont susceptibles de recours parce qu’« elles font grief », c’est-à-dire qu’elles entrainent un préjudice pour le requérant.
Quelques exemples :
– CEDH 12 juin 2007 Frérot c. France : condamnation d’un directeur de prison pour refus d’acheminer son courrier à un détenu
– CE 30 juillet 2003 Garde des sceaux ministre de la justice ctre M Remli le juge a estimé que le placement « à l’isolement d’un détenu contre son gré est susceptible de recours car cette décision porte atteinte à ses droits fondamentaux
– CDHE 9 juillet 2009 Khider c. France , la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour traitements inhumains et dégradants sur un prisonnier qualifié de DPS (Détenu Particulièrement Surveillé) Khider avait été reconnu complice de la tentative d’évasion de son frère. Ses conditions de détention sont alors devenues intenables : régulièrement envoyé en cellule d’isolement, subissant continuellement des fouilles corporelles intégrales humiliantes, en 7 ans changement 14 fois de prisons La CEDH a condamné la France pour traitements abusifs.
– CEDH 4 février 2016 Reynolds La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour le suicide d’un détenu atteint de troubles psychiques et qui n’a pas pu recevoir son traitement parce que pendant 3 jours il avait été mis au quartier disciplinaire
-2007 CAA Nancy la cour administrative d’appels de Nancy a condamné l’administration pénitentiaire pour le suicide d’un détenu en raison d’une défaillance de l’organisation du service ; en effet les personnels n’ont pas pu accéder à la porte de la cellule car la nuit le surveillant d’étage n’avait pas accès aux trousseaux de clés ouvrant la porte de la cellule et le suicide n’a pas pu être évité
Enfin il serait erroné de penser que les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme ou les décisions de justice restent inefficaces. Pour preuve suite à l’arrêt J.M.B (CEDH 30 janvier 2020) le législateur en 2021 a instauré par la loi du 8 avril la possibilité pour tout détenu de saisir le juge pour les conditions indignes de détention. Désormais une fois saisi, le juge doit répondre dans les 10 jours et si l’indignité des conditions de détention sont reconnues l’administration doit trouver dans les 10 jours une solution pour faire cesser cette atteinte à la dignité.
CONCLUSION
J’espère que vous comprenez un peu mieux pourquoi s’expliquent les condamnations répétées de la France.
On comprend également le mot de Bernard Tapi à sa sortie de prison, qui déclare :
« Il n’y a pas de système répressif collectif parfait, mais je sais qu’on a choisi le plus mauvais, que la prison ne répond à aucun de ses objectifs affichés, et que dans sa pratique quotidienne, elle est une véritable honte pour le pays des droits de l’homme. »
Tous les rapports émanant du Contrôleur Général des lieux privatifs de liberté, de l’Observatoire international des prisons, de la Commission nationale consultative des droits de l’homme évoquent de nombreuses pistes de réforme pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale et mettre fin aux conditions de détention indignes pour lesquelles la France est régulièrement pointée du doigt par la communauté internationale.
Cependant toute solution pérenne à cette situation suppose de repenser dans son ensemble l’institution pénitentiaire ms également l’institution judiciaire. Il s’agit également de s’interroger sur la pertinence de l’incarcération, en privilégiant toujours davantage les peines alternatives à l’emprisonement .
A la lecture des recommandations figurant les rapports successifs des autorités on n’est tenté de penser, qu’à priori leur mise en œuvre semble si simple… vu de l’extérieur….
Pourtant, une fois à l’intérieur des murs, on comprend pourquoi les rouages de l’univers carcéral représentent une force d’inertie incroyable à toute réforme d’envergure et on comprend également pourquoi le choc carcéral a souvent raison de la meilleure bonne volonté.
Bibliographie
CHAPLOTTE Claire : « La personne détenue un usager protéiforme » mémoire Master 2- Institut de droit et Économie -Agen- 2018.
JEGO Alain : « Les conséquences de la surpopulation en détention » AJP – 2018
Observatoire International des Prisons : « Omerta, opacité, impunité : enquêtes commisses par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues » -Mai 2019
MUCCHUIELLI Laurent « Violences et insécurité fantasmes et réalités dans le débat français »- La découverte – 2002
TULKENS Françoise « Prison et santé mentale. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » Justice et santé mentale Vol 48 Presse université de Montréal -2015
Commission nationale consultative des droits de l’homme « Avis sur l’effectivité des droits fondamentaux en prison »-Mars 2022
CEDH Guide sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme « Droits des détenus » 31 Aout 2021-Strasbourg
Du taylorisme aux groupes semi-autonomes. Angélique Gomes-Samaran. 23-05-22.
Du taylorisme aux groupes semi-autonomes
Angélique Gomes-Samaran
« Vous avez dit anthropocène ? Regard sur la place Saint-Sernin ». Philippe Sierra. 09-05-22.
Brouwer : Le Dr Jekyll et Mr Hyde des mathématiques. Jean-Christophe San Saturnino. 21-04-22.
Brouwer : Le Dr Jekyll et Mr Hyde des mathématiques
Jean-Christophe San Saturnino.

Bonjour à tous, merci. C’est un plaisir d’avoir été introduit par un philosophe, cela renforce les liens millénaires entre philosophie et mathématique.
Brouwer, mathématicien du XXe siècle, le Dr Jekyll et Mr Hyde des mathématiques. Je commencerai par quelques repères biographiques pour vous présenter un peu le « personnage » plein de mystères. Nous verrons par la suite le théorème du point fixe, un de ses travaux les plus exceptionnels en topologie générale et deux applications extrêmement surprenantes, comme vous le verrez. Enfin nous parlerons de sa théorie intuitionniste avec le refus du tiers-exclu avec les conséquences que cela peut avoir philosophiquement et mathématiquement parlant.
Brouwer naît aux Pays-Bas dans la banlieue de Rotterdam en 1881. Il se lance dans des études mathématiques à l’université d’Amsterdam. Vous remarquerez qu’il avait seulement 16 ans quand il est rentré à l’université (il était évidement précoce mathématiquement parlant comme beaucoup de matheux). En 1905, il publie « vie, art et mysticisme » un opuscule extrêmement provocateur dans lequel il va parler de son désamour pour le progrès scientifique et prône le retour à la nature. Cela est extrêmement surprenant pour un scientifique car il explique que le progrès ne sert à rien, il met en avant son caractère bien particulier, bien trempé. Il écrit ce texte très jeune et avant sa thèse.
En 1907, il devient docteur en mathématiques. Dans sa thèse de doctorat, il se permet de donner ses points de vues philosophiques sur la mathématique s’opposant clairement aux mathématiques classiques et notamment au platonisme dont on parlera plus tard.
En 1909, il part à Paris et rencontre Hadamard, Poincaré et Borel. Pourquoi parler de cette rencontre ? Elle est en fait extrêmement importante: déjà pour mettre en avant l’école française de géomètres très influente au début du XXe siècle. De plus cette école française est aussi appelée l’école des pré intuitionnistes ou constructivistes qui vont grandement l’inspirer pour ses travaux futurs. Remarquons aussi que Poincaré est un grand spécialiste de la topologie combinatoire que l’on appelait « annalysis situs » et qui va inspirer les futurs travaux de Brouwer. En 1911, il publie le théorème du point fixe, le théorème qui nous intéresse. Très rapidement après sa thèse, il développe toute une théorie topologique générale avec laquelle il va notamment démontrer le théorème du point fixe, l’invariance de la dimension, le théorème de la boule chevelue (je vous en parlerai plus tard).
En 1912, il est nommé professeur à l’université d’Amsterdam. Son premier cours inaugural n’a rien à voir avec ses travaux de topologie, il s’engage de suite dans l’intuitionnisme et contre le formalisme qu’il va immédiatement critiquer. Il ne fera en fait jamais cours de topologie dans sa vie.
En 1928, il est exclu du conseil éditorial des Mathematische Annalen par Hilbert. Les mathématiques avancent sous forme de publication, il faut publier pour être reconnu, Brouwer était dans un comité éditorial, ce comité était dirigé par Hilbert, Hilbert était un formaliste, Brouwer était un intuitionniste, Einstein disait que c’était la bataille des rats et des grenouilles, cela a finit par le fait que Hilbert exclu Brouwer de ce conseil. Il va créer sa propre revue Compositio Mathematica, très réputée parmi les mathématiciens. Malheureusement, il sera exclu de sa propre revue car le personnage étant particulier, il aura une indulgente neutralité envers l’occupant nazi durant la guerre et n’aura aucun souci lorsqu’un de ses élèves juifs sera déporté. Il décède le 2 décembre 1966 à Blaricum, c’était son fief, le château duquel il ne sortait jamais. Il n’était pas intéressé par le reste de la société. Remarquez cette photo de lui faisant cours, il avait pour habitude de faire cours debout, dans un silence de cathédrale et il ne fallait surtout pas l’interrompre. Il aimait réfléchir seul, dans sa chambre allongé sur son lit ou assis parterre en tailleur. Il vivait dans le monde des idées, fait qui est très important pour comprendre sa philosophie intuitionniste.
Pour parler du théorème du point fixe commençons par un théorème que tous les lycées connaissent bien surtout les élève de terminale, le théorème des valeurs intermédiaires. On dispose d’une fonction continue sur un segment, elle part d’une valeur négative, arrive vers une valeur positive, elle va donc passer plusieurs fois par l’axe des abscisses, c’est-à-dire qu’il va y avoir plusieurs zéros, il va exister au moins un réel dans le segment qui va annuler la fonction. À partir de ce théorème on peut en déduire le théorème du point fixe sur un segment. Prenons une fonction f définie sur un segment [a,b] et à valeur dans un segment, continue, considérons la fonction f(x)-x pour x dans le segment. Elle est toujours continue sur le segment. On remarque que f(a) est positif, f(b) est négatif, d’après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une valeur dans le segment qui annule la fonction définie par f(x)-x et donc l’image par f de cette valeur est égale à elle même, c’est un point fixe de la fonction f.
Avec un schéma, la courbe représentative de f se trouve dans un carré: que veut dire le fait que f ait un point fixe ? Cela veut dire que la courbe rencontre au moins une fois la diagonale du carré. L’utilité de ce théorème pour nos élèves de terminale est pour les suites définies par récurrence à partir de la fonction f. Si la suite converge, elle le fera vers un point fixe.
Essayons de généraliser le théorème du point fixe qui dit, en dimension 1, qu’une fonction continue sur un segment à valeur dans ce segment admet au moins un point fixe, c’est-à-dire un point qui est sa propre image, il est invariant par f. En dimension 2, l’équivalent du segment est un disque fermé et en dimension 3 ce sera une boule fermée. En toute généralités, le théorème du point fixe s’énonce comme suit: soit f une fonction continue d’une boule fermée d’un espace euclidien (notre espace géométrique habituel, un espace vectoriel réel de dimension finie muni d’un produit scalaire) dans elle-même admet un point fixe. Pourquoi avoir mis une image de café ? Parce que Brouwer a dit que c’est un matin en remuant son café qu’il a eu l’idée de son théorème, il s’est rendu compte q’un point ne bougeait jamais. en fait votre tasse de café peut être assimilée à une boule fermée d’un espace euclidien et donc tous les matins quand vous remuez votre café vous appliquez le théorème du point fixe et un point ne bouge pas ! C’est formidable ! Première application surprenante mais il y en a bien d’autres !
Le théorème de la boule chevelue s’énonce ainsi: tout champs de vecteurs continu sur une sphère de dimension paire s’annule une fois au moins. Ce qui est beau avec les mathématiques c’est que cela paraît toujours mystérieux mais cela ne l’est pas vraiment. Un champs de vecteurs continu revient à se donner en chaque point de l’espace une petite flèche, un vecteur en fait. Contrairement à ce que l’on s’imagine parfois au lycée, les vecteurs ne sont pas répartis n’importe où dans le plan, ils partent tous d’un même point fixé, mais ici c’est le cas puisque l’on considère un champs de vecteurs. Par exemple sur une boule je mets des cheveux, attention on prend bien une boule car sa surface est une sphère de dimension 2, sur un cercle ce n’est pas possible car de dimension 1. Dire que le champs de vecteur s’annule au moins une fois veut dire que je ne peux pas peigner la boule, il y a toujours un épi ! Ce théorème veut dire que le matin vous ne pourrez pas vous peigner parfaitement, vous aurez toujours un épi ! C’est surprenant, on ne s’attend pas à ce que les mathématiques puissent influer sur notre coiffure ! N’essayez pas de supprimer votre épi, c’est impossible !
Il y a bien sûr d’autres applications plus utiles du théorème de la boule chevelue notamment en météorologie. On a tous vu à la météo les vents représentés par des flèches, ce sont des champs de vecteurs continus sur la surface de la terre qui est assimilable à une sphère de dimension 2 et donc le théorème nous dit qu’il existe sur la surface de la terre un point sans vent ! C’est quelque chose que l’on a l’habitude de voir avec les cyclones et en particulier avec l’œil du cyclone qui est un point sans vents.
Le théorème du point fixe a une autre application totalement surprenante en théorie des jeux et dans les équilibres de Nash. Un jeu est constitué de deux joueurs, chaque joueur choisit une stratégie, les stratégies sont en nombre fini et permettent chacune d’obtenir un gain. Un équilibre de Nash est une combinaison de stratégies où chaque joueur maximise son gain en fonction du choix des autres et ne change plus de stratégie. Attention, un équilibre de Nash n’est pas forcément un équilibre optimal, je ne cherche pas à gagner le maximum mais plutôt à jouer le mieux possible face aux adversaires. Le théorème de Nash dit que tout jeu fini en stratégie mixte admet un équilibre de Nash. Qu’est-ce qu’une stratégie mixte ? Par exemple, j’ai l’habitude de souvent jouer à shifumi avec mes élèves de terminale, c’est un jeu sans équilibre de Nash, c’est en fait un jeu un peu idiot mais on peut le rendre plus intéressant en rajoutant des probabilités, on tire au hasard avec probabilité d’un tiers ce que l’on va jouer, cela devient un jeu de stratégie mixte et il admet alors un équilibre de Nash. Un équilibre de Nash n’est en fait qu’un point fixe pour une fonction continue.
Avant d’appliquer ceci à la crise des missiles de Cuba, je vais vous expliquer un jeu auquel je joue régulièrement avec mon vélo: c’est le jeu du poulet (ou de la poule mouillée). Si vous m’avez déjà vu arriver avec mon vélo j’ai tendance à aller toujours tout droit, ne jamais dévier. Je fais cela car je connais mon théorème du point fixe, je sais que l’autre en face va se pousser… Le jeu de la poule mouillée est le suivant: vous prenez deux personnes dans deux voitures différentes, l’une face à l’autre, elles se foncent dessus, le premier qui dévie sa trajectoire est un lâche. Il y a plusieurs options: soit les deux se rentrent dedans, il y a une grande perte des deux côtés ou alors les deux dévient mais ils se transforment en lâches tous les deux ou bien un dévie et l’autre gagne. C’est ce que je pratique avec mon vélo, j’ai tendance à ne pas dévier, c’est souvent l’autre en face qui se dévie, sauf quand j’ai une voiture de face, en général c’est moi le lâche…
La crise des missiles de Cuba peut être modélisée exactement de la même manière. Jouons avec l’URSS et les USA. Le contexte est le suivant, l’URSS a mis des missiles à Cuba et menace les USA de très près. Ceci n’a pas plût aux USA et il doivent riposter. Il y a plusieurs possibilités:
– Première possibilité: les USA mettent en place un blocus (option défensive), la réponse idéale pour l’URSS est le maintient (option offensive).
– Deuxième possibilité les USA choisissent la frappe (option offensive), la réponse idéale pour l’URSS est de rappeler les missile (option défensive).
De même, si l’URSS décide de maintenir les missiles (option offensive), la réponse idéale pour les USA est le blocus (option défensive) et si l’URSS décide de retirer les missiles (option défensive) la réponse idéale pour les USA est de frapper (réponse offensive).
Par réponse idéale on entend la moins coûteuse, celle générant le moins de pertes. L’équilibre de Nash, le point fixe pour ma fonction, est la stratégie attaque/défense, l’un doit attaquer et l’autre subir, ainsi de suite… L’équilibre est ainsi créé et encore maintenant avec la guerre en Ukraine, la stratégie attaque/défense est celle qui créée un équilibre pour les deux parties.
Il se trouve que plusieurs équilibres de Nash sont possibles mais pas toujours optima, les équilibres sont parfois surprenants, on peut modéliser la guerre froide en terme de théorie des jeux. Les différentes possibilités sont: l’attaque, l’armement nucléaire ou l’immobilisme. Un des équilibres de Nash est que les deux pays s’arment sans jamais s’attaquer (c’est ce qui historiquement s’est passé) mais un équilibre de Nash plus surprenant est que les deux pays s’auto-détruisent.
Tout ce que l’on vient de raconter est la face claire de Brouwer, topologie générale, théorème du point fixe, étude des formes, etc… Brouwer va repartir dans ses travers intuitionniste et développer une philosophie qui est à l’opposé totalement des mathématiques classiques et qui va remettre en cause tout ce qui a été créé pendant des millénaires.
Le XIXe siècle marque, en mathématique, la découverte des nouvelles géométries ne vérifiant pas l’axiome des parallèles. La seule géométrie n’est pas celle du « plat », celle que l’on rencontre tous les jours (la géométrie euclidienne) mais il y a aussi ce que j’appelle les géométries de la cuillère: quand on regarde une cuillère, elle a un côté bombé (c’est un modèle de géométrie sphérique) et un autre creusé (c’est un modèle de géométrie hyperbolique). On se rend bien compte que nos visages ne sont pas reflétés à plat, ils sont déformés, remarquons aussi que dans ces cas-là, la somme des angles d’un triangle ne vaut pas 180 degrés mais peut être supérieure ou inférieure. Les mathématiciens se rendent rapidement compte qu’il faut fonder les mathématiques sur des bases solides, notamment de construire l’ensemble des nombres réels correctement. Cantor introduit la théorie des ensembles qui vont servir à Hilbert à fonder les mathématiques. Malheureusement, de nombreux paradoxes vont apparaître comme par exemple le paradoxe du barbier.
Vont alors se développer plusieurs philosophies, une des principales est le logicisime avec Frege et Russell. Pour eux, les mathématiques sont uniquement fondées sur des implications logiques, tout est une grande tautologie, on enchaîne les symbole jusqu’à arriver à des théorèmes. C’est comme une machine à faire des saucisses, on fait tourner et les saucisses (ou théorèmes) sortent prêtes.
Une autre philosophie est le formalisme représenté par Hilbert. Il propose de poser les mathématiques de manière axiomatique, on ne s’intéresse pas à la nature des objets ce qui est important ce sont les axiomes qu’ils vérifient. On peut appeler une droite ou un cercle comme l’on veut, par exemple stylo ou choppe de bière (Hilbert lui-même parle de ce choix de nom !).
Il y a bien sûr d’autres philosophies mathématiques comme le structuralisme développé par Bourbaki, mais nous n’en parlerons pas dans cet exposé.
La philosophie dominante jusqu’au XIXe siècle est le platonisme, qui suppose la pré existence des objets mathématiques dans les « cieux ». Pour Brouwer, les mathématiques ne sont pas du tout cela, c’est un acte de la pensée, c’est une réflexion intérieure, individuelle. Cet acte de pensée est forcement pollué par le langage, la logique, etc… L’intuition fondamentale de passé et de futur est celle qui va être à la base de la construction des nombres naturels, etc… On ne peut pas attraper l’infini mathématique par quelques axiomes en nombre fini ou quelques relations logiques. Ainsi, tout objet mathématique doit être construit dans la pensée pour exister, c’est ce qui va être fondamental dans la philosophie de Brouwer. Cela pose un problème car les nombres réels sont des limites de suites de rationnels… Pour Brouwer un nombre infini dont on ne connaît pas toutes les décimales n’existe pas. L’ensemble des réels qui est, dans les mathématiques classiques, un ensemble complet va comporter pour Brouwer des trous. Le théorème du point fixe va être faux alors qu’il l’a lui-même démontré. Toutes les fonctions vont être continues… tout cela va poser beaucoup de problèmes.
Tout ceci étaient des conséquences philosophiques, voyons quelques conséquences mathématiques.
Comme je viens de le dire, tout les objets doivent être construits. Or au début du XXe siècle la mode était à la construction d’objets de manière existentielle, c’est-à-dire que je démontre l’existence d’un objet sans le construire réellement, avec par exemple une démonstration par l’absurde. Ceci est impossible pour Brouwer. Les démonstration par l’absurde ne sont donc pas autorisées. Il faut donc abandonner le principe du tiers-exclu car les démonstrations par l’absurde reposent sur ce principe.
Expliquons le principe du tiers-exclu: « to be or not to be », il y a deux possibilités: « être » ou « ne pas être ». Appelons A l’assertion « être » et non A l’assertion « ne pas être », sa négation. Notons V la conjonction « ou », alors je peux résumer la fameuse phrase de Shakespeare par A V non A. Ceci a tout de même de l’importance car les Néerlandais ont fait un timbre à l’effigie de Brouwer avec A V non A. Le principe du tiers exclu stipule que A V non A est toujours vraie, soit une assertion est vraie, soit son contraire est vraie.
Pour mettre en place les mathématiques intuitionnistes, il a malheureusement fallut faire appel à la logique, chose que Brouwer n’acceptera jamais vraiment puisque pour lui les mathématiques restent dans l’esprit et ne peuvent pas être fixées par la logique. Un de ses élèves, Heyting, va développer la logique intuitionniste en abandonnant un des principes de Brouwer, celui de ne pas utiliser la logique… La logique intuitionniste ne se pose pas la question de savoir si un énoncé est vrai ou faux mais plutôt s’il est démontrable ou pas. Tant qu’un énoncé n’est pas démontré, on ne sait pas s’il est vrai ou faux et donc on ne peut pas l’utiliser. Il faut également fournir une construction de tout objet.
Hilbert était terrorisé par l’intuitionnisme et proposa de montrer que sa philosophie formaliste était le meilleur des possibles et proposa un programme pour démontrer, qu’à partir d’un nombre fini d’axiomes, qu’une théorie est cohérente (on ne peut pas montrer quelque chose et son contraire) et complète (c’est à dire que tout peut être démontré). Malheureusement Gödel mit fin à son programme en démontrant qu’il existe des propositions qui sont vraies mais indémontrables et pire, qu’au sein d’une théorie contenant l’arithmétique, on ne peut pas démontrer qu’elle est cohérente. En mathématique, on ne sait pas si un jour on ne tombera pas sur une contradiction, mais ce n’est pas grave, on rajoutera un axiome qui réglera notre problème, cela fait des millénaires que l’on pratique les mathématiques sans trop de contradictions…
Les mathématiques intuitionnistes sont trop contraignantes, il faut abandonner trop d’objets confortables. Par exemple, le théorème des valeurs intermédiaires vu au début nous dit que toute courbe représentative d’une fonction continue correctement choisie traverse l’axe des abscisses mais pour les intuitionnistes, la question qui se pose est: où traverse-t-on ? Un nombre réel étant une limite de nombres rationnels, je ne peux pas construire ce nombre réel, en un nombre fini d’étapes je ne pourrai pas connaître sa valeur, le théorème des valeurs intermédiaires est donc faux en théorie intuitionniste.
Malgré tout certains objets mathématiques du lycée ont une logique sous jacente intuitionnistes comme les intervalles ouverts de IR avec réunions et intersections. On travaille en fait régulièrement avec ces objets qui sont intuitionnistes, ce sont des objets pour lesquels le principe du tiers exclu n’est pas vérifié
Les mathématiques aujourd’hui peuvent se fonder sur la théorie des catégories et des topos et la logique sous-jacente de la théorie des topos est intuitionniste. Cette logique est comme nôtre logique classique habituelle mais il suffit d’assouplir les règles (comme on a vu dans l’exposé mathématique précédent) et de juste renoncer au principe du tiers-exclu. On obtient une logique différente mais qui fonctionne et qui permet de fonder toutes les mathématiques.
La logique intuitionniste a été utile car elle a donné naissance au lambda-calcul qui est important dans des problèmes de calculabilité en informatique et dans des démonstrations assistées par ordinateur comme pour le théorème des quatre couleurs (qui dit qu’il suffit d’utiliser quatre couleurs pour colorier un planisphère).
L’objet du grenier n°2 – L’Omphale de plâtre. Marie Perny. 19-04-22.
L’objet du grenier n°2 – L’Omphale de plâtre
Marie Perny
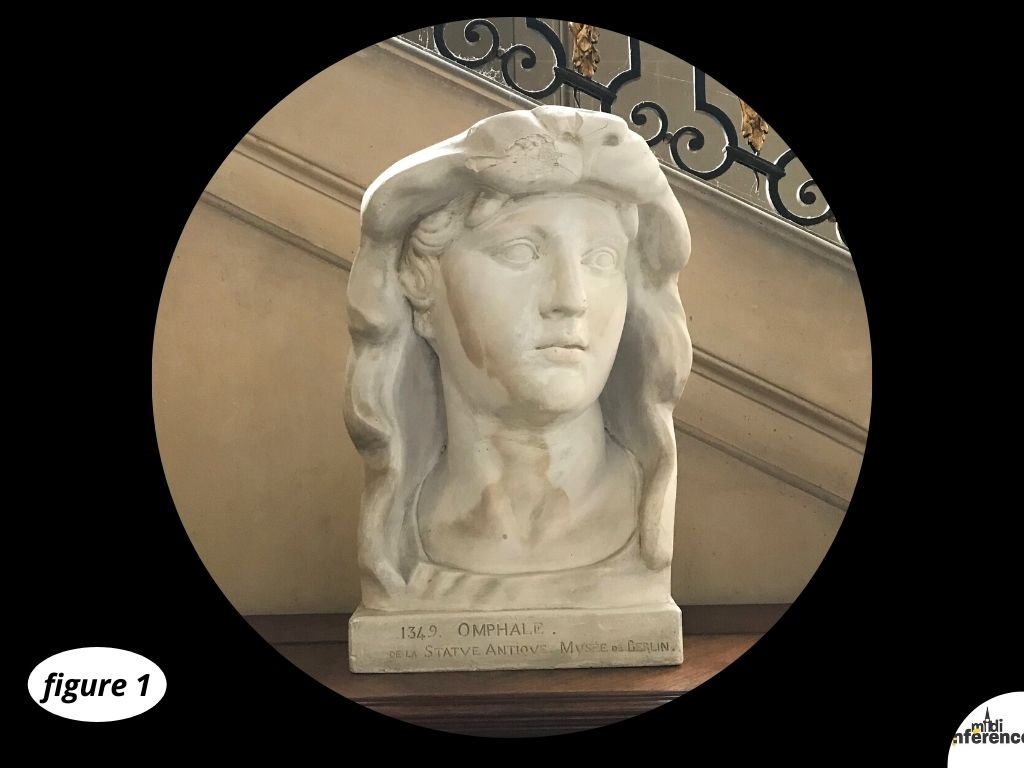
Cette deuxième conférence que j’ai le plaisir de vous donner nous entraine de nouveau dans le grenier pédagogique de notre établissement, pour en dénicher les secrets et les curiosités qui le rendent à la fois singulier et représentatif de l’histoire de l’éducation, et plus précisément celle des filles.
S’il n’y avait pas eu la première conférence sur l’équilibriste et les objets scientifiques de la fin du XIXe siècle, j’aurais été obligée de vous rappeler que notre lycée ouvre en 1884, que c’est alors le premier lycée public pour filles de Toulouse et qu’il suit l’application de la loi de 1880 qui crée les tout premiers lycées publics pour filles en France. J’aurais également du expliquer que l’enseignement secondaire n’était pas la continuité de l’enseignement primaire et que l’un et l’autre formaient deux mondes séparés : le primaire était l’école des classes populaires et des masses et concernait des élèves jusqu’à l’âge de 16 ans tandis que le secondaire était l’école de la bourgeoisie, que seuls 5% d’une classe d’âge allait au lycée au XIXe siècle et jusque dans les années 1930.
Peut-être vous est-il arrivé de faire cette expérience alors que vous gravissiez ou descendiez l’escalier d’honneur de l’hôtel Dubarry : éprouver la sensation d’y être observé silencieusement. Pas étonnant, vu le nombre de fantômes qui ont du y élire résidence au fil des siècles. Mais en regardant autour de soi, on peut remarquer sur un piano d’ornement, silencieux depuis longtemps, un buste au regard oblique (figure 1).
Examinons tout d’abord l’objet qui a, il faut le dire, assez belle allure. A première vue il s’agirait d’un buste, que l’on pourrait penser en marbre. La pose est altière, le profil grec, l’ensemble est assez noble. Si l’on s’approche davantage, deux détails intriguent : la trace d’un mufle de lion et de deux crocs sur la tête du personnage. Aurions-nous affaire à une représentation d’Hercule ? Mais une inscription sur le socle nous indique trois éléments : 1349 – Omphale – Musée de Berlin (figure 2).

Trois indications qui sont autant d’énigmes : à quoi correspond ce numéro ? Sans doute à un numéro d’inventaire, mais de quoi ? Musée de Berlin : c’est le signe que nous sommes face à une copie d’un original, situé dans un musée de Berlin – soit, mais lequel ? Omphale ? Omphale était une reine de Lydie chez qui Héraclès – ou Hercule – a du passer quelques temps à la demande d’Apollon pour expier un crime. Subjugué par elle, il est son esclave et se soumet à tous ses désirs, jusqu’à lui donner la peau du lion de Némée et sa massue, emblème de sa force. L’auteur latin Lucien de Samostate écrit : « Tandis qu’Omphale, couverte de la peau du lion de Némée, tenait la massue, Héraclès, habillé en femme, vêtu d’une robe de pourpre, travaillait à des ouvrages de laine, et souffrait qu’Omphale lui donnât quelquefois de petits soufflets avec sa pantoufle ».
C’est donc une histoire d’inversion des genres et des relations entre homme et femme, de subversion des normes établies entre les genres, qui a pu faire frémir dans la tragédie grecque de Sophocle Les Trachéniennes ou faire rire les Romains du premier siècle à la lecture d’Ovide. Pensez donc, le grand héros Hercule, filant la laine…
L’irruption de cette Hercule au féminin dans notre lycée m’a ravie. En effet, l’ouverture des lycées publiques pour filles à partir de 1880 a entraîné toute une série de réactions manifestant les craintes de voir la place traditionnelle des femmes bouleversée et avec elle, la société toute entière.
Ainsi, un journal conservateur toulousain écrivait en janvier 1884 qu’il « est à craindre (…) qu’il ne sorte de ces lycées, sans parler d’une catégorie nouvelle d’insupportables pédantes (…), tout un clan de libres penseuses et aussi (…) de libres non-penseuses » alors qu’un journal satyrique parisien dessinait en août 1884 le produit à venir de ces lycées sous la forme d’une femme au comportement masculin délaissant sa machine à coudre (figure 3)…

J’y ai vu comme un clin d’oeil de l’histoire : cette Omphale, présente dans les registres du mobilier du lycée depuis 1884, rappelait qu’elle avait su dompter le grand Hercule, de même que les lycées de filles ont su s’imposer définitivement dans le système éducatif secondaire français.
Mais l’objet conservait sa part de mystère. Et d’abord, de quel objet parle-t-on ? D’une copie d’un original inconnu. Et cette copie est en plâtre. Et ce n’est pas un buste, mais un masque. Notre Omphale sonnait donc creux et pourtant elle restait à démasquer.
Afin d’élucider son mystère, rassemblons tous les indices à notre disposition.
Notre Omphale fait partie de toute une collection de modèles en plâtre : d’autres qui lui ressemblent sont tapis ici et là dans le lycée, essentiellement en Dubarry à l’exception d’un qui est au CDI.
Nous disposons aussi du contenu des registres d’inventaires du mobilier utilitaire et pédagogique du lycée à son ouverture et pendant les deux premières décennies de son développement.
Enfin, nous conservons trois beaux registres contenant des travaux d’élèves : une centaine de dessins datant de 1909 (rassemblés pour les 25 ans du lycée) et deux autres de 1924, pour l’anniversaire des quarante ans de l’établissement.
A partir de ces éléments, menons l’enquête à la découverte de l’enseignement du dessin dans un lycée de la fin du XIXe et au début du XXe siècle, car il s’agit bien d’un objet pédagogique que cette Omphale de plâtre.
1. La collection des modèles de plâtre du lycée :
Notre modèle fait partie d’une collection dont quelques rares spécimens sont encore conservés au lycée : neufs moulages de plâtre, de tailles variables, sur des époques et des sujets différents, qui décorent les salles de l’hôtel Dubarry et le comptoir de prêt du CDI (figure 4).

La consultation de l’inventaire du mobilier pédagogique des vingt premières années du lycée permet d’établir que la collection complète comptait 126 modèles en plâtre. Parmi ceux-là, deux seulement font partie de ceux qui ont été conservés. Les sept autres ont du être acquis après 1900, ce qui laisse supposer qu’il y avait plus de 130 modèles en tout au moment où la collection était à son plein épanouissement.
Par ailleurs, notre lycée s’est installé dans les locaux d’une ancienne pension privée, rachetée par la municipalité de Toulouse en 1882 : les locaux et le mobilier sont achetés ensemble. Parmi ce mobilier, il est mentionné 60 modèles de plâtre pour le dessin, sans que l’on sache lesquels. Notre collection est donc assez hétéroclite.
Aucun des plâtres dont nous disposons ne possède d’estampille de l’atelier qui l’a réalisé. Les inventaires ne mentionnent pas le nom du fournisseur.
Le numéro indiqué sur le socle de notre Omphale renvoie au catalogue de l’atelier des moulages de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, fournisseur officiel de tous les établissements scolaires de France. Cet atelier avait le droit de reproduire quelques pièces de musées européens (notamment anglais, allemands et italiens) : notre objet en est la manifestation.
Il y a eu à la fin du XIXe siècle une dotation nationale et centralisée de modèles de plâtre, pour uniformiser les pratiques du dessin dans les établissements scolaires, nous y reviendrons.
2. L’enseignement du dessin : une discipline du tronc commun des lycéennes.
Le dessin est rendu obligatoire dans l’enseignement primaire et secondaire au moment où se constitue l’école républicaine au tournant des années 1880 sous la IIIe République.
Le dessin a néanmoins été l’objet de nombreux débats dans l’enseignement depuis la fin du XVIIIe siècle et ses objectifs ont été précisés pendant le Second Empire, en lien direct avec l’industrialisation : ainsi le ministre Victor Duruy a pu écrire en 1865 que « le dessin était l’écriture de l’industrie ».
D’un point de vue pédagogique, les instructions officielles insistent sur l’exercice d’observation et de précision de l’oeil et de la main que le dessin représente, ainsi que le goût du travail précis et bien fait qu’il encourage. Comme dans beaucoup d’autres domaines touchant l’école, c’est une prise en compte complète de tous les aspects de l’enseignement du dessin qui est réalisée par la IIIe République : les méthodes d’enseignements, les cursus par types de classes et d’établissement, le mobilier, l’aménagement des classes, les supports pédagogiques, mais aussi la formation des enseignants et la mise en place d’un corps d’inspecteurs. L’enseignement du dessin devient donc une « affaire d’Etat » (cf article de R. d’Enfert).
Le dessin est obligatoire au lycée, tant pour les garçons que pour les filles. Pour ces dernières, il est dans le tronc commun pendant les trois premières années du cursus (qui en compte 5) et devient facultatif pour les deux dernières années d’études. Il est évalué à l’examen du certificat d’études secondaires, qui est passé à la fin de la 3e année, parmi 12 matières.
La IIIe république harmonise la formation et le recrutement des professeurs de dessin, qui sont reconnus par un certificat d’aptitude à l’enseignement, contrôlé par le Ministère. Ils sont rémunérés par l’Etat et non sur les moyens des établissements comme c’était le cas auparavant.
Au lycée de filles de Toulouse, il n’y a pas de professeur permanent entre 1884 et 1893, mais un ou deux professeurs extérieurs à l’établissement, dont M. Maurette, professeur aux Beaux-Arts de Toulouse.
A partir de 1893, une professeure titulaire est nommée : c’est une débutante, elle s’appelle Mademoiselle J. Lapasset, et va faire toute sa carrière dans ce lycée jusqu’à sa retraite en 1934. M. Maurette continue à donner quelques heures jusqu’en 1898 et une deuxième professeure de dessin, Mlle M. Sauvagnat, est nommée en 1906 (elle reste elle aussi jusqu’à sa retraite en 1938). L’enseignement du dessin est donc assuré pendant 40 ans par un personnel très stable, deux professeurs, pour un effectif allant de 500 à 1000 élèves sur la période.
De même qu’il existait des salles d’enseignement des sciences et d’enseignement de la musique, l’enseignement du dessin dispose d’une salle de classe spécifique.
Des consignes officielles précises sont données pour les aménager. Au lycée de Toulouse, la question des bâtiments a été pendant longtemps problématique : il s’est développé dans des locaux pré-existants et a été l’objet de constants remaniements, effectués toujours dans l’urgence de répondre au nombre sans cesse croissant des élèves face à l’exiguïté des lieux. Plusieurs grands projets d’envergure ont été conçus pour bâtir un lycée neuf et spacieux, mais les deux guerres mondiales y ont mis à chaque fois un coup d’arrêt, avant les travaux décisifs des années 1950 et 1960.
Sur les plans, difficile de trouver la salle de dessin qui n’est jamais indiquée en tant que tel.
Un registre du mobilier des dix premières années du lycée fait l’inventaire de la salle de dessin : 80 grands tabourets et 80 petits (adaptés aux élèves), seulement 5 tables de dessins, plusieurs planches murales anatomiques et représentant des dessins. Le lycée a également récupéré des chevalets et 6 portes-modèles de la pension privée qui occupait avant les locaux.
Si nous ne disposons pas de photographies de la salle de dessin à une quelconque époque, du moins pas à ma connaissance, nous en avons des… dessins réalisés par les élèves, issus des registres de 1924 (figure 5).
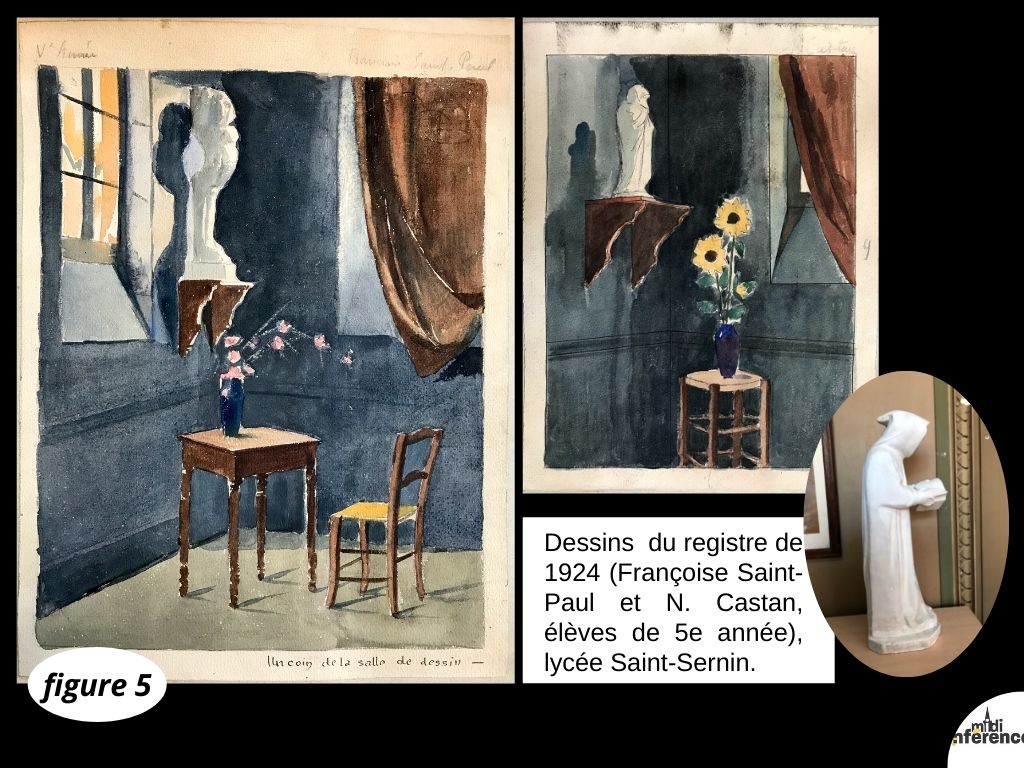

La salle était vraisemblablement à l’étage donnant sur la rue (Gramat ou Gatien-Arnoult ?), des rideaux aux fenêtres permettaient de choisir et de canaliser la source de lumière qui allait sur le modèle de plâtre installé en hauteur sur une tablette murale. Les élèves devaient être disposées tout autour pour le dessiner sous un angle précis.
Cet aperçu est conforme avec les photographies d’autres établissements scolaires qui existent (figure 6).
Par ailleurs ce dessin permet d’appréhender deux méthodes d’enseignement.Il représente un modèle de plâtre et un modèle « vivant » (un bouquet de fleurs fraîchement coupées), le tout dans une scène d’intérieur représentée en couleur. On voit ici autour d’un même objet la méthode dite géométrique et celle dite intuitive, deux méthodes dont il va être question.
3. La pédagogie du dessin : dessin géométrique et d’imitation face à la méthode intuitive
L’apprentissage du dessin comme celui d’une langue et d’une science :
Dès le Second Empire et particulièrement dans la mise en œuvre de l’école républicaine, il a fallu construire le dessin en tant que discipline d’enseignement pleine et entière, sérieuse et légitime, avec ses règles, sa langue et une progression encadrée.
Dans l’ouvrage fondamental autant que passionnant qu’est le Dictionnaire de Pédagogie dirigé par Ferdinand Buisson entre 1879 et 1887, l’article « Dessin » comporte 60 colonnes de textes (contre 35 pour l’article « Lecture »), signe du soin porté à la question. L’un des deux auteurs de l’article, Eugène Guillaume, directeur des Beaux-Arts de Paris et inspecteur général de dessin à la tête des 17 inspecteurs nommés en 1879, combat avec force l’idée selon laquelle le dessin ne relèverait que du sentiment et défend une pratique scientifique et exacte, qui exclurait les approximations.
Un cadre institutionnel uniformisé est alors déroulé par les programmes scolaires, avec le détail des méthodes et des modèles à copier. Une collection officielle est attribuée à chaque établissement scolaire, avec essentiellement des modèles en relief venant des ateliers de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Ces dotations de tous les établissements représentent un investissement important de l’Etat. Les lycées sont ceux qui reçoivent les collections les plus fournies.
Les modèles sont répartis par niveau et associés à une progression allant des formes les plus simples aux plus complexes : sont abordés successivement les formes géométriques, les frises et rosaces, les éléments du corps humains, puis les figures les plus complexes animales et humaines, jusqu’aux figures entières (figure 7).
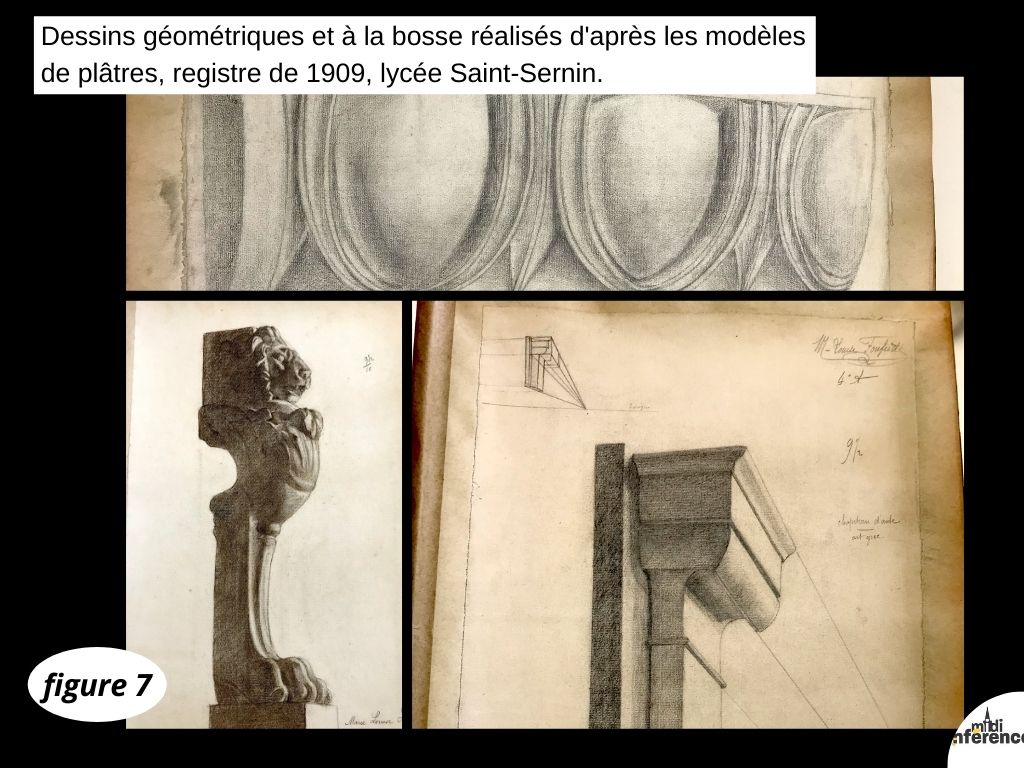
Notre Omphale figure au programme de la 3e année du lycée du cursus des filles. Il faut noter que la collection du lycée dispose de quasiment tous les modèles préconisés : sa collection est donc très représentative des pratiques et des instructions officielles.
A partir de ces modèles, il s’agit d’apprendre et d’expérimenter la géométrie plane puis la perspective. Par la suite, les élèves apprennent progressivement à ajouter les ombres et les lumières pour travailler les effets de relief : c’est ce qui s’appelle dessiner d’après la bosse.
Quelles finalités à l’enseignement du dessin ?
Au même titre que les autres disciplines dans un lycée de filles, mais plus généralement dans un lycée à une époque où seule la bourgeoisie y avait accès, l’enseignement du dessin a une double finalité.
Une finalité utilitaire : développer des compétences techniques qui pourront servir à l’exercice éventuel d’un métier. Le dessin technique peut servir de base à des commandes industrielles, comme en atteste la réalisation de frises et d’objets ornés (motifs de tapisseries, de décoration d’objets). Ce sont des arts décoratifs et appliqués (figure 8).
Une finalité d’agrément et de construction du bon goût : le dessin permet d’avoir un jugement esthétique sûr et d’avoir reçu les mêmes leçons que les garçons du même milieu social. Les modèles sont pour une majorité issus de la période antique, et notamment grecque, posée comme pilier du bon goût et référence indépassable des Beaux-Arts. Il est à souligner que jusqu’en 1911, les femmes ne pouvaient pas fréquenter les ateliers des Beaux-Arts pour y apprendre à dessiner. L’apprentissage du dessin à l’école et notamment dans les lycées à partir de modèles souvent similaires à ceux des Beaux-Arts a ainsi permis de développer institutionnellement cette pratique et tout ce qu’elle suppose auprès d’un plus vaste public.
La collection des moulages : un musée scolaire ?
On pourrait penser que le Louvre s’est dupliqué dans les établissements scolaires par l’envoi de ces collections élémentaires, augmentées selon les volontés locales. Pourtant, ces plâtres n’avaient pas d’autres vocations que de servir à exercer l’oeil et la précision du geste des apprentis dessinateurs. Ils n’ont pas servi à des supports de cours d’Histoire ou d’Histoire des Arts, du moins pas avant le tournant de 1909.
C’est là la grande différence avec les musées universitaires qui se constituent à la même époque avec les mêmes moulages. Les universités possèdent de vastes collections de moulages intégrés aux locaux des universités complètement rénovées des années 1880. Ces collections servaient de supports à l’étude de l’archéologie à la fin du XIXe siècle, au moment où l’archéologie se structurait en discipline scientifique, notamment dans les facultés de Bordeaux, Lyon et Montpellier.
A Toulouse, un musée universitaire assez riche se déploie dans les bâtiments de la faculté des Lettres, rue Lautman, puis rue du Taur, dans au moins trois pièces (figure 9).
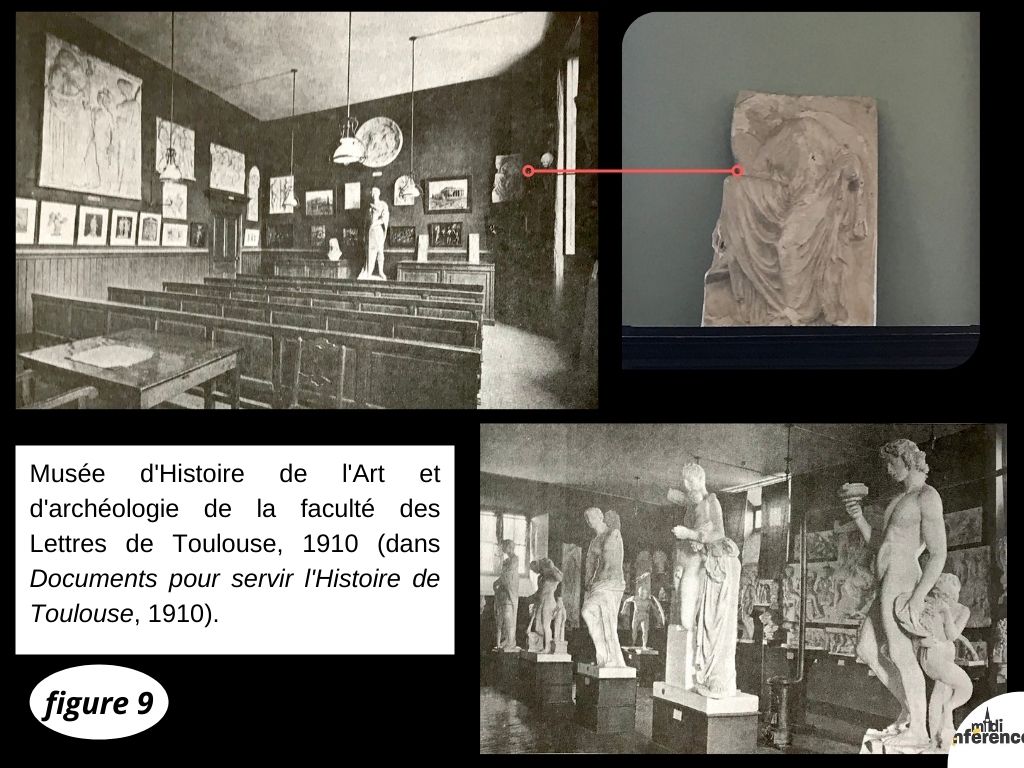
Sur une photo de 1910, on voit le bas-relief issu du temple d’Athéna Victorieuse, sur l’acropole d’Athènes, que notre lycée possède aussi et qui est toujours dans la salle des conseils en Dubarry. Ce moulage servait d’objet d’études historiques et archéologique à la faculté et de support de dessin dans un lycée.
Pendant la Première Guerre mondiale, les activités pédagogiques du lycée doivent laisser les locaux à un hôpital militaire. Les élèves sont réparties dans les locaux de la faculté de Lettres voisine : peut-être ont-elles découvert le musée des moulages universitaires et ont-elles enrichi leurs supports de dessins.
Contre la « dictature des plâtres », la réforme de 1909 et la méthode intuitive.
A partir de 1909, les programmes remettent drastiquement en cause les méthodes jusque là imposées. Ce n’est que l’affirmation d’un des courants qui animent le débat sur la question de l’enseignement du dessin depuis le début du XXe siècle, alors qu’une nouvelle génération d’enseignants arrive dans les établissements et où le monde immuable du lycée connaît des aspirations générales à une réforme en profondeur dans l’organisation des enseignements.
Lors d’un congrès de professeurs de dessin en 1900, un orateur tonne contre « la dictature des plâtres » et déplore la sécheresse de l’enseignement dispensé, qui écoeure les enfants au lieu d’en élever les aptitudes. Une sorte de querelles des Anciens et des Modernes autour des plâtres.
Les instructions demandent alors davantage de spontanéité dans l’apprentissage du dessin en utilisant des modèles issus du quotidien ou encore de l’imagination. On voit ici qu’au-delà du dessin, ce sont certainement des conceptions très différentes de la pédagogie qui s’entrechoquent dans ces successions d’instructions officielles.
Le registre des dessins de 1924 du lycée de filles de Toulouse montre qu’une synthèse entre les deux méthodes s’effectue.
Il contient toujours des dessins géométriques, selon la méthode progressive et adaptées à chaque classe, réalisés au fusain et d’après modèles de plâtre (figure 10).
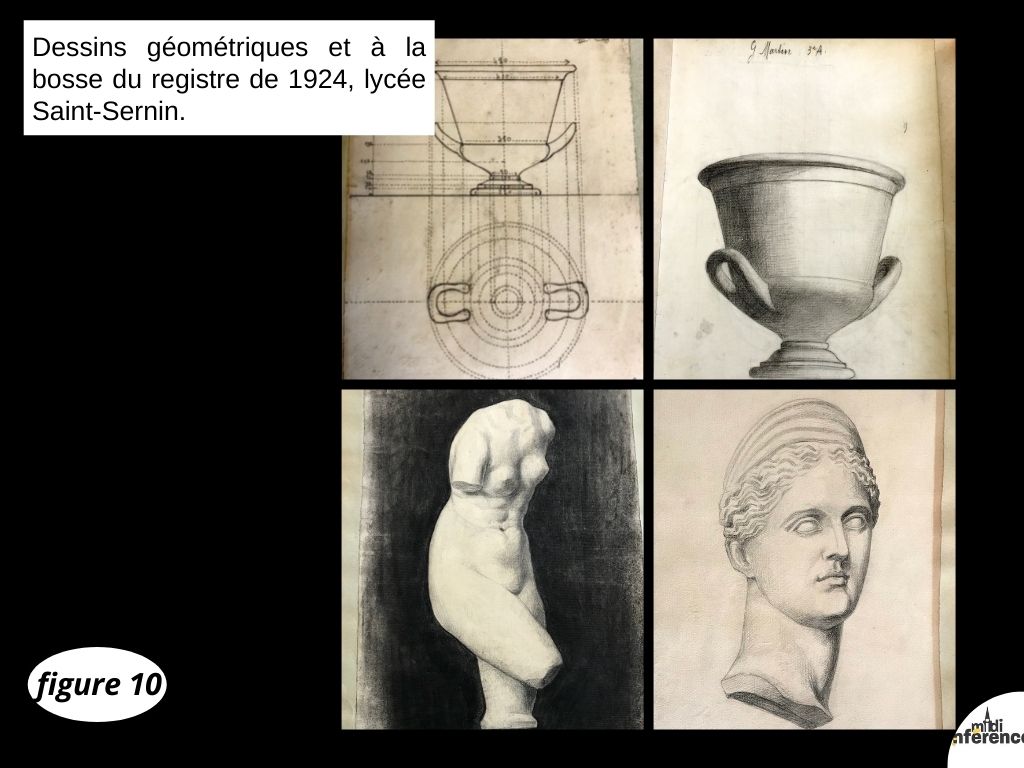
Mais on y trouve aussi beaucoup de fleurs d’après modèle vivant, comme sur des planches naturalistes. Il est tentant d’imaginer que ce sont les fleurs du parc du lycée qui ont servi de modèle (figure 11)…

On remarque aussi l’apparition de la couleur, que ce soit des pastels, de l’encre, de la gouache ou des aquarelles.
Conclusion :
Et notre Omphale ? A-t-elle été dessinée en 1909 ou en 1924 ? Hélas non. Et qu’elle est donc son original ?
Après avoir procédé à quelques recherches infructueuses dans divers catalogues, j’ai sollicité une amie spécialiste en histoire romaine qui elle-même a sollicité une de ses connaissances spécialistes en histoire grecque: rien, cette Omphale n’était pas connue et ne figurait dans aucun catalogue de sculpture antique européen, et notamment allemand. L’original aurait-il été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale ? Pendant la guerre froide ? C’était peu probable.
Alors j’ai contacté les conservatrices des musées de plâtres universitaires de Montpellier, Lyon et Bordeaux. L’une m’a mise en relation avec la conservatrice du département des moulages du Louvre. Aucune ne connaissait cette Omphale. Enfin, une docteure en histoire de l’art, auteure d’une thèse sur les musées universitaires de plâtres, à qui cette Omphale ne disait rien malgré les 5000 références répertoriées dans son travail m’a suggéré de poursuivre mon enquête auprès des conservateurs allemands.
(Je remercie chaleureusement Sarah Rey, maître de conférence à l’Université de Valencienne ; Marion Lagrange, Alexia Seguin, Lina Roy, des gypsothèques universitaires de Bordeaux, Montpellier et Lyon ; Elisabeth Le Breton, conservatrice au département des Antiquités du Musée du Louvre ; Soline Morinière, docteure en histoire de l’Art, spécialiste de l’histoire des collections de tirages en plâtre universitaires).
Quelques mots-clefs tapés en allemand sur un moteur de recherche m’ont conduit sur la page de l’actuel atelier des moulages des musées berlinois qui propose toujours à la vente des copies de la fameuse Omphale, mais cette fois des pieds à la tête, peau de lion et massue incluses. Par la même occasion, on apprenait enfin la provenance de la statue originale : loin d’être une œuvre antique, il s’agissait d’une sculpture de plâtre réalisée entre 1825 et 1827, par le sculpteur Friedrich Tieck, pour l’épouse de Wilhelm von Humboldt, Caroline, qui avait réalisé dans leur résidence de Schloss Tegel à Berlin un musée des antiques, fait de pièces originales, de moulages et de sculptures contemporaines dans un style antique et classique (figure 12).

Notre Omphale de plâtre est donc la réplique d’une Omphale de plâtre. La copie d’une rêverie antique. Que cette obscure sculpture décorative ait été sélectionnée par les ateliers berlinois, puis par ceux du Louvre, puis par le Ministère de l’Instruction publique appartient certainement à une chaîne de hasard, guidée par la recherche de lignes claires et pleines, idéalement antique et pédagogique.
Que cette Omphale de plâtre qui n’a jamais été en marbre et qui feint d’être antique se retrouve dans l’hôtel Dubarry n’est finalement pas étonnant : le lieu est chargé d’étrangeté, d’hétéroclite et de trompe-l’oeil.
Mais dans ce jeu d’illusion, une certitude : cette Omphale a été vue, observée, scrutée, dessinée, puis quasiment oubliée, sans pour autant que son mystère soit dévoilé. Encore n’a-t-elle pas disparue comme la plupart de ses camarades de collection.
Un rapport d’inspection de 1964 (cité par R. d’Enfert) relatait que « le souvenir des exercices interminables et fastidieux, les exigences excessives ont créé contre le plâtre une disgrâce générale ». Il est temps de lever cet état de disgrâce et de porter un œil attentif quoiqu’amusé sur ces plâtres qui en ont beaucoup essuyés. Comme la plupart des objets de notre grenier, ils ne demandent qu’à témoigner.
Bibliographie indicative :
Sur les objets en tant que sources et sur l’histoire de l’éducation :
On renvoie aux ressources bibliographiques de la Midi-Conférence sur l’objet du grenier n°1.
Sur l’histoire de l’enseignement du dessin dans le système scolaire public :
D. Poulot, J.-M. Pire, A. Bonnet (dir.), L’Education artistique en France. Du modèle académique et scolaire aux pratiques actuelles, XVIIIe-XIXe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2010.
Alain Bonnet, « L’introduction du dessin dans le système public d’enseignement au XIXe siècle », p. 263.
Renaud d’Enfert, « L’enseignement du dessin au XIXe siècle : une affaire d’Etat ? », p. 285.
Sur l’histoire du lycée Saint-Sernin :
Le livret interactif :
RESULTATS
William Shakespeare : génie ou imposteur ?. Gerald Kenny. 7-04-22.

William Shakespeare : génie ou imposteur ?
Gerald Kenny
Le sens social de la liberté. Eric Bories. 31-03-22.

Le sens social de la liberté
Eric Bories
Je me propose de tenter d’expliquer pourquoi pouvoir faire ce que nous voulons sans entrave, ou encore vouloir ce que nous voulons sans influence, ne suffit pas à penser le sens de la liberté, ni a fortiori à la rendre faisable. Ainsi lorsque nous nous satisfaisons de nous représenter l’étendue de nos droits, comme d’ailleurs l’étendue de ce qui serait bon que nous fassions, la liberté demeure un idéal pour les individus que nous sommes. Dans ce contexte nous nous faisons bien en effet de la liberté une idée, idée qui peut être pensée à l’écart de nos engagements familiaux, de nos impératifs de collaboration professionnelle, de nos démarches de citoyens.
Concentré sur la réflexion stricte de ce que le droit prescrit ou de ce à quoi la morale l’oblige l’individu qui, de la sorte, se prétendrait libre, passerait au mieux à côté de sa vie ; au pire l’anéantirait. Le moralisme poussé à l’extrême comme le juridisme poussé à l’extrême chasse en effet l’amitié et l’amour, la collégialité heureuse aussi. C’est ce que dénonce Axel Honneth en 2011 dans un ouvrage publié en Français en 2015 sous le titre Le droit de la liberté. C’est pourquoi un professeur qui irait ex abrupto dénoncer le plagiat de son collègue et ami auprès du recteur de l’université ne pourrait que souffrir et faire souffrir les autres autour de lui. De la même façon un père qui n’envisage de régler la question du droit de garde de son enfant que sous la forme d’une joute juridique l’opposant à son ex-femme s’exposerait à mépriser les soins et l’amour qui le lient à son fils, comme le reconnaît Honneth dans son commentaire du film Kramer contre Kramer. Liberté juridique et liberté morale sont bien des conditions nécessaires de la liberté mais ne suffisent donc pas à faire liberté, à la rendre effective.
Le fait est que notre époque, qui se plait à transformer les liens sociaux en liens économiques juridiquement encadrés ne nous encourage pas vraiment, et c’est peu de le dire, à l’effectuation sociale de la liberté. Rien ne nous interdit pourtant d’être optimistes, à la condition expresse, toutefois, d’aimer la part de lumière qui anime ou qui est susceptible d’animer celles et ceux qui partagent nos vies, en cultivant avec confiance l’espoir qu’ils sauront nous aider à chasser chez eux comme chez nous la part d’ombre qui nous abîme.
Comment le genre construit le sexe. Marie Pachoud. 17-03-2022.
Comment le genre construit le sexe.
Maris Pachoud
Le genre, qu’est ce que c’est ?
Un concept construit par la sociologie pour penser les différences faites entre filles et garçons. Définition du genre : Bereni, Jaunait, Chauvin, Revillard, dans le manuel de référence Introduction aux études sur le genre : le genre est « un système de bicatégorisation hiérarchisée entre les sexes (hommes/femmes) et entre les valeurs et représentations qui leur sont associées (masculin/féminin) ». On peut donc résumer le genre par deux dimensions : séparation et hiérarchisation
Ici on va se concentrer seulement sur la bicatégorisation – il y a tellement à dire sur la hiérarchisation (on donne plus de valeur au masculin, les hommes sont mieux payés…) qu’il faudrait prévoir un cycle de conférences à lui seul.
L’importance de la bi-catégorisation
La bi-catégorisation, qu’est ce que c’est ? Le fait qu’on va tout distribuer – les individus, les normes, les codes de conduite, les comportements attendus, les jeux, les couleurs – en deux catégories, masculin / féminin. Trois exemples :
– On a toujours envie de classer quelqu’un soit dans le masculin soit dans le féminin : on veut savoir, on est mal à l’aise, curieux quand on n’arrive pas à catégoriser une personne comme étant une fille ou un garçon (ce qui est dans les faits très rare) alors que par exemple on ne se pose pas la question de la taille des pieds de son interlocuteur ou de la couleur de ses yeux. Pour reprendre les termes de la philosophe Judith Butler : on n’accepte pas qu’il y ait du trouble dans le genre. Le fait qu’on associe immédiatement un genre à une personne, et qu’on ait besoin de le faire, montre toute l’importance du genre dans la construction de notre identité (contrairement par exemple à la couleur de nos yeux).
– Nous même on se genre sans cesse dans l’une ou l’autre des catégories : on choisit des attributs (des coupes de cheveux, des vêtements…) qui permettent à nos interlocuteurs de nous genrer, de nous situer dans la bi-catégorisation dès le premier regard. Pour reprendre encore Butler, tous les jours, on performe notre genre.
– Dans notre langage, on bi-catégorise continuellement : il faut choisir entre « il » ou « elle », jusqu’à présent (mais c’est en train d’émerger) il n’y a pas de réelle alternative. Du coup quand on parle de quelqu’un on est obligé de classer cette personne dans la bi-catégorisation.
Par rapport à la bi-catégorisation, le concept de genre a évolué.
Au départ, quand le terme de genre a émergé en sociologie dans les années 1970, on ne questionnait pas cette bi-catégorisation (c’est bien expliqué, par exemple, dans la manuel cité plus haut). On partait de l’idée qu’il y avait des filles et des garçons, deux catégories naturelles ; et on montrait que ces deux groupes recevaient une éducation différente, à même de créer chez eux des comportements différents, des goûts différents (pour caricaturer : goût pour les films d’action VS les comédies romantiques ; goût pour le bleu VS pour le rose ; goût pour le sport VS goût pour le bavardage…). Le genre était un concept pour penser la socialisation différenciée, une éducation différente. On était donc dans un raisonnement de type : sexe genre : naturel social : naturellement il y aurait deux sexes différents, les garçons et les filles, et sur cette base naturellement différente on viendrait créer des comportements différents, par une éducation différente. C’est ce qu’on appelle le premier âge des études de genre. On emploie alors genre au pluriel : il y a plusieurs genres, le genre féminin, le genre masculin.
Et puis petit à petit, en sociologie on est allé plus loin dans la déconstruction – on aime bien déconstruire ! – , on est venu questionner la division même entre filles et garçons – la bi-catégorisation. Doit-on vraiment la prendre comme donnée ? Est-ce qu’il a d’abord une séparation entre le féminin et la masculin et ensuite du genre, ou est-ce que le genre n’aurait pas un rôle à jouer dans cette bipartition même ?
A alors émergé l’idée selon laquelle on n’a pas simplement un mouvement sexe genre, mais aussi un mouvement genre sexe : on s’est dit que le genre construit le sexe, le social influe sur le naturel. C’est le deuxième âge des études de genre.
Mais qu’est ce que cela veut dire, que le genre construit le sexe ?
Cela ne veut pas dire qu’en sociologie on nie une certaine réalité de corps différents. Il y a dans l’immense majorité – la quasi totalité – des cas des corps différents, la différence la plus visible se situant bien évidemment au niveau des organes génitaux externes et des différenciations sexuelles secondaires (poitrine…) comme vous le voyez très bien en SVT. En SES on ne dit pas que la SVT se trompe ! On ne nie pas une différence biologique. Quand on dit que le genre construit le sexe, c’est en fait du à deux mécanismes :
Ce qu’on dit en sociologie, c’est d’une part que ces différences physiques sexuées s’inscrivent dans tout un éventail de différences, et qu’on leur donne un statut particulier. Le genre crée le sexe signifie que le genre distingue le sexe comme une différence physique importante et significative ; le genre donne une importance sociale à une variation physique parmi d’autres. Parmi tout un ensemble de différences physiques, certaines sont dotées d’une importance sociale : on les perçoit comme significatives, comme étant un socle de notre identité, et elles vont avoir un effet déterminant sur notre trajectoire. C’est le cas du genre, qui fait de notre sexe un élément déterminant dans notre identité et notre trajectoire. Ce faisant, on vient donner une signification sociale particulière à un fait physique, on lui donne une importance particulière. Donc dans ce premier sens, quand on dit que le genre crée le sexe, cela signifie que parmi tout un éventail de différences physiques, le genre distingue le sexe comme un élément d’importance.
D’autre part le genre crée le sexe parce que le genre va déterminer la manière dont on perçoit le sexe, dont on perçoit la dimension biologique du sexe par un prisme strictement binaire. Deux manières de le montrer :
– On va toujours insister sur les différences corporelles entre les sexes. Exemple des hormones, Ilana Löwy dans L’emprise du genre (historienne des sciences, rattachée à l’Inserm, donc un institut médical) : on va toujours insister sur les différences entre ce qu’on appelle les hormones féminines (oestrogènes, progesterone) et hormones masculines (testostérone), alors que :
– dans la réalité biologique ce n’est pas aussi catégorique dans le sens où hommes comme femmes ont de la testostérone comme des oestrogènes, à des degrés différents ; et jusqu’aux années 1930 les chercheurs en biologie insistaient sur leur structure chimique très proche. Löwy souligne donc qu’on pourrait penser les hormones sur le modèle du continuum plutôt que de la binarité. Mais nos représentations sont aujourd’hui marquées par la binarité, comme le montre le fait qu’on parle d’hormones féminines et masculines. Ce faisant, dit Löwy, on « force » les modèles biologiques pour les faire correspondre à nos représentations sociales en créant une binarité hormone féminine / hormone masculine qui n’est pas aussi stricte dans la nature. La réalité biologique est plus complexe, mais on a cette norme de genre, masculin / féminin, et on vient appliquer cette norme pour penser, décrire le biologique. C’est ainsi bien le genre qui détermine le sexe, qui détermine notre vision du sexe comme étant strictement binaire.
– Löwy nous interroge aussi : quelles autres hormones on connaît ? Peu, alors que plein d’hormones jouent un rôle important dans nos vies aussi ! Par exemple l’histamine, en lien avec les allergies. Pour Löwy, on donne de l’importance aux hormones sexuelles parce qu’elles renforcent notre modèle binaire, c’est pour ça que ce sont des hormones que l’on connaît, et cela montre l’importance de la binarité genrée dans notre vision du monde.
– On voit également que le genre nous amène à penser strictement le sexe sous le modèle de la binarité dans le sens où on a du mal à accepter quand certains traits physiques sont non-déterminés :
– exemple des enfants intersexes, dont l’organe génital est indéterminé à la naissance : on opère les enfants pour les faire correspondre à un sexe. C’est un exemple idéal typique du genre qui crée le sexe : du fait de nos normes de genre binaire, on intervient chirurgicalement sur le sexe ;
– Caster Semenya : double championne olympique, triple championne du monde du 800m. Hyperandrogénie. Elle a un génotype XY : elle est génétiquement homme, mais ses attributs sexuels sont féminins. On voit qu’il n’y a pas forcément de concordance à différents niveaux, la détermination du sexe est parfois compliquée, ce qui nous montre bien d’ailleurs que le strict modèle binaire ne permet pas de comprendre l’éventail des possibilités biologiques parce que le sexe d’une personne se détermine à différents niveaux. Ce qui nous intéresse ici c’est le positionnement des comités sportifs à son égard : ils ne savent pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire avec ce qui sort de notre strict modèle de la binarité. En 2010, on lui propose de courir en handisport : comme si c’était un handicap de ne pas correspondre à la bi-catégorisation
Synthèse de l’analyse
Ainsi, le genre impose une binarité qui n’est parfois pas aussi simple dans la réalité et on a du mal à comprendre / à accepter les déviations par rapport à la binarité. La binarité est en fait une norme sociale qu’on applique strictement à une réalité biologique un peu plus complexe. Donc quand on dit que le genre crée le sexe en sociologie, on ne nie pas une réalité physique différente, mais on dit que la bi-catégorisation systématique, importante et stéréotypée est sociale. On perçoit le monde à travers un prisme genré : on a en nous des normes de genre par lesquelles on perçoit le monde, des lunettes binaires qui fait qu’on caractérise sans cesse entre masculin et féminin. On raisonne comme une signalétique de toilettes, en catégorisant tout le monde en masculin ou en féminin !
Utiliser le genre au singulier
On reprend la définition donnée au début, différenciation et hiérarchisation : le genre, c’est un rapport de pouvoir qui donne une importance majeure au sexe dans la détermination de nos positions sociales et réduit tout à une double alternative stéréotypée masculin / féminin, qui est aussi une hiérarchisation.
Le genre n’est plus alors une simple éducation différente des hommes et des femmes, mais le principe même d’organisation en deux groupes masculin et féminin. Le genre devient alors un rapport diviseur : on emploie alors le concept de genre au singulier.
Cette réduction en deux catégories vient limiter nos possibles. Quelle traduction politique de cette conclusion ? Ouvrir les possibles, voir des individus avant de voir des hommes ou des femmes permet de ne pas assigner les individus à une identité et à une trajectoire. Cela reviendrait à changer la signalétique de toilettes binaire qui gouverne notre esprit.
Pour aller plus loin
On peut faire un parallèle avec le racisme : dans la continuité des analyses menées ici, on pourrait dire que le racisme crée la couleur de peau. En effet, comme le sexe, la couleur de peau n’est qu’un trait physique parmi d’autres, comme aussi la couleur des yeux, la taille des pieds… mais le racisme fait de la couleur de peau une différence importante, on s’en sert pour catégoriser les individus, on y associe des stéréotypes, il y a une influence déterminante sur la trajectoire des individus. Et on a là encore une bi-catégorisation, entre ceux qui sont discriminés de par leur couleur de peau et ceux qui ne le sont pas : une binarité que la sociologie approche par les concepts de « blanc » et de « non blanc » – une autre bi-catégorisation sur laquelle, comme pour le genre, vont se construire de nombreuses inégalités.
Bibliographie
Bereni, Chauvin, Jaunait, Revillard, 2012, Introduction aux études sur le genre, De Boeck
Butler J., 2005 (1990), Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte
Löwy I., 2006, L’emprise du genre. Masculinité, féminité, inégalité
L’objet du grenier 1 : L’Equilibriste de 1885. Marie Perny 08-03-2022.
L’objet du grenier 1 : L’Equilibriste de 1885
Marie Perny
Introduction
Voici la première d’une série de trois conférences qui porteront chacune sur un objet, un objet pédagogique, qualifié, avec un peu de facétie, d’objet du grenier.
L’objet du grenier, c’est celui qui y a été entreposé quand il n’avait plus d’utilité particulière, c’est celui que l’on oublie et que l’on redécouvre par hasard, plein de poussière. Une découverte qui fait jaillir souvenirs, questionnement, émerveillement même.
Par objets pédagogiques, on désigne les outils qui servent de support à l’enseignement et qui sont le vecteur d’un savoir, comme les cartes murales ou les instruments de mesure. Mais que peuvent donc nous apprendre ces objets pédagogiques quand ils sortent d’une salle de classe et ne sont plus utilisés ? Devenus obsolètes, beaucoup ont été oubliés au fond d’un placard, jetés parfois, ou bien sont passés du pédagogique au décoratif, tout en alimentant les fantasmes d’un âge d’or, évidemment perdu, de l’école d’avant.
Et pourtant ces objets peuvent être considérés par l’historien comme des sources particulières, à la fois ordinaires et extraordinaires, pour comprendre et reconstituer des pans de l’histoire de l’éducation, entre autres thématiques.
Ces objets sont des sources ordinaires car ils ont été dupliqués en des centaines ou des milliers d’exemplaires, et préconisés ou exigés par les instructions scolaires officielles.
Mais ce sont aussi des sources extraordinaires : au-delà des spécialistes de l’Antiquité, considérer des objets comme des sources au même titre que les archives écrites ne va pas de soi pour les historiens. Ils se tournent néanmoins depuis une date récente sur ces sources au potentiel fécond : citons l’ouvrage collectif dirigé par Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, Le Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, paru chez Fayard en 2020 ou la récente série documentaire dirigée par Patrick Boucheron sur la chaîne Arté, Faire l’Histoire par le prisme des objets.
Ce sont enfin des sources singulières. L’objet porte en lui une charge sensible : il nécessite d’être observé et manipulé. Il détient aussi une force émotionnelle particulière : l’objet a été conçu et utilisé par des hommes et des femmes pour lesquels il avait un sens particulier. Mais il comporte sa part de mystère et demande à être croisé avec les archives écrites.
Les objets sont donc au cœur d’une enquête qui peut en faire surgir une grande richesse d’enseignement. Or qu’est-ce qu’enquêter, d’après l’étymologie grecque, si ce n’est faire de l’histoire et raconter une histoire ?
Un petit objet sera à la fois le point de départ et le fil conducteur de l’enquête du jour : et pour suivre un fil, qui de mieux placé qu’un funambule, puisse-t-il faire seulement 9 cm de haut ? (figure 1)

Il s’agit de l’un des objets pédagogiques les plus anciens du lycée Saint-Sernin : un équilibriste, mentionné dans le registre de l’inventaire des instruments de Physique le 31 mai 1885. Il est le 9e instrument à y être inscrit, un an après l’ouverture du lycée. Sans doute est-il nécessaire de rappeler que notre établissement ouvre en 1884 et qu’il est le premier lycée public de filles de Toulouse.
Voici un petit personnage étonnant qui tient sur la pointe de son pied gauche, malgré de lourdes haltères. Malgré, ou grâce à ! En effet, sans ces haltères, son centre de gravité serait au milieu de son corps et il ne pourrait pas tenir debout. Mais muni de ces haltères, son centre de gravité est abaissé et se situe très exactement sous son pied, ce qui lui permet non seulement de rester debout mais aussi de toujours y revenir.
C’est donc un instrument simple et récréatif, à l’allure familière, qui permettait de montrer, voire de démontrer, les principes de la pesanteur aux élèves du lycée. En 137 ans, ce funambule a peut-être perdu quelques traits de son visage, il n’en a pas moins toujours gardé l’équilibre et il peut d’un pas alerte, quoique centenaire, nous guider pour explorer la collection d’instruments de Physique et de Chimie des quarante premières années de notre établissement, entre 1884 et la fin des années 1920.
En effet, cet équilibriste est l’un des quelques 70 objets dont nous disposons encore dans nos réserves (figure 2).

Tous ont été inventoriés au printemps dernier : dans le cadre d’une initiation au travail sur archive et au patrimoine, une douzaine d’étudiants d’hypokhâgne et moi-même avons nettoyé, recensé, identifié et photographié chacun de ses instruments, avec l’aide d’Annick Assalit, laborantine et gardienne des instruments, et Luc Denamiel, professeur de Physique-Chimie (figure 3).

Tous ces instruments anciens figurent désormais dans une base de données à échelle nationale qui recense et valorise les instruments scientifiques pédagogiques des établissements d’enseignement français : il s’agit de la base de l’ASEISTE (Association de Sauvegarde et d’Etude des Instruments Scientifiques et Techniques, www.asseiste.org). Chacun de nos instruments dispose d’une fiche explicative et pose sous son meilleur profil.
La consultation des inventaires permet d’en savoir plus : après la transcription intégrale des inventaires allant de 1885 à 1908, nous avons constaté que la collection de Physique-Chimie était riche de près de 300 instruments divers et variés.Concernant notre équilibriste, nous apprenons qu’il a été acheté 6 francs, en 1885, et qu’il a été conçu par une maison parisienne, la maison Alvergniat, qui fournit de nombreux établissements scolaires en France (figure 4)
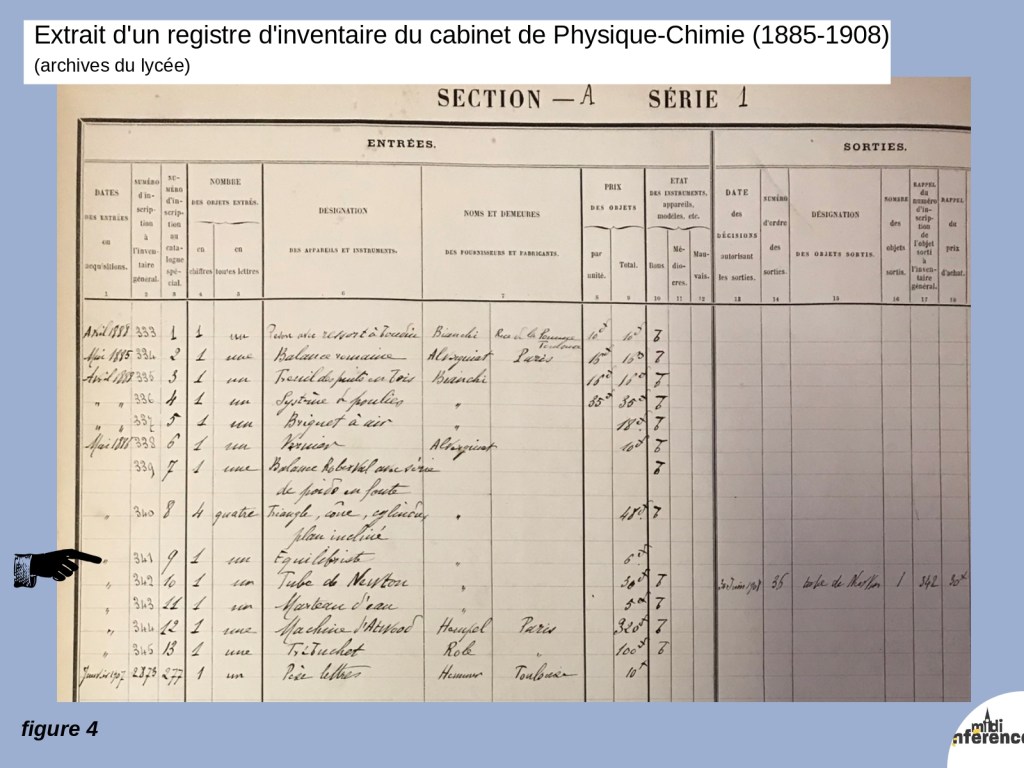
Ces instruments servaient de supports aux cours de sciences dispensés aux jeunes filles, de l’âge de 12 ans à celui de 16 ans voire plus selon le cursus suivi et permettent de réfléchir sur la place des sciences dans l’enseignement secondaire des filles des années 1880 à 1930 environ.
La question de la représentativité des filles dans les enseignements scientifiques est une question sans cesse d’actualité : cette conférence est donnée le 8 mars 2022, journée des droits de la femme, et il n’est pas inutile de rappeler le récent constat alarmant de la sous-représentation des filles conservant les mathématiques au lycée dans le cadre de la récente réforme.
Or, cette question est ancienne et est abordée dès l’origine des établissements scolaires secondaires pour filles. Mais la question qui se pose au XIXe siècle est plutôt de savoir si les filles doivent faire des sciences, et si oui, comment, selon quelle méthode et pour quelles finalités, plutôt que de savoir comment les inciter à en faire.
Pour comprendre la place des Sciences dans l’enseignement secondaire des filles et raisonner sans faire d’anachronismes, il faut au préalable exposer un certain nombre d’éléments de contexte.
1. Les caractéristiques de l’enseignement secondaire public auprès des filles de 1880 à la fin des années 1920 : une particularité toulousaine dans l’intérêt porté aux sciences ?
Le lycée ouvre dans l’effervescence des lois scolaires fondamentales mises en œuvre par la IIIe République. La loi Camille Sée du 21 décembre 1880 crée les premiers lycées publics de filles, alors que les lycées publics de garçons existaient depuis le début du XIXe siècle (celui de Toulouse a ouvert en 1806). Jusque là, l’éducation secondaire des filles a longtemps été le monopole d’établissements privés, dont la plupart dépendait de l’Eglise catholique. A la veille de la Première Guerre mondiale, il y a une centaine de lycée pour filles dans le pays (un par ville) ; celui de Toulouse compte à cette date environ 600 élèves. L’enseignement secondaire au XIXe siècle est l’école de la bourgeoisie : seuls 5% des enfants suivent une scolarité dite secondaire, au lycée, de l’âge de 12 ans à celui de 18 ans. Le cursus au lycée public est par ailleurs payant. Alors que de nos jours, l’enseignement secondaire est la suite logique de l’enseignement primaire, ce sont deux mondes quasi étanches du XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle.
Dans une société où les femmes, quel que soit leur milieu social, sont d’éternelles mineures sur le plan juridique, la création des lycées publics de filles n’est pas une mesure d’émancipation des femmes comme on pourrait l’entendre de nos jours. Il s’agit d’une mesure qui vise à faire entrer les femmes des classes sociales aisées dans le giron de la République et ainsi de former de meilleures compagnes et de meilleures mères de familles capables d’élever leurs enfants de manière éclairée.
On peut formuler l’hypothèse qu’il y aurait eu un lien particulier entre le lycée de filles de Toulouse et le milieu scientifique universitaire de la ville, un lien incarné par la famille Baillaud (figure 5).

La première directrice du lycée, Emma Baillaud, à la tête du lycée de l’ouverture jusqu’en 1908, était la sœur du directeur de l’Observatoire d’astronomie de Toulouse, Benjamin Baillaud, par ailleurs doyen de la faculté des sciences de Toulouse entre 1879 et 1907 et fondateur de l’Observatoire du Pic du Midi. Il a donné quelques heures de cours de mathématiques dans les premières années du lycée et il y scolarise ses trois filles. Les Baillaud sont intimement liés avec des figures du milieu scientifique universitaire français, notamment dans le milieu de l’astronomie, mais aussi de la Physique, des Mathématiques et des Sciences naturelles. On peut alors penser que l’enseignement des sciences auprès des filles soient encouragés, ce qui pourrait expliquer la qualité de la collection des instruments scientifiques.
2. Quelle était la place des sciences dans les programmes et les bâtiments des lycées de filles ?
Les programmes destinées aux filles font la part belle à des enseignements dits « modernes », en opposition aux enseignements « classiques » que reçoivent les garçons, et privilégient des savoirs concrets qui bannissent toute approche théorique et conceptuelle. On trouve ainsi de la morale et la psychologie morale (et non de la Philosophie) ; la littérature et le français, les langues vivantes (et non le latin) ; l’histoire, la géographie, les travaux de couture et d’hygiène.
Les éléments de sciences ont une petite part dans cette enseignement : entre 1882 et la fin des années 1920, les sciences (Mathématiques, Sciences naturelles, Sciences Physiques) qui figurent au tronc commun et parfois dans les matières facultatives, occupent entre 1/8e et 1/3 de l’horaire de l’ensemble des enseignements, selon le moment et les classes concernées.
Il faut attendre 1924 et la loi Bérard pour qu’il y ait un alignement des enseignements secondaires des filles sur celui des garçons.
Les lycées prévoient des salles spécifiques à cet enseignement : une salle de cours associée à un cabinet de Physique et à un laboratoire de Chimie, parfois aussi à une salle de collections, comme on peut le voir sur le plan réalisé en 1886 (figure 6).

La création d’un cabinet montre que les instruments de Physique sont nombreux et nécessitent un lieu dédié à leur rangement et pour la préparation des expériences. Dans plusieurs lycées, une salle de cours de type petit amphithéâtre est aménagée, ce qui permet aux élèves de mieux voir les expériences réalisées par le professeur : il y a eu à Toulouse un projet d’amphithéâtre sur un plan de 1911 qui n’a pas été réalisé (figure 7). Une photo du lycée de jeunes filles de Paris, le lycée Racine, permet de voir une telle disposition (figure 8).


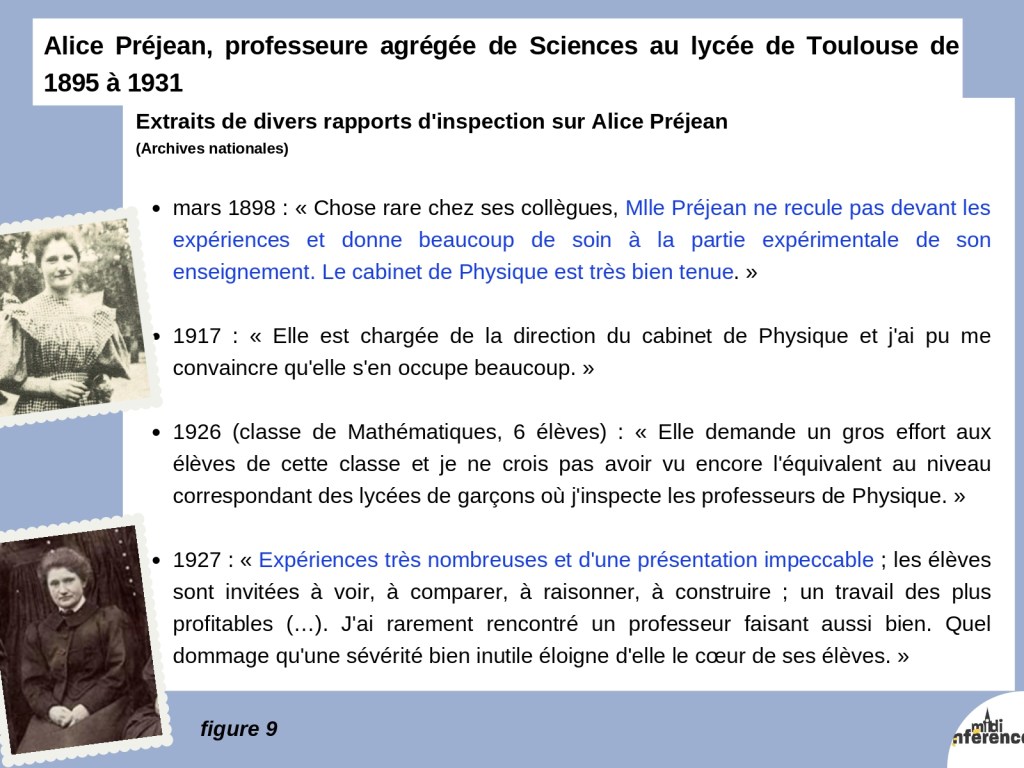
On voit ici clairement la dimension expérimentale être soulignée par la disposition des lieux.
Les instructions insistent en effet sur la nécessité de proposer un enseignement des Sciences physiques et naturelles fondé sur l’expérimentation et l’observation, et ce tant pour les filles que pour les garçons. Cette dimension expérimentale de l’enseignement explique la collection des instruments scientifiques.
Mais les expériences sont surtout montrées aux élèves, qui sont simples spectatrices.
Le cas de l’une des professeures de sciences du lycée, Alice Préjean, qui a effectué toute sa carrière à Toulouse, de 1895 à 1932, est intéressant à examiner pour comprendre les pratiques d’enseignement des sciences, tant son dossier professionnel, conservé aux Archives nationales, est riche. Elle est née en Algérie, a fait l’ENS de Sèvres entre 1892 et 1894, et obtient l’agrégation de sciences en 1894.
Les rapports d’inspection soulignent du début à la fin de sa carrière la grande précision de ses cours et le recours constant aux expériences (figure 9).

On insiste particulièrement sur le soin qu’elle déploie à entretenir le cabinet de Physique. On reconnaît d’ailleurs son écriture dans l’un des registres d’inventaires des instruments.
Cependant, les manipulations de physique-chimie deviennent obligatoires à la fin des années 1920. Une brochure du lycée de 1930 montre une salle de Chimie avec des élèves réalisant des expériences (figure 10).
Si Alice Préjean a recours systématiquement aux expériences, elle semble plus douée pour les réaliser que pour les faire réaliser par ses élèves, alors que les programmes le demandent de plus en plus, notamment à la fin des années 1920 avec la création de cours de travaux pratiques. Un rapport d’inspection fait état de la passivité des élèves qui ne sont pas assez sollicitées et un autre, particulièrement assassin, évoque une séance de travaux pratiques où la partie pratique est justement mise de côté… (figure 11)
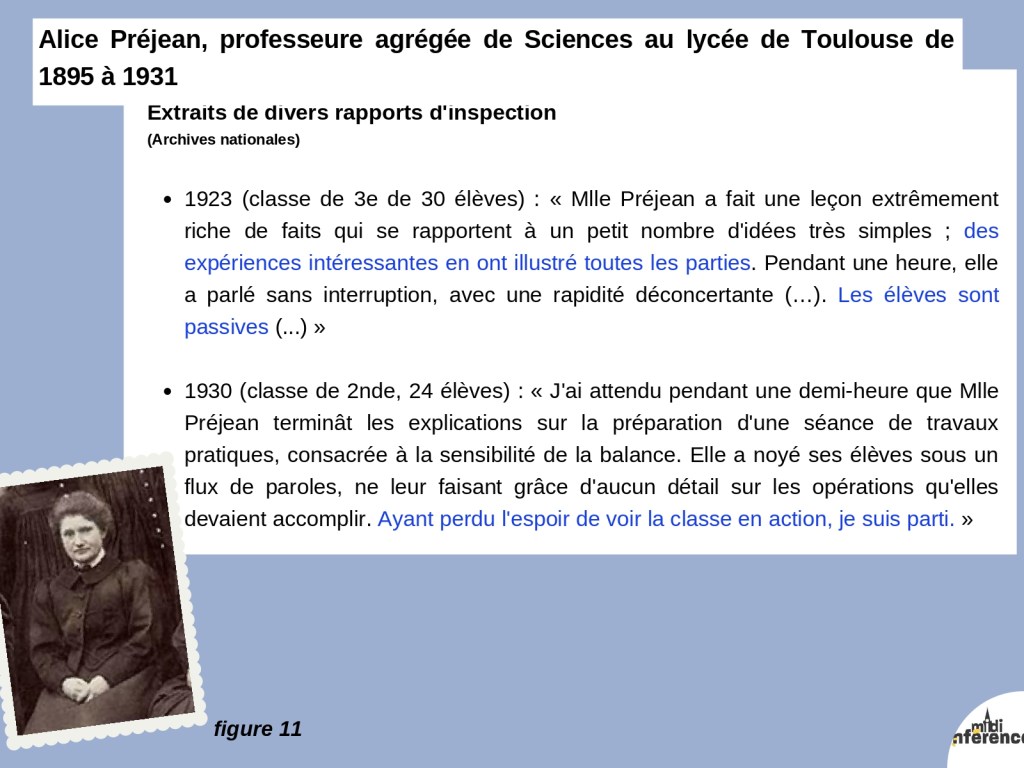
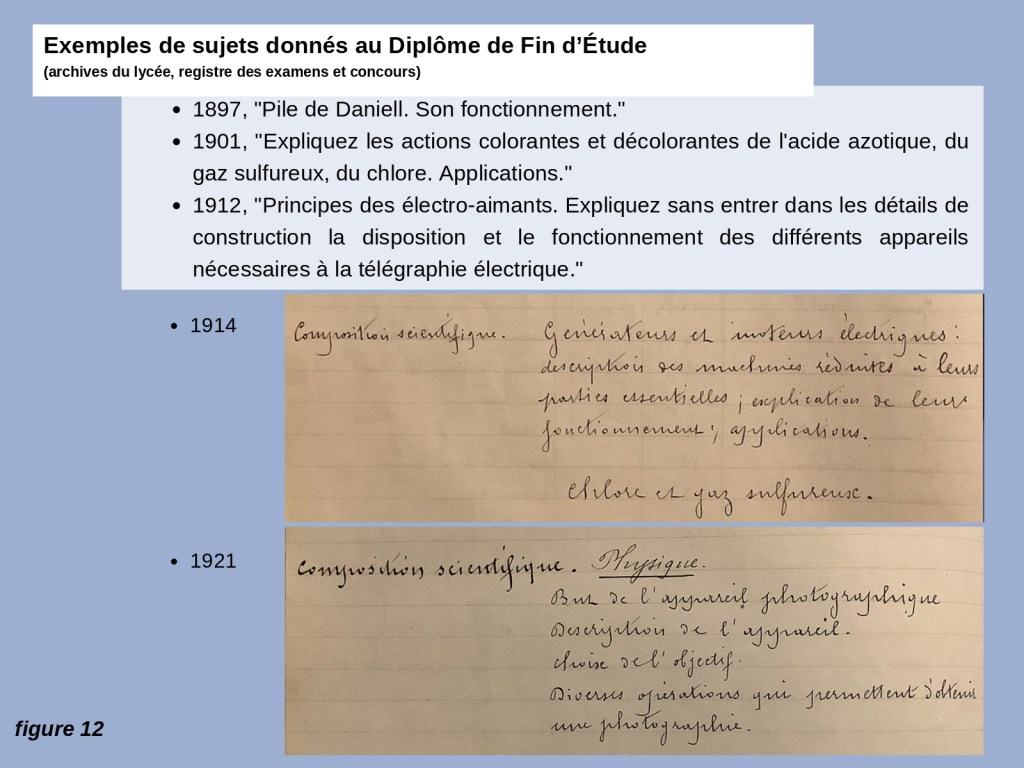
Alice Préjean semble avoir été un professeur particulièrement exigeant, voire intransigeant, tant avec ses élèves qu’avec ses collègues et notamment la direction (plusieurs litiges surgissent au sujet de commandes d’instrument de Physique).
3. Quelle était la place des sciences dans les diplômes des lycéennes ?
Il faut d’abord souligner que les filles ne passent pas les mêmes diplômes que les garçons en raison des différences de finalité des enseignements. Le cursus au lycée se déroule en 5 ans seulement, avec un certificat d’études secondaires à la fin de la 3e année et à la fin de la 5e année, un diplôme de fin d’études secondaire. Les sciences sont toujours évaluées pour l’obtention de ces deux diplômes.
Pour l’obtention du diplôme de fin d’études, l’une des trois épreuves consiste en une composition de sciences divisée en deux questions, généralement l’une de Physique ou de Chimie, l’autre d’Histoire naturelle.
Quelques exemples de sujets donnés à Toulouse – les sujets sont décidés par les établissements – soulignent la dimension expérimentale de l’enseignement : le raisonnement est fondé sur des expériences concrètes et vise à une application au quotidien (figure 12).
Avant 1924, certaines filles passaient le baccalauréat mais sans que le lycée ne les y prépare directement : les matières-clefs du bac n’y étaient pas enseignées dans le tronc commun (le latin, la philosophie, tous les aspects des mathématiques) mais à titre facultatif. Cela évolue de manière décisive après la Première Guerre mondiale.
A partir des registres de réussites au différents baccalauréats entre 1892 et 1927, on peut voir une hausse constante des candidates à partir de 1912 où 4 élèves présentent l’examen, dans les voies Lettres (A et B pour la première partie du Baccalauréat, « Philosophie » pour la deuxième partie) jusqu’en 1927 avec 95 candidates réparties dans toutes les voies. Le nombre de candidates aux baccalauréats des voies sciences (C et D pour la première partie, « Mathématiques » pour la deuxième partie) stagne entre 18 et 22 : la place des Bacs « sciences » ne dépasse pas les 25% des candidates (figure 13).
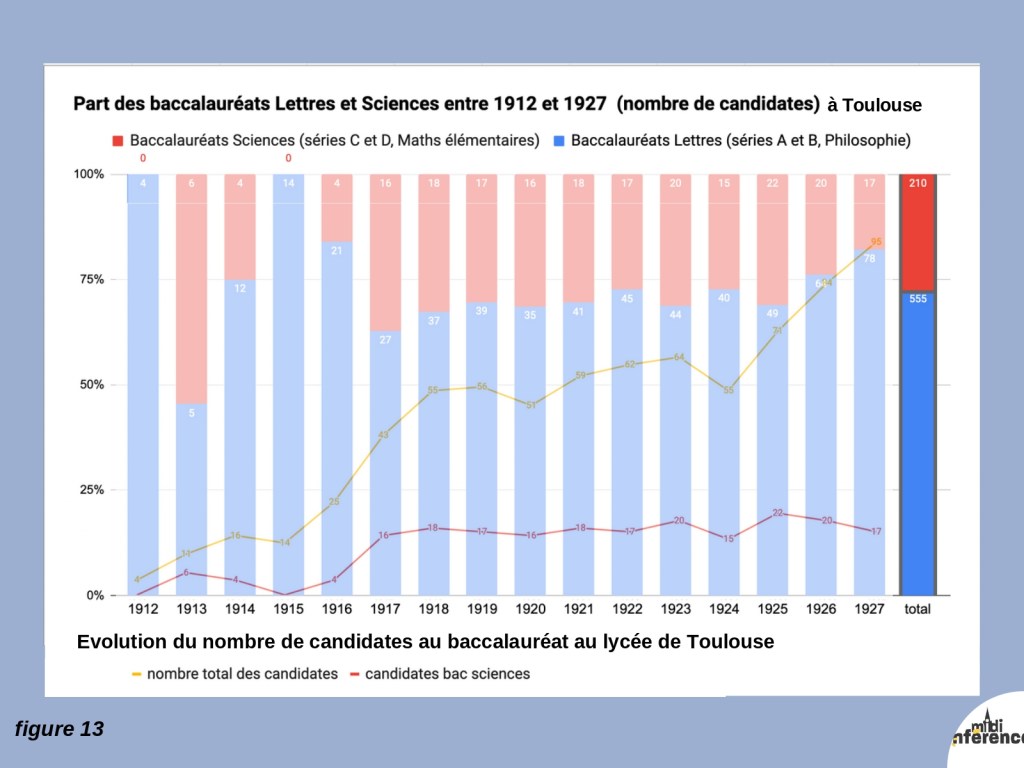

En revanche, on constate une réussite légèrement plus importante aux bacs des voies sciences par rapport à la moyenne.
4. Le cas spécifique de la 6e année « voie Sciences »
Le cursus des lycéennes se faisait en 5 ans, mais il existait aussi une 6e année qui pourrait correspondre à nos classes préparatoires. On y préparait le concours des seules grandes écoles ouvertes aux femmes : celui des Ecoles normales supérieures de femmes, celles de Sèvres et de Fontenay, qui formaient les professeures des lycées. Cette 6e année peut aussi servir d’approfondissement aux élèves qui ont obtenu leur diplôme de fin d’études et faire ainsi office d’études supérieures. On peut rester un, deux, trois voire cinq années en 6e année. Selon le concours visé, les élèves suivent la voie Lettres ou la voie Sciences.
D’après les données des registres du lycée, les élèves de la voie Sciences représentent près de 30% des effectifs de cette 6e année, mais aussi des candidates au concours des ENS, des admissibles et des admises (figure 14).
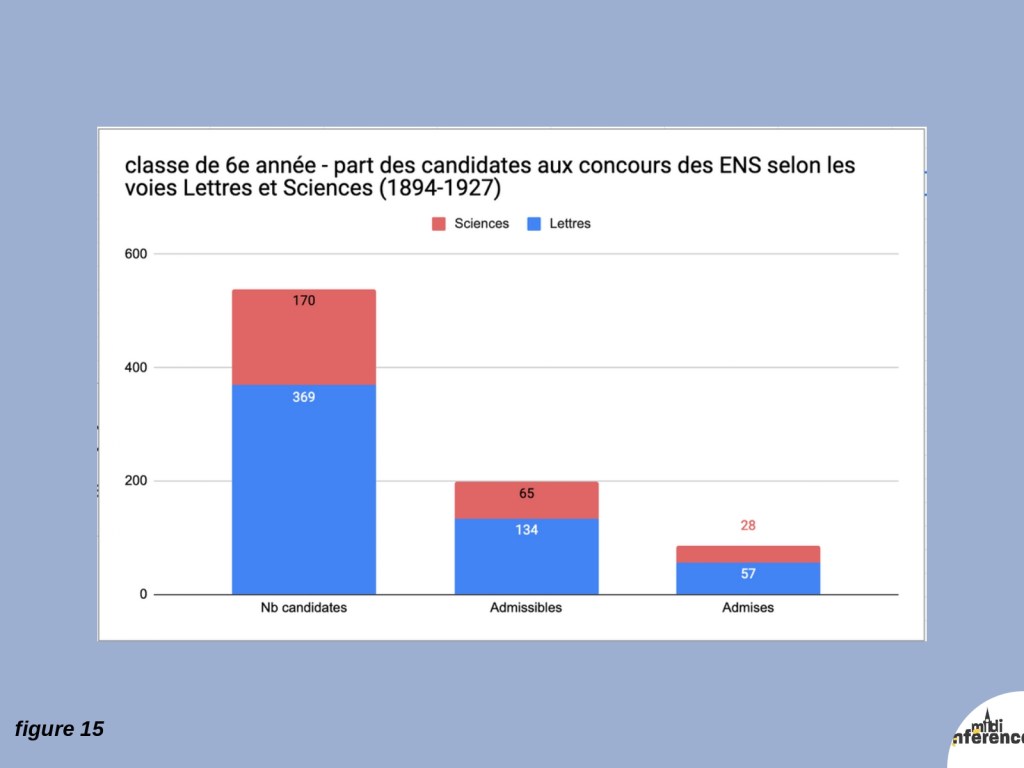
Une photo montre la classe de la 6e année voie Sciences de 1909/1910 : 25 jeunes femmes entourent deux femmes adultes, dont Mademoiselle Préjean (figure 15).
Le parcours de Marthe Baillaud, élève du lycée de la 1e à la 6e année, montre une trajectoire d’une de ces élèves choisissant la voie Sciences. Nièce de la première directrice et fille du scientifique Benjamin Baillaud, elle obtient tous ses diplômes au lycée de Toulouse, puis fait deux ans de 6e année pour intègrer l’ENS de Sèvres en 1901 où elle y suit les cours de Marie Curie. Elle est reçue à l’agrégation de Sciences Physique en 1904 et revient enseigner les Sciences au lycée de Toulouse quelques années (figure 16).
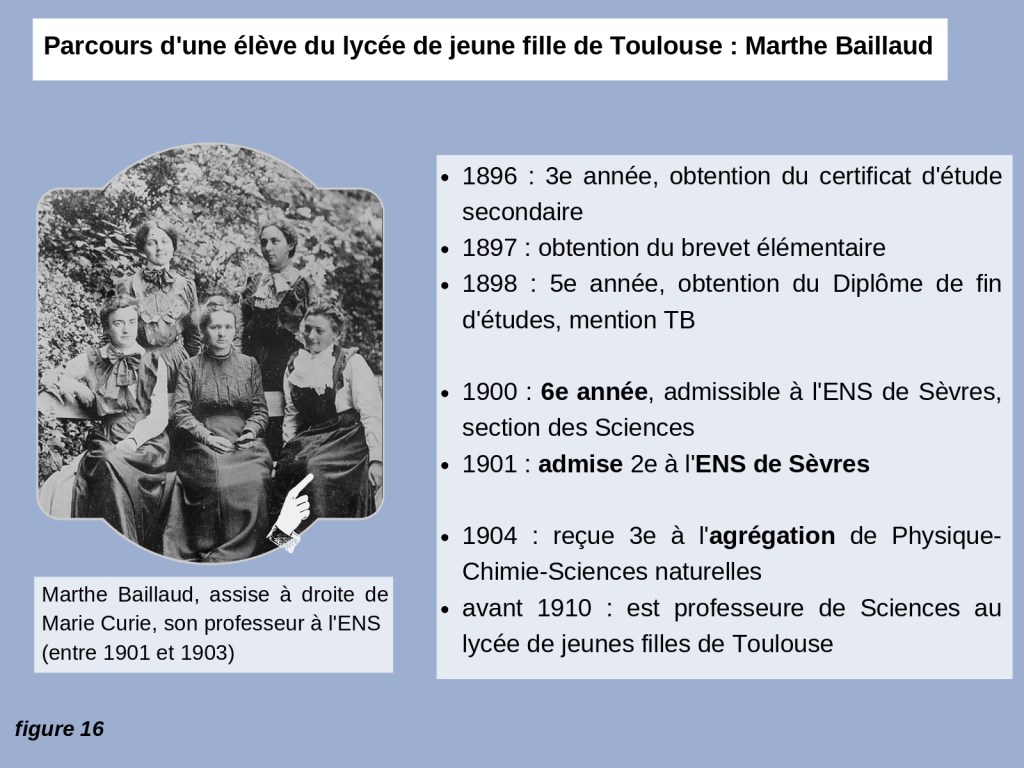
Cette 6e année « voie Sciences » est supprimée à Toulouse à partir de 1918-1919. La directrice, Madame Gonnet, qui a succédé à Mlle Baillaud en 1908, ne semble pas s’en émouvoir : les résultats d’admission étaient en baisse et cette directrice considérait qu’il fallait qu’il y ait en France un nombre limité de 6e année, fondé sur des critères de résultats, pour en maintenir le niveau. Elle se sert du démantèlement de cette filière pour réattribuer des moyens à d’autres besoins du lycée, notamment des heures de sciences dans d’autres classes pour dédoubler les effectifs et répondre aux attentes des familles qui envisagent de plus en plus le baccalauréat pour leurs filles. La voie « Lettres » est, en revanche, conservée. Par ailleurs, le développement du baccalauréat en parallèle permettait aux jeunes femmes voulant faire des sciences de le faire dans ce cadre et d’accéder ensuite à la faculté de Sciences. Enfin, en 1923, la loi autorise les jeunes filles à postuler à certaines classes préparatoires dans les lycées de garçons : il faudrait vérifier le nombre (sûrement anecdotique) de filles allant au lycée de garçons de Toulouse dans ce cadre.
Conclusion
Ne nous leurrons pas sur ces instruments scientifiques : ils n’ont pas tous été utilisés régulièrement et certains ont depuis le début encombré les placards. Le jury d’agrégation de Sciences Physiques en 1902 indique dans son rapport que « les collections [de bien des établissements] sont encombrées d’appareils surannés, mal conçus ou même absurdes, qui doivent disparaître ». Marthe Baillaud-Privat, ancienne élève et professeur de Sciences dans les années 1910, évoque dans ses souvenirs « un appareil historique dont on parle avec le plus grand respect, que l’on montre aux élèves, mais dont je n’ai jamais vu se servir ».
Cependant, le petit équilibriste des collections du lycée Saint-Sernin aura permis – avec aplomb – de découvrir quelques pans de l’histoire de l’enseignement des sciences auprès des filles, et notamment à Toulouse. Il invite ainsi à considérer tous ces objets du grenier avec un œil plus attentif : ces objets pédagogiques portent une histoire à qui veut et sait l’écouter.
Et cette histoire, ancrée dans la culture matérielle et dans les pratiques, est sans doute porteuse de joie, ce qui vaut d’être souligné dans un cycle de conférences placé sous le signe du gai savoir. Si l’approche expérimentale est riche de nombreuses vertus, sans doute faudrait-il mettre en avant le rôle des émotions dans les apprentissages et notamment faire l’éloge de la joie dans l’acte d’apprendre.
Le physicien et membre de l’Académie des Sciences Yves Quéré écrit dans un ouvrage récent : « Une expérience, une mesure, une observation investissent l’esprit et savent en général provoquer la joie (…). [La joie], face aux blocages de certains élèves, dilate l’esprit, aide à mieux apprendre et sait, en-deçà des mots, parler à l’enfant de la beauté car elle en est une émanation et, presque déjà, la marque. » (De la beauté. Vingt-six ariettes, Odile Jacob, p. 95).
Les deux autres conférences que j’aurai la joie de donner permettront d’explorer d’autres recoins de notre grenier pédagogique.
Bibliographie indicative :
Sur l’histoire de l’éducation et l’histoire de l’enseignement des sciences :
Antoine Prost, L’enseignement en France 1800-1967, Armand Colin, 1968 (plusieurs rééditions, un classique incontournable).
Françoise Mayeur, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, 1789-1930, tome 3, Perrin, Tempus, 2004.
Nicole Hulin, Les Femmes, l’enseignement et les sciences. Un long cheminement (XIXe – Xxe siècle), L’Harmattan, 2008.
Francis Gires (dir.), Encyclopédie des instruments de l’enseignement de la physique du XVIIIe au milieu du XXe siècle, ASEISTE, 2016.
Le site de l’ASEISTE (Association de sauvegarde et d’étude des instruments scientifiques et techniques de l’enseignement) : www.aseiste.org
Sur les objets en tant que sources et objets d’études historiques :
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Le Magasin du monde. La mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos jours, Fayard, 2020.
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Le Petit Magasin du monde, Fayard, collection « 1001 nuits », 2021.
Stéphane Audouin-Rouzeau, Les Armes et la chair. Trois objets de mort en 1914-1918, Armand Colin, 2009.
Neil MacGregor, Une Histoire du monde en 100 objets, Les Belles Lettres, 2010 (suite au projet du British Museum et de la BBC, « A History of the World in 100 objects » : https://www.bbc.co.uk/ahistoryoftheworld/about/british-museum-objects/)
Patrick Boucheron (dir.), Faire l’Histoire. Par le prisme des objets, série d’émissions produite par Arté depuis septembre 2021 : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020782/faire-l-histoire/
Sur l’histoire du lycée Saint-Sernin :
Le livret interactif :
Temps perdu et temps retrouvé. Emmanuel Lacoue-Labarthe 18-02-2022.

Temps perdu et temps retrouvé.
Emmanuel Lacoue-Labarthe
Podcast https://audioblog.arteradio.com/blog/177738/podcast/179256/temps-perdu-et-temps-retrouve-emmanuel-lacoue-labarthe-18-02-22
Introduction
Pour bien comprendre ce qu’est le temps perdu et si ce temps qu’on dit perdu peut être retrouvé, il faut d’abord clarifier un peu la notion de temps.
Cette notion renvoie en premier lieu au fait que l’univers physique dont nous faisons partie n’est pas figé ou éternellement immobile : il est au contraire en perpétuel mouvement et c’est cet inlassable et irréversible passage d’un état à un autre qu’on appelle le temps ou, du moins, que le temps mesure. Selon Aristote, en effet, le temps est le nombre du mouvement et non le mouvement lui-même.
Mais le temps, c’est aussi la succession du passé, du présent et du futur. Or cette succession, c’est Saint Augustin qui a montré qu’elle n’existe que pour et par la conscience. En effet, objectivement, c’est-à-dire indépendamment de toute conscience, le passé n’existe plus, le futur, lui, n’existe pas encore et le présent n’existe pas vraiment non plus puisqu’il ne se définit que par rapport au passé et au futur : il est ce qui n’est déjà plus futur, mais pas encore passé. Ainsi, la succession du passé, du présent et du futur n’existe que pour et par une conscience capable de rétention (de souvenir), d’attention présente et de projection vers l’avenir, car passé, présent et futur ne sont pas des réalités objectives, mais des modalités de la conscience. Saint Augustin écrit :
« Ce qui me paraît maintenant avec certitude, et que je connais très clairement, c’est que les choses futures et les passées ne sont point, et qu’à proprement parler on ne saurait dire qu’il y ait trois temps, le passé, le présent et le futur : mais peut-être on pourrait dire avec vérité, qu’il y a trois temps, le présent des choses passées, le présent des choses présentes, et le présent des choses futures. Car je trouve dans l’esprit ces trois choses que je ne trouve nulle part ailleurs : un souvenir présent des choses passées, une attention présente des choses présentes, et une attente présente des choses futures. » (Saint Augustin, Confessions, XI, 20)
Enfin, cette succession du passé, du présent et du futur, cette « durée vécue » comme il l’appelle, Henri Bergson nous a appris qu’elle n’est pas quantitative et homogène, mais, au contraire, qualitative et hétérogène :
— Elle est hétérogène, d’abord, parce qu’elle n’est pas composée de parties rigoureusement identiques juxtaposées régulièrement les unes aux autres : passé, présent et futur ne se succèdent pas de façon régulière et ils ne sont pas juxtaposés les uns aux autres : selon les moments de notre vie, nous vivons plutôt au passé, perdus dans nos souvenirs, au présent, captivés par ce que nous sommes en train de vivre ou au futur, accaparés par nos attentes et nos projets. De plus, passé, présent et futur s’interpénètrent constamment : notre présent est plein de souvenirs et de projets, nos souvenirs sont déterminés par notre présent et par nos projets, enfin nos projets sont le fruit de notre présent et de notre passé.
— La durée vécue est qualitative, ensuite, car ce qui détermine la façon dont le passé, le présent et le futur s’organisent dans notre conscience est le contenu qualitatif de ce que nous vivons : si ce que je vis est passionnant, je vais m’immerger dans le présent, si je vieillis et appréhende la mort, je vais à la fois anticiper cette fin avec angoisse et trouver refuge dans mes souvenirs, etc. De plus, tout changement quantitatif de la durée est en réalité immédiatement un changement qualitatif : quand je joue une mélodie plus lentement, je la rends plus méditative ou mélancolique, quand je la joue plus rapidement, je la rends plus vivante et dynamique. Et, quand je m’ennuie, le problème n’est pas que le temps passe lentement — puisque, comme me l’indiquent clairement les horloges, d’un point de vue quantitatif, le temps purement physique s’écoule de manière homogène et régulière —, le problème est qu’il est de mauvaise qualité, qu’il n’est pas intéressant.
C’est à partir de cette compréhension de la durée vécue comme phénomène hétérogène et qualitatif de la conscience qu’on peut poser le problème du temps perdu et du temps retrouvé.
1. Le temps perdu
1) Demandons-nous d’abord ce que c’est que perdre son temps.
Le temps perdu est-il un temps qui n’a pas été vécu ? À l’évidence non car, de notre naissance à notre mort, chaque instant de notre vie est nécessairement vécu, même si c’est quotidiennement sur le mode du sommeil et, parfois – mais heureusement rarement –, sur le mode de la perte de conscience (de l’évanouissement) ou du coma.
Le temps qu’on dit perdu est donc un temps que nous avons vécu, le plus souvent de façon consciente et éveillée et, parfois seulement, dans un état d’inconscience : il n’est pas un temps qui nous aurait été dérobé ou que nous aurions égaré quelque part comme lorsqu’on perd un objet. Au contraire, quand je suis en train de perdre mon temps, le temps que je perds est bien là : il est celui que je suis en train de vivre. De même, quand un parent vient dire à son enfant qui passe son après-midi sur sa console : « arrête de perdre ton temps à jouer à ces jeux stupides », le temps que l’enfant est en train de perdre (tout au moins selon son père ou sa mère) est celui qu’il est en train de vivre.
Le temps qu’on dit perdu est donc un temps vécu, mais mal vécu. Qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce qu’un temps mal vécu ?
Le problème, manifestement, est qualitatif : un temps mal vécu, c’est un temps dont on ne fait rien de riche, d’intéressant, de nourrissant, de substantiel. C’est un temps à l’intérieur duquel on ne fait rien d’autre que de passer le temps ou d’attendre que le temps passe. C’est un temps qui passe sans qu’on s’en saisisse vraiment, voire un temps qu’on fait passer par divers passe-temps, un temps qu’on « tue », conformément à l’expression « tuer le temps ».
C’est pourquoi, paradoxalement, prendre son temps, c’est-à-dire consacrer une plus grande quantité de temps à faire une chose, est bien souvent une manière de ne pas le perdre, c’est-à-dire de faire les choses bien, pleinement, d’un point de vue qualitatif. C’est, au contraire, quand je veux gagner du temps, quand je cherche à faire les choses le plus vite possible que, fréquemment, je les fais mal, de façon superficielle et imparfaite, et que, par conséquent, je perds mon temps : je l’emploie mal et n’en sors pas enrichi. Il arrive même, d’ailleurs, que je doive tout recommencer. « Vite fait, mal fait », comme on dit.
Il y a aussi les situations dans lesquelles je suis condamné à attendre sans avoir de quoi m’occuper intelligemment : par exemple, quand le médecin a du retard et que je passe une heure dans la salle d’attente sans rien d’autre à faire que lire les magazines disposés sur la table ou jouer sur mon téléphone. Cette heure passée à attendre ne m’est est en rien dérobée et elle n’est pas perdue comme un objet égaré : elle est vécue, mais pauvrement ; c’est une heure « pleine de vide ».
2) Le temps perdu, c’est donc le temps mal vécu, c’est le temps vide, pauvre, dont on ne fait rien d’intéressant. Et on voit bien que nous semblons fréquemment en grande partie responsables de ce phénomène : le temps perdu, c’est le temps dont je pourrais faire quelque chose, mais dont je ne fais rien, que ce soit par paresse, par imprévoyance ou en raison d’une vie intérieure insuffisamment riche :
– Au lieu de passer mon après-midi à regarder une série idiote, je pourrais lire un beau roman ou un recueil de poésie ; mais je suis trop paresseux et je préfère les plaisirs faciles.
– Quand je me rends chez le médecin, je pourrais anticiper le risque d’une longue attente et prendre toujours un livre avec moi de manière à ne jamais être coincé sans rien d’intéressant à faire. Mais je suis malheureusement imprévoyant.
– Enfin, même coincé et sans livre ou la moindre occupation intéressante, je pourrais, si ma vie intérieure était suffisamment riche, en profiter pour faire le point, pour méditer, me recueillir dans mes pensées, voire prier, s’il se trouve que j’aie des sentiments religieux. On imagine mal, par exemple, un moine chartreux s’ennuyer ou perdre son temps dans une salle d’attente tant sa vie spirituelle est sans doute riche et doit l’accompagner à chaque instant.
Il semble donc qu’on pourrait très bien ne jamais ou presque jamais perdre notre temps : il suffirait que nous soyons moins paresseux, plus prévoyants et que nous prenions le soin de nourrir notre vie intérieure.
2. Pascal et Proust
3) Pourtant, selon Blaise Pascal, l’homme est toujours en train de perdre son temps, c’est-à-dire d’appauvrir son présent. Dans l’une de ses Pensées (n° 80 édition Sellier), il écrit en effet :
« Nous ne nous tenons jamais au temps présent. »
Voici pourquoi :
– Parce que, si le présent « nous est agréable, nous regrettons de le voir échapper » : autrement dit, quand le présent nous plaît, au lieu d’en profiter et de le vivre pleinement, nous anticipons son passage, son futur caractère passé, et nous contaminons donc notre plaisir présent par des regrets anticipés. « C’est trop beau, ça ne va pas durer », se dit-on alors.
– Et si, au contraire, le présent « nous blesse », « nous le cachons à notre vue parce qu’il nous afflige ». Autrement dit, loin d’essayer de saisir l’éventuelle richesse de ce présent difficile et blessant, nous faisons tout pour le fuir en nous réfugiant soit dans nos souvenirs, soit dans l’attente du futur.
Ainsi, au lieu de nous concentrer sur le temps présent, qui est pourtant le seul qui soit fait de sensations actuelles, nous ne cessons pas de nous exiler vers le passé ou vers l’avenir. Pascal écrit :
« Nous anticipons l’avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme trop prompt, si imprudents que nous errons dans les temps qui ne sont point nôtres et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vains que nous songeons à ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. […]
Que chacun examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l’avenir. Nous ne pensons presque point au présent, et si nous y pensons, ce n’est que pour en prendre la lumière pour disposer de l’avenir. Le présent n’est jamais notre fin. »
Or cet exil hors du présent est une manière de l’appauvrir constamment : c’est une manière de perdre le temps que pourtant nous vivons, c’est-à-dire une manière de vivre à sa surface, de mal le vivre et de remettre sans cesse à plus tard la vie « enfin pleinement vécue » (pour parler comme Proust). D’où la conclusion de Pascal :
« Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre ; et, nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. »
Il y a donc là une façon de perdre le temps qui est globalement commune à tout le genre humain, mais contre laquelle on peut néanmoins essayer de lutter, comme Pascal nous y invite, en nous immergeant dans le présent afin de cueillir la substance et la richesse de chaque jour, aussi modeste et insensible soient-elles : carpe diem, écrit le poète Horace.
4) Mais, selon Proust, le problème du temps perdu ne se réduit pas à un simple manque d’attention au présent : selon lui, en effet, même pour celui qui est pleinement attentif et qui sait se tenir au temps présent, le temps est pourtant nécessairement toujours perdu, c’est-à-dire insuffisamment vécu.
En effet, même si l’on est attentif, même si l’on veille à cueillir le jour, on manque toujours de recul vis-à-vis du présent ; on a, en quelque sorte, le nez collé dessus, et l’on ne peut donc saisir, dans l’instant vécu toujours si immédiat et fugitif, que l’apparence des choses et non leur essence ou leur beauté intime. C’est pourquoi, selon Proust, la réalité immédiate est si souvent décevante : elle est rarement aussi riche et nourrissante qu’on le voudrait, car on sent que quelque chose d’elle, fatalement, nous échappe.
Le temps est donc toujours plus ou moins perdu et il nous faut sans cesse le retrouver après coup : on ne peut saisir l’essence des choses vécues que rétrospectivement, en revenant vers elles avec cette distance qui nous manquait initialement. Mais le souvenir ou la remémoration ne suffisent pas, car il leur manque les sensations réelles et actuelles qui sont la chair du présent : il faut donc qu’à la distance du souvenir s’ajoute la sensation présente, et c’est ce petit miracle que nous procure l’expérience de la réminiscence, qui est l’expérience du temps retrouvé ou, comme l’écrit Proust, du temps à l’état pur. Expliquons :
L’expérience de la réminiscence, c’est l’expérience présente d’une chose qui, en raison de son identité avec lui, réveille le souvenir d’un passé : l’inégalité des dalles de la cour de l’hôtel de Guermantes fait remonter le souvenir de l’inégalité des dalles du baptistère de Saint-Marc à Venise ; le tintement d’une cuiller contre une assiette fait remonter le souvenir d’un petit bois vu depuis un train arrêté dont un employé s’efforçait d’arranger la roue en la cognant avec son marteau, etc.
Or cette expérience est littéralement extra-ordinaire car elle possède à la fois l’ébranlement présent des sensations et le recul du souvenir : elle permet donc de vivre le présent avec un recul qui est habituellement impossible. Elle nous permet, dit Proust, de faire l’expérience d’objets qui sont « réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits » :
– «Réels sans être actuels» car ils sont réels par la sensation présente (les dalles inégales sous les pieds, le tintement de la cuiller contre l’assiette), sans pour autant être actuels grâce au recul du souvenir.
– «Idéaux sans être abstraits» car ils sont idéaux par le souvenir, sans pour autant être abstraits grâce à la sensation présente (les dalles inégales, le tintement de la cuiller).
L’expérience de la réminiscence, c’est donc l’expérience du temps retrouvé, c’est-à-dire du temps pleinement vécu, perçu dans toute sa richesse, ou encore du temps à l’état pur, selon l’expression de Proust.
Et cette expérience, qui nous place hors de l’ordre naturel du temps, nous permet de nous réapproprier notre durée, le temps que nous avons vécu et, dans cette mesure, elle enlève à la mort une grande partie de sa dimension angoissante, car, si la mort est effrayante, c’est surtout dans la mesure où elle est susceptible de nous empêcher de retrouver le temps perdu, c’est-à-dire de nous réapproprier pleinement ce que nous avons vécu. De sorte que, une fois le temps retrouvé, la mort ne peut plus vraiment nous séparer de nous-mêmes.
5) La réminiscence est donc la clé du temps retrouvé. Mais cet « expédient merveilleux de la nature », comme l’appelle Proust, étant imprévisible et éphémère (puisque le miracle de la réminiscence ne se commande et ne dure pas), il serait dommage d’attendre qu’il veuille bien se produire pour nous réapproprier notre vie.
Il a donc fallu inventer un autre expédient, un expédient merveilleux de la culture que l’on puisse produire volontairement afin de retrouver le temps perdu en quelque sorte à volonté. Cet autre expédient, c’est la littérature, qui, elle aussi, nous propose des objets « réels sans être actuels, idéaux sans être abstraits ». Quand je lis un roman, en effet :
– Je vis par identification tout ce que vivent les personnages et mon émotion est par conséquent bien réelle.
— Mais, en même temps, cette identification est identification à une fiction et j’ai donc vis-à-vis d’elle la possibilité de prendre un recul qui, dans ma propre vie, m’est refusé.
Ainsi, en lisant « d’autres vies que la mienne », pour paraphraser le titre d’un roman d’Emmanuel Carrère, je suis à la fois arraché et ramené à ma propre vie que je peux en effet ressaisir avec ce petit peu de recul qui, habituellement, me fait défaut. C’est pourquoi Proust écrit cette phrase si célèbre :
« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, le seule vie par conséquent pleinement vécue, c’est la littérature. » (Le Temps retrouvé, Pléiade, IV, p. 474).
Et il n’est pas interdit de penser, pour finir, comme Proust lui-même nous y invite, que ce n’est pas seulement la littérature, mais l’art en général, la peinture, la sculpture, la musique, etc., qui nous permet de retrouver le temps perdu :
« La grandeur de l’art véritable, […] c’est de retrouver, de ressaisir, de nous faire connaître cette réalité loin de laquelle nous vivons, […] cette réalité que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement notre vie. » (ibid.)
Enseignements et options LSH
Présentation de la formation LSS/BL
Pourquoi choisir une CPGE?
- Une formation rigoureuse dans un cadre scolaire dédié où l’élève est accompagné avec bienveillance.
- Un premier cycle généraliste qui mène à une grande variété de débouchés
- Uneformationpluridisciplinaire humainement riche et intellectuellement exigeante
Les atouts du Lycée SAINT- SERNIN
- Un pôle supérieur de CPGE littéraires comptant 450 étudiant.es dont 90 B/L
- Un enseignement varié : Sciences économiques et sociales / Mathématiques et, Langues vivantes (allemand, anglais, espagnol), Lettres, Histoire-géographie, Philosophie
- L’assurance de trouver des débouchés adaptés à un projet personnel affiné tout au long des deux années
- Des équipes dynamiques et impliquées
Répartition des cours
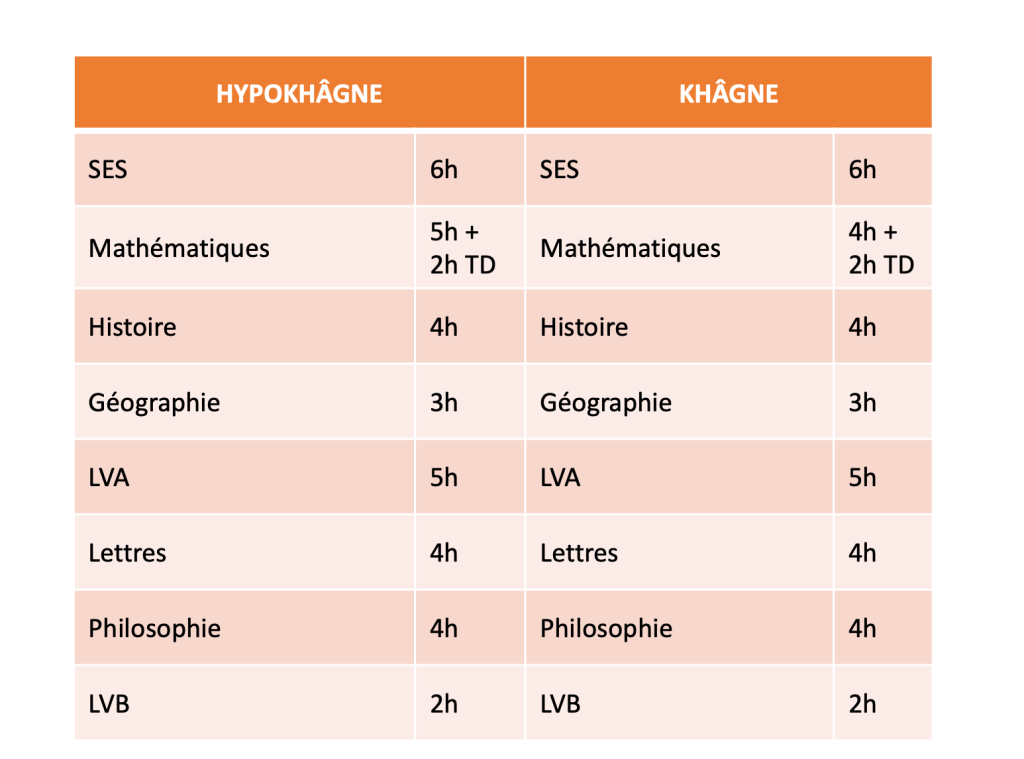
Emploi du temps de première année
Rythme de travail
| Devoirs surveillés | Chaque mercredi après-midi Durée: la plupart du temps 6h |
| « Colles » | 2 interrogations orales par semaineDurée: 30 minutes |
Les qualités requises
- Un bon niveau général dans les disciplines de terminale enseignées en CPGE BL
- Un bon niveau en mathématiques – EDS obligatoire en première et un enseignement de mathématiques en terminale.
- Capacité de travail, d’organisation et de concentration.
- Aptitudes à la rédaction
- Esprit de synthèse
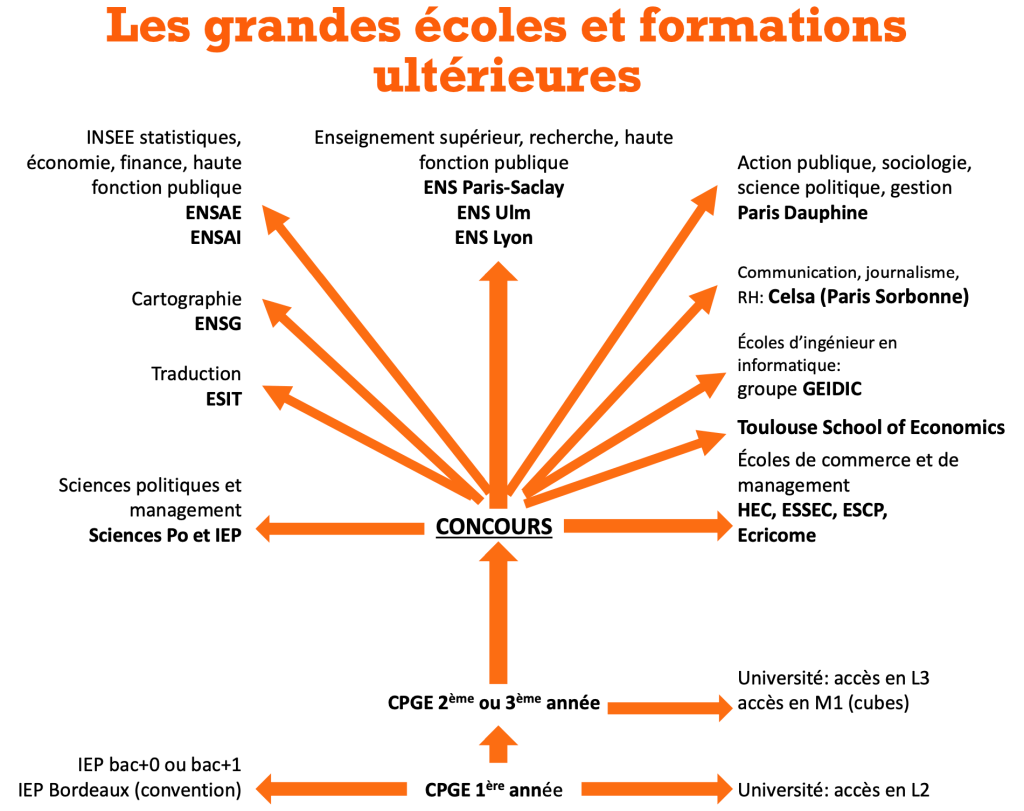
Les grandes écoles et formations ultérieures
INSEE statistiques, économie, finance, haute fonction publique ENSAE ENSAI
Cartographie
ENSG
Traduction
ESIT
Sciences politiques et management Sciences Po et IEP
Enseignement supérieur, recherche, haute fonction publique
ENS Paris-Saclay
ENS Ulm
ENS Lyon
Action publique, sociologie, science politique, gestion Paris Dauphine
Communication, journalisme, RH: Celsa (Paris Sorbonne)
Écoles d’ingénieur en informatique: groupe GEIDIC
Toulouse School of Economics
Écoles de commerce et de management
HEC, ESSEC, ESCP, Ecricome
Université: accès en L3 accès en M1 (cubes)
Université: accès en L
CONCOURS
IEP bac+0 ou bac+1 IEP Bordeaux (convention)
CPGE 2ème ou 3ème année CPGE 1ère année
Les débouchés professionnels
- Enseignement, recherche, haute fonction publique
- ENS Paris-Saclay // Sc Po Paris + ENA > ministère des Finances
- Licence anthropologie / linguistique + EHESS > chercheur en sciences cognitives
- ENSAI > Biostatiscienne à l’Institut Marie Curie
- Relations internationales
- IRIS > consultante gestion de crises humanitaires
- MRIAE > responsable communication en ONG, chargé de mission de coopération à l’ambassade de France au Costa Rica• traduction, journalisme
- École de journalisme de Paris > journaliste France télévisions
- ESIT > traductrice fonctionnaire au Parlement européen
- Communication,marketing
- Sciences PO Paris > relations publiques (FFR, Sodexo, Ogilvy, …)• Sc PO Paris + Institut Français de la Mode > analyste Business & Marketing Intelligence Chanel
Noirceur de l’Amour dans Le Songe d’une Nuit d’Été de William Shakespeare. Anne-Sophie André 25-01-2022.

Noirceur de l’Amour dans Le Songe d’une Nuit d’Été de William Shakespeare.
Anne-Sophie André
Introduction
« Pour donner des conférences, il faut être persuadé que, dans un quelconque domaine, on en sait plus que les autres – or, semblable domaine, je n’en connais pas« , écrivait la poétesse russe Marina Tsvétaeva en 1924 en réponse à l’invitation qui lui était faite de participer à une soirée littéraire. Pour parler d’amour, et a fortiori de la noirceur qui l’accompagne souvent, je suis tout aussi ignorante (ou savante!) que chacun d’entre vous. En revanche je dispose d’un guide précieux, William Shakespeare, dont l’œuvre poétique et théâtrale décline à l’infini cette thématique. J’ai choisi aujourd’hui d’en explorer les contours avec Le Songe d’une Nuit d’Été comme vade-mecum.
Cette comédie est l’une des plus populaires du canon shakespearien, et fit toujours partie de celles qui sont le plus représentées. Le monde des fées, en particulier, nourrit un certain imaginaire plein de fantaisie charmante depuis les illustrations popularisées à l’époque victorienne, souvent dérivées de tableaux comme celui-ci :

Titania et Bottom, par John Anster, (sous licence wikimedia commons).
Pourtant, quand on y regarde de plus près, il semble que ce divertissement soit tout sauf innocent.
En effet, l’intrigue se résume en ces termes :
Thésée, Duc d’Athènes, s’apprête à épouser Hippolyta, reine des Amazones et commande des spectacles afin de célébrer les noces avec faste.
Un groupe d’artisans athéniens entreprend alors de monter une version scénique de l’histoire de Pyrame et Thisbé.

Cet épisode des Métamorphoses d’Ovide se caractérise par une méprise qui aboutit à la mort des deux amants, après qu’ils s’étaient retrouvés nuitamment pour fuir leurs parents opposés à leur union. Shakespeare avait déjà employé cette trame, emblématique d’un amour tout aussi passionnel que funeste dans Roméo et Juliette. L’intrigue secondaire apporte ici au contraire un élément bouffon à la pièce, car elle semble vider le récit tragique de son sens tant les artisans sont ridicules.
Egée, un membre de la cour, demande par ailleurs à Thésée d’user de son autorité auprès de sa fille Hermia, qui refuse d’épouser Démétrius, le parti qu’il a choisi pour elle. Sommée par Thésée d’obéir ou de mourir, Hermia préfère s’enfuir dans la forêt aux côtés de Lysandre, celui qu’elle aime. Ils y seront rejoints par Démétrius, partis à leur poursuite, et Héléna, amoureuse de Démétrius et bien décidée à l’épouser.
En parallèle, Oberon et Titania, roi et reine des fées, et suzerains du monde nocturne de la forêt, se querellent autour d’un enfant dont Oberon est jaloux. Afin de se venger de Titania, il ordonne à Puck, son elfe de main pour ainsi dire, de recueillir un élixir qui la fera tomber amoureuse du premier objet que son regard croisera au réveil. Ce sera Bottom le tisserand, l’un des apprentis comédiens, que le malicieux Puck a affublé d’une tête d’âne.
Ce très bref résumé permet de comprendre qu’en fait de pièce appropriée à la célébration de noces, Le Songe nous offre au contraire une vision très sombre de la relation de couple puisque elle semble vouée au tragique (Pyrame et Thisbé) ou à l’humiliation (Oberon et Titania).
Derrière le travestissement comique d’un mythe tragique, Shakespeare nous donne donc à voir et entendre des variations grinçantes où la noirceur des ténèbres nocturnes colore insensiblement les joutes amoureuses, déjà entachées du sang de Pyrame et Thisbé qui donna sa couleur noire au fruit du mûrier.
J’aborderai dans cet esprit les trois grand points suivants :
1. Un amour noir du fait des conventions sociales / juridiques de l’époque
2. Un amour noir lié à une construction érotique de la contrainte et de la cruauté
3. Un amour noir car il ne peut y avoir d’amour pur qui ne le soit
1. Un amour noir du fait des conventions sociales / juridiques de l’époque
A. Egée / Hermia : I, 1, l. 41-42 :
Dès l’entrée en scène d’Égée, la relation maritale est inscrite dans un cadre juridique. En effet ses premiers mots sont « je viens me plaindre » , et c’est bien à Thésée, premier magistrat de la cité athénienne, qu’Égée énonce ses griefs envers sa fille Hermia. Il conclut sa péroraison avec les vers suivants :
Je revendique l’ancien privilège d’Athènes :
Puisqu’elle est mienne, je peux disposer
d’elle,
Pour la livrer, soit à ce gentilhomme,
Soit à la mort, en accord avec notre loi
Qui ne prévoit aucun sursis en pareil cas
I beg the ancient privilege of Athens:
As she is mine, I may dispose of her;
Which shall be either to this gentleman,
Or to her death, according to our law
Immediately provided in that case
Dans cette réplique d’Egée, l’amour paternel s’est métamorphosé en discours de juriste, enserrant le corps et la personne d’Hermia, réduite à la fonction d’objet (« her ») dans les mailles d’un filet juridique, où la noirceur d’un désir de possession absolu qui ne dit pas son nom se cache derrière des justifications légales. Notons, en passant, l’usage du modal « may » en anglais, qui exprime la possibilité, mais surtout correspond à la forme du français « puis » (je puis disposer d’elle), avec toutes les connotations implicites de puissance que cela sous-entend.
La dernière réplique d’Egée (Acte IV, s. 1, l. 151 sq) :
Assez, assez mon seigneur: vous en avez entendu assez.
Je réclame la loi, la loi sur sa tête;
Ils voulaient se sauver, ils voulaient, Démétrius,
Nous escroquer vous et moi :
Vous de votre épouse, et moi de mon consentement,
De mon consentement qu’elle soit votre épouse.
Enough, enough my lord ; you have enough
I beg the law, the law upon his head !
They would have stol’n away, they would, Demetrius,
Thereby to have defeated you and me,
You of your wife and me of my consent,
Of my consent that she should be your wife.
met en scène de façon emblématique dans le texte anglais ce qui compte aux yeux d’Egée, à savoir « my consent », que l’anadiplose met tout particulièrement en relief. Les anaphores, qui ne manquent pas d’évoquer Molière et son Avare à des oreilles francophones, cachent sous l’effet comique la violence faite à Hermia, mais aussi la réalité crue que le mariage dissimule.
B. L’enjeu érotique des corps
En effet, le mariage trouvant, derrière le masque social des alliances politiques et / ou économiques, in fine son aboutissement dans un rapport sexuel, on constate ici l’enjeu érotique que représente le corps d’Hermia, dont presque jusqu’au bout son père ne voudra abandonner le contrôle, comme si, d’une certaine façon, la remarque en forme de boutade adressée par Lysandre ((I, 1, l. 92-93) :
Vous avez l’amour de son père, Démétrius :
Laissez-moi celui d’Hermia; épousez-le.
You have her father’s love Demetrius;
Let me have Hermia’s – do you marry him.
(I, 1, l. 92-93)
traduisait une vérité profonde : Egée éprouve pour sa fille un désir que l’on qualifierait aujourd’hui d’incestueux, désir qu’il ne pourrait assouvir que par l’entremise d’un mari par lui adoubé comme projection fantasmée de lui-même.
Ce déplacement du désir sur un objet intermédiaire trouve aussi à s’incarner dans le monde des fées, puisque la querelle entre Oberon et Titania a pour origine le désir suscité par un jeune enfant, dont le spectateur moderne a souvent du mal à saisir la fonction ultime. Du point de vue du mécanisme dramatique, toutefois, cet enfant sert de prétexte à Shakespeare pour de souligner la nature possessive de l’érotisme qui sous-tend toute la pièce, avec tout ce que cela implique de noirs désirs.
2. Un amour noir lié à une construction érotique de la contrainte et de la cruauté[1]
A. Thésée / Hippolyta
Thésée est présenté par la mythologie comme un grand séducteur, peu soucieux des cœurs qu’il brise sur son passage. Il est donc tout-à-fait remarquable de le voir ici sur le point de convoler en justes noces, ou, à tout le moins, en noces spectaculaires (I, 1, l. 18). Que nous dit-il cependant (ou plutôt que dit-il à Hippolyta) ?
Hippolyta, je t’ai courtisée avec mon épée,
Et j’ai conquis ton amour en te faisant violence
Hippolyta, I wooed thee with my sword,
And won thy love doing thee injuries;
Faites-bien attention au choix des pronoms personnels : thee / thou suggèrent une réelle intimité, une proximité scénique entre les deux personnages. Thésée ne clame pas ce qu’il a fait, il le susurre à l’oreille d’Hippolyta et si l’on se penche sur le sens des mots, ce qu’il lui dit est tout bonnement horrible : le jeu attendu word et sword (connotation phallique; viol) et l’affirmation que de ce viol l’amour d’Hippolyta est né laissent sans voix. Bien sûr, comme toujours en littérature, le jeu entre signifiant et signifié est essentiel, et l’on peut interpréter les propos de Thésée à l’aune du discours amoureux de la Renaissance, filant la métaphore de l’amour et de la guerre ou de l’amour et de la chasse. Mais il me semble impossible de ne pas aussi entendre le sens réel des mots mis dans sa bouche, et d’en suivre l’écho qui résonne tout au long de la pièce, et en premier lieu dans la relation entre Oberon et Titania.
B. Oberon / Titania
Dès son arrivée sur scène, l’autre couple fondateur de la pièce, puisqu’il est à l’origine de tous les dérèglements, se distingue par un antagonisme virulent, dont les conséquences se font sentir à tous les niveaux.
Titania, de prime abord, semble avoir la haute main sur leur relation (cf. II, 1, 61 : « I have forsworn his bed and company » / « J’ai abjuré son lit et sa compagnie. »), même si, lorsqu’Oberon lui rappelle qu’il est « son seigneur », elle reconnaît le lien qui est censé les unir (« Then I must be thy lady. » / « Alors je dois être ta dame. ») Un glissement s’opère toutefois rapidement vers le pronom « you » (vous), suggérant un éloignement physique perceptible sur scène. Au contraire, Oberon cherche à envahir son espace puisqu’il lui répond en utilisant « thou ». Tout leur dialogue est rythmé par ce jeu des pronoms, suggérant une forme de parade amoureuse en parallèle à la joute verbale. Mais ce qui, dans Beaucoup de Bruit Pour Rien par exemple, est resté de l’ordre du jeu brillant d’un érotisme verbal à fleurets mouchetés, prend ici une toute autre tournure avec le vœu fait par Oberon.
Tu ne sortiras pas de ce bosquet
Avant que je t’aie tourmentée pour cet affront.
Thou shalt not from this grove
Till I torment thee for this injury.
En refusant d’obéir à Oberon, Titania remet en cause les lois fondamentales du mariage, ce qui justifie toutes les formes de punition pour ramener l’ordre.
Jan Kott, dans Shakespeare Notre contemporain[1], a eu des pages très justes sur l’érotisme bestial de la pièce que le stratagème d’Oberon fait émerger; je n’y reviendrai pas sauf à souligner que la scène transgressive par excellence, celle de l’union entre Titania et Bottom n’est, dans le texte, que préfigurée sur scène (contrairement à ce qui nous est donné à voir dans la plupart des mises en scène modernes). Elle relève de l’indicible par excellence (« methought I was… » repris par Titania comme par Bottom , voir IV, 1, l.200-207), pour une raison assez simple : Titania est à l’initiative de l’acte sexuel contre-nature.
Sa forme bestiale est l’incarnation de ce qui, pour la société élisabéthaine, était littéralement impensable, à savoir qu’une femme soit à l’initiative et dominante : Acte III, s. 1, l. 126 :
Ne désire pas sortir de ce bois :
Que tu le veuilles ou non, ici tu resteras
Out of this wood do not
desire to go :
Thou shalt remain here,
whether thou wilt or no
Titania peut bien ajouter « I do love thee », on voit ici que la contrainte est essentielle à l’accomplissement du désir amoureux. Le scandale étant, évidemment, que Titania renverse à son profit la contrainte énoncée posément par Égée ou Thésée. (On pourrait d’ailleurs commenter le jeu paronomastique sur wood / woo’d en anglais, ainsi que la polysémie de wood, terme souvent associé aux érections matinales…)
C. Fonction de la forêt
Ce renversement contre nature de l’ordre amoureux est, dans le cadre de l’intrigue, la conséquence d’une « égression » vers un espace marginal, limitrophe de la cité athénienne mais non soumis, du moins en apparence, à ses lois.
Il s’agit bien sûr de la forêt vers laquelle Lysandre entraîne Hermia pour se soustraire à loi athénienne. Cette forêt revêt une valeur juridique et symbolique complexe à l’époque de Shakespeare, qui explique la place centrale qu’elle occupe dans la pièce.
La nuit fuligineuse et la forêt s’unissent donc pour former un espace du rêve (Hermia, Titania, Bottom)qui est aussi un espace rêvé. Ce sont les quatre jeunes amants qui y sont mis en scène, avec chacun leur dose d’animalité, démontrant une fois de plus la noirceur du sentiment amoureux une fois réduit à sa composante essentielle, le désir.
3. Un amour noir car il ne peut y avoir d’amour pur qui ne le soit
A. Le songe d’Hermia (II, 2, l. 151-160)
Au cours de cette nuit, Hermia fait un cauchemar dont elle s’éveille en s’écriant :
Au secours, Lysandre, au secours, fais l’impossible
Pour arracher ce serpent qui rampe sur ma poitrine!
Hélas! Par pitié ! Quel rêve était-ce là?
Lysandre, regardez comme je tremble de peur.
Il me semblait qu’un serpent dévorait mon coeur, Et que vous assistiez en souriant à son cruel assaut.
Help me, Lysander, help me, do thy best
To pluck this crawling serpent from my breast! Ay me, for pity! What a dream was here? Methought a serpent ate my heart away,
And you sat smiling at his cruel prey.
Freud se serait bien amusé avec ce rêve, dont la symbolique est on ne peut plus explicite. Hermia, après avoir enjoint Lysandre de la laisser dormir à une chaste distance, s’éveille en croyant qu’un serpent s’est enfoui dans son sein. Fantasme à peine déguisé de pénétration, la formulation du vers pose tout de même question, dans la mesure où, selon toute logique, le serpent représente ici le sexe de Lysandre, or Hermia l’appelle à l’aide pour « arracher » le monstre de son corps. La suite du monologue suggère qu’Hermia a entendu dans son sommeil la tirade enflammée adressée par Lysandre (victime comme Titania du suc magique) à Héléna, et ce savoir inconscient s’est manifesté sous la forme du serpent (trahison, jalousie) ; mais les deux premiers vers sont riches d’ambiguïté et suggèrent, en creux, le clivage que la perte de la virginité et la perspective de la possession physique créent chez Hermia.
Surtout, la dénaturation du regard posé sur elle (l. 156) :
« …vous assistiez en souriant à son cruel assaut »
est révélatrice de cette noirceur fondamentale du sentiment amoureux : certes Lysandre est sous l’emprise de la potion de Puck, mais cela déclenche chez lui une haine cruelle envers celle qu’il affirmait aimer passionnément quelques vers plus haut. Cette haine fait tomber le masque sur le désir de possession qui est à la base de tout. Le mot anglais « prey » souligne la nature inhérente à la relation amoureuse, fondée sur la prédation d’un sexe sur l’autre, ce que la relation entre Héléna et Démétrius (II, 1, 188-242) illustre de façon spectaculaire. Cette scène, où le dialogue regorge d’expressions métaphoriques de la blessure amoureuse, explore toutes les dimensions noires de l’amour chez Shakespeare, jusqu’à une forme de folie auto-destructrice lorsqu’Héléna s’écrie
Je suis votre épagneul ; et, Démétrius,
Plus vous me battez, plus je me couche à vos pieds.
Traitez-moi seulement comme votre épagneul : repoussez-moi, frappez-moi,
Méprisez-moi, abandonnez-moi; seulement permettez-moi
(Tout indigne que je sois) de vous suivre.
Quelle place plus humble puis-je mendier dans votre amour
(Une place pourtant que j’estime hautement)
Que d’être traitée comme vous traitez votre chien?
I am your spaniel; and, Demetrius, The more you beat me I will fawn on you.
Use me but as your spaniel: spurn me, strike me,
Neglect me, lose me; only give me leave,
Unworthy as I am, to follow you. What worser place can I beg in your love
(And yet a place of high respect with me)
Than to be usèd as you use your dog?
Pour citer une dernière fois Jan Kott, « seule subsiste la nudité du désir ». Je nuancerais toutefois cette grille de lecture masculine, car au désir féminin mis à nu répond encore une fois une forme de volonté de puissance masculine tout entière tournée vers l’anéantissement : Démétrius rétorque en effet avec éloquence (« si tu me suis, sois assurée que je te ferai outrage dans ce bois ») : s’il la viole, elle l’aura bien cherché ! On notera la constance du jeune Athénien : pour lui, la relation amoureuse (dans toutes ses composantes) ne peut se concevoir que forcée, reflet sans doute d’une ambition sociale qui lui tient lieu de boussole morale.
La pièce bouffonne du cinquième acte, qui met en scène de façon burlesque les conséquences tragiques de la passion amoureuse (Le Songe reste une comédie), évoque ainsi en creux la composante sombre du sentiment amoureux, qui, lorsqu’il se déploie pleinement, impose une sorte d’anéantissement du moi.
Conclusion
On pourrait croire que Shakespeare ne propose à ses spectateurs qu’une vision désespérée de l’amour (et certainement, si vous voyez Hamlet ou Un Conte d’Hiver, vous êtes en droit de le penser !), mais n’oublions pas que ces jeux scéniques sont avant tout l’expression d’une esthétique baroque au sens premier du terme, mêlant farce et tragique afin de mieux mettre en avant ce qui est le propre de notre humaine condition. Cette photo prise lors des représentations du Songe à la Comédie Française, dans la mise en scène de Muriel Mayette en 2014-15 reflète assez bien, me semble-t-il, ces contorsions de nos âmes et de nos corps. Je vous remercie.

Adeline d’Hermy, Laurent Laffitte, Sébastien Pouderoux, Comédie Française, 2013-14, ©Christophe Raynaud de Lage
[1] Jan Kott, Shakespeare notre contemporain, 1962, 2006 édition Payot, pp. 242-247
[1] Compte tenu du format resserré de nos conférences, je ne parlerai pas de la concordia discors, qui mériterait un développement assez long à elle seule, et une analyse fine du lexique de la chasse mais aussi de la musique.
BIENVENUE
Bienvenue sur prepaSernin
et merci de votre visite
« L’ouverture culturelle offerte par ce cursus
et par des professeurs passionnés
m’a beaucoup marquée
et est difficile à retrouver dans d’autres voies » (Laura)
Ce site est dédié à la présentation de la formation et du projet culturel en CPGE Lettres et sciences humaines (LSH/AL) et Lettres et sciences sociales (LSS/BL) au lycée Saint-Sernin.
site ENT
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/classes-preparatoires-al-lsh/
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/classes-preparatoires-bl-lss/
L’engagement Emmanuel Lacoue-Labarthe 14-01-22.

L’engagement
Emmanuel Lacoue-Labarthe
Podcast :https://prepasaintsernin.com/2022/01/12/lengagement-emmanuel-lacoue-labarthe-14-01-22/
Introduction
1) Il y a quelques mois, je me suis engagé à venir parler aujourd’hui de l’engagement : alors, commençons !
Le mot « engagement » est formé à partir du verbe « engager » qui, étymologiquement, signifie « mettre en gage », c’est-à-dire déposer ou laisser une chose entre les mains de quelqu’un à titre de garantie. Et ce mot renvoie principalement aux deux sens suivants :
a) Un engagement, c’est d’abord l’acte par lequel un homme se lie à un autre ou à un groupe, c’est-à-dire se soumet à une obligation à son égard. Cet engagement peut prendre deux formes :
Il est purement « moral », c’est-à-dire dénué de contraintes juridiques, quand il prend la forme d’une promesse.
Il est « juridique » quand il prend la forme d’un contrat, au respect duquel une institution judiciaire peut contraindre les contractants.
b) L’engagement, c’est ensuite le fait de se mettre au service d’une cause, quelle qu’elle soit : morale, politique, sociale, culturelle, sportive, etc.
Et une cause, c’est une somme d’intérêts qui demandent à être soutenus afin de pouvoir l’emporter ou de ne pas être écrasés, c’est un ensemble d’intérêts à défendre.
2) Il y a donc deux formes d’engagement (les promesses et contrat et le soutien d’une cause) au sujet desquelles, on peut poser les problèmes suivants :
a) D’abord, au sujet de l’engagement comme promesse ou contrat, on peut se demander quel en est le but : dans quel but les hommes se lient-ils les uns aux autres ? Pourquoi acceptent-ils d’aliéner ainsi leur liberté et jusqu’où faut-il accepter une telle aliénation de la liberté ?
b) Ensuite, au sujet de tout engagement — promesse, contrat ou soutien d’une cause —, on peut se demander si l’engagement est seulement pour l’homme une possibilité qu’il est libre d’emprunter ou non, ou bien s’il n’est pas plutôt un fait indissociable de toute existence et, par conséquent, une nécessité au sens philosophique de ce qui ne peut pas ne pas être. De telle sorte que, même si c’est souvent sans le savoir, nous serions tous toujours profondément engagés.
L’enjeu de cette petite conférence serait donc de montrer que l’engagement, sous ses deux formes principales, est un élément essentiel de la condition humaine.
I. Promesses et contrats
Au sujet des promesses et des contrats, la question est donc triple :
– À quoi servent les promesses et les contrats ?
– Jusqu’où faut-il aliéner sa liberté ?
– N’est-on engagé que lorsqu’on s’est engagé explicitement par une promesse ou un contrat ou bien est-on toujours en quelque manière engagé ?
1. La fonction des promesses et contrats
Il y a une autrice majeure qui nous aide à répondre à cette question, c’est la philosophe Hannah Arendt dans son livre intitulé Condition de l’homme moderne.
En effet, en analysant l’action humaine, Arendt constate que celle-ci possède deux caractéristiques qui la freinent de manière dommageable :
– Son irréversibilité : ce qui est fait, est fait définitivement (même si on peut parfois le défaire ou le réparer), ce qui rend le fait d’agir un peu effrayant.
– Son imprévisibilité : on ne sait jamais avec certitude comment l’homme va agir ou réagir et l’avenir est par conséquent toujours incertain de ce point de vue.
Or, pour tenter de remédier à ces deux facteurs qui dissuadent d’agir, les hommes ont inventé à la fois le pardon et la promesse :
– Le pardon permet, non d’effacer, mais de dépasser la faute et de donner à l’autre une « deuxième chance » : il est la solution à l’irréversibilité de nos actes.
– La promesse, elle, permet de lutter « contre l’imprévisibilité, contre la chaotique incertitude de l’avenir ». Elle permet de « disposer, dans cet océan d’incertitude qu’est l’avenir par définition, des îlots de sécurité sans lesquels aucune continuité, sans même parler de durée, ne serait possible dans les relations des hommes entre eux ».
S’engager (au sens de la promesse ou du contrat) est donc un acte salutaire :

La promesse salutaire (1927)
il est bon de savoir s’engager, car s’engager c’est offrir aux autres cette sécurité qui n’appartient pas à l’avenir. En amour, par exemple, l’engagement est essentiel parce qu’il ne peut pas y avoir d’amour serein lorsque plane la menace de l’infidélité, du « dégagement ». L’engagement est donc une forme de générosité qui permet aux hommes de compter les uns sur les autres : l’homme de parole (= celui qui tient sa parole ou n’a qu’un parole) est en effet identifié et aimé comme celui « sur qui on peut compter ».
2. Jusqu’où faut-il aliéner sa liberté ?
On peut penser que nos engagements doivent avoir deux limites :
a) D’abord, on ne doit jamais s’engager à renoncer à sa liberté, c’est-à-dire s’engager à une obéissance servile. Comme le dit Rousseau : « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa qualité d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs » : toute promesse ou contrat qui implique la soumission servile est donc illégitime.
b) Nul ne peut ni ne doit s’engager pour ce qui ne dépend pas de sa liberté :
– En amour par exemple, si on peut s’engager à la fidélité ou à la franchise, on ne peut pas s’engager à aimer toujours parce que les sentiments ne se commandent pas.
– De même, en politique, si on peut s’engager à respecter la discipline d’un parti, on ne peut pas s’engager à être toujours d’accord avec sa ligne officielle parce que la pensée ne se commande pas non plus complètement.
L’engagement doit donc rester une « restriction » de la liberté et non devenir une « aliénation » de la liberté.
3. Est-on toujours engagé ?
1) Demandons-nous maintenant si l’on n’est engagé que quand on a fait une promesse explicite ou signé un contrat. À cette question, le philosophe Georges Gusdorf, dans son ouvrage intitulé La parole, répond que toute parole est une promesse et non seulement celles qu’on appelle explicitement des promesses. Son raisonnement est le suivant :
a) En parlant, chaque homme se construit, s’affirme comme individu et noue une relation originale, personnelle, avec le monde et avec autrui : « La parole définit une instance suprême de la personne, le dernier mot, ou le premier, de l’existence en sa spontanéité, attestation de l’être singulier s’affirmant et se réaffirmant à la face du monde. » (p. 117)
b) Par conséquent, toute parole, même si elle ne contient aucun engagement formel, est une sorte de « promesse ». En effet, par chacune de mes paroles, je m’affirme, je me définis, je définis un certain rapport au monde et je donne par conséquent aux autres une certaine image de moi sur laquelle ils vont s’appuyer pour agir, décider, s’attacher, etc. Conclusion : nos paroles, quelles qu’elles soient, sont les messagères de notre identité et, dans cette mesure, elles nous engagent :« Toute parole […], même si elle n’a pas été formulée sous la foi du serment, est une promesse, et nous devons veiller à ne pas profaner nous-même un langage où les autres lisent le chiffre de notre vie personnelle. » (p. 119)
c) Georges Gusdorf tire une série de conséquences éthiques de sa thèse, qu’on peut résumer ainsi : la parole, étant promesse, doit être respectée et tenue : elle n’est pas seulement quelque chose qu’on prend, mais aussi et surtout quelque chose qu’on donne : parler, c’est donner sa parole, toute parole est parole donnée (diapo 8) :
« Si la parole est promesse, elle ne vaut que tenue […]. Tenir sa parole, c’est faire effort pour maintenir un certain sens de soi-même, dont on a une fois reconnu qu’il est constitutif de l’existence personnelle. » (p. 119-120)
II. Le soutien d’une cause
Demandons-nous, pour finir, ce qu’il en est de l’engagement au sens du soutien d’une cause : y a-t-il des hommes engagés tandis que d’autres ne le seraient pas ou le seraient moins ?
1) Dans Qu’est-ce que la littérature ? et dans sa présentation de la revue Les Temps modernes, Sartre pose cette question au sujet de l’écrivain : y a-t-il des écrivains engagés tandis que d’autres ne le seraient pas ou le seraient moins ? Et il défend l’idée que l’engagement n’est pas pour l’écrivain une simple option, mais un fait incontournable, auquel il lui est impossible d’échapper. Pourquoi ? Parce que :
– L’écrivain est un parleur, or « parler c’est agir : toute chose qu’on nomme n’est déjà plus tout à fait la même, elle a perdu son innocence. » (p. 27)
– Ainsi, un écrit, quel qu’il soit, est toujours « une entreprise » (p. 40) qui engage son auteur (= dont il doit répondre) et par laquelle son auteur prend nécessairement position à l’égard du monde, par laquelle, qu’il le veuille ou non, il s’engage en faveur d’une certaine idée du monde : « De quelque façon que vous y soyez venu, quelles que soient les opinions que vous ayez professées, la littérature vous jette dans la bataille ; écrire c’est une certaine façon de vouloir la liberté ; si vous avez commencé, de gré ou de force, vous êtes engagé. » (p. 72)
« Pour nous, en effet, l’écrivain […] est « dans le coup », quoi qu’il fasse, marqué, compromis, jusque dans sa plus lointaine retraite. » (Situations II, p. 12).
3) Or ces formules renvoient plus ou moins explicitement à celle de Blaise Pascal (diapo 11) qui, au libertin qui voudrait ne parier ni pour ni contre l’existence de Dieu (puisqu’on ne peut prouver ni son existence ni son inexistence), répond la chose suivante : « Oui, mais il faut parier. Cela n’est pas volontaire, vous êtes embarqué. » (Pensées, fr. 680 Sellier).
Si l’on étend la pensée de Pascal au-delà de la seule question du pari pour ou contre l’existence de Dieu, l’idée est la suivante : l’existence nous incombe à la manière d’un fait qui n’offre aucune position de retrait : elle n’est pas comparable à un fleuve dont on pourrait sortir pour l’observer depuis la rive : elle cette réalité dans laquelle nous sommes immergés et au sein de laquelle nous prenons nécessairement et inévitablement position. Exister, c’est être impliqué qu’on le veuille ou non, et tout retrait n’est qu’une façon parmi d’autres de prendre position.
Conclusion : tout comme la promesse est apparue avec Gusdorf comme la vérité cachée de toute parole, de même, l’engagement pourrait bien être la vérité cachée de toute existence, même la plus apparemment dégagée et indifférente aux affaires du monde. L’engagement serait donc, en un sens, la vérité de la condition humaine elle-même.
4) Dans ces conditions, la vraie frontière ne se situe donc pas entre engagement et dégagement, entre des vies engagées et des vies spectatrices, mais entre des vies inconsciemment ou passivement engagées et des vies consciemment ou activement engagées : « Si tout homme est embarqué cela ne veut point dire qu’il en ait pleine conscience : la plupart passent leur temps à se dissimuler leur engagement. »
Conclusion : l’engagement, au sens du soutien d’une cause, n’est donc pas une simple option facultative : il est un fait auquel nous sommes condamnés, qu’on le veuille ou non, car, de même que « se taire ce n’est pas être muet, c’est refuser de parler, donc parler encore » (p. 30), de même se désengager est encore une façon de s’engager : « Serions-nous muets et cois comme des cailloux, notre passivité même serait une action. » (Situations II, p. 13)
Mais ce fait incontournable de l’engagement nous laisse cependant entièrement libres de deux choses :
– Nous sommes d’abord libres de choisir ce pour quoi nous souhaitons nous engager, c’est-à-dire la ou les cause(s) que nous jugeons dignes d’être soutenues.
– Nous sommes ensuite libres de choisir la façon dont nous souhaitons être engagés ou nous engager : de façon passive ou active, militante ou plus mesurée, avec bonne ou mauvaise foi, etc.
D’ailleurs, au sujet des écrivains qui, contrairement à lui, ont revendiqué une absence d’engagement et se sont rangés du côté de « l’art pour l’art », non seulement Sartre reconnaît que « l’on trouve parmi eux quelques-uns de nos écrivains les plus grands et les plus purs », mais encore il reconnaît le mérite de leur parti pris, qui n’est pourtant pas le sien :
« Comme chaque conduite humaine nous découvre un aspect de l’univers, leur attitude nous a enrichis en dépit d’eux-mêmes en nous révélant la gratuité comme une des dimensions infinies du monde et un but possible de l’activité humaine. » (p. 150)
Conclusion : engagés, nous le sommes donc quoi qu’il arrive ; et si, comme les soldats romains après le passage de la tornade gauloise, il nous arrive de regretter nos engagements, eh bien il est toujours temps d’en changer.

La juste guerre (1) Laurent Cournarie 6-1-22.

La juste guerre
Laurent Cournarie
Conférence en remplacement de la Midi-Conférence de G. Kenny : »William Shakespeare, génie ou imposteur », initialement prévue et reportée à une date ultérieure.
Podcast : https://soundcloud.com/user-991517211/la-juste-guerre-laurent-cournarie-060122
Serions-nous encore prêts à mourir pour un drapeau, national ou européen ? Sans doute pas, et pas seulement parce que la conscription est révolue. On s’en féliciterait surtout, l’expérience historique des conflits modernes et la réflexion nous ayant enseigné qu’aucune cause ne justifie le prix des sacrifices d’une guerre. Aussi avons-nous du mal à entendre seulement les vers de Charles Péguy dans son poème Eve (1913) :
« Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre !
Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés ! ».
La construction de l’Europe a heureusement préservé la paix sur le vieux continent qui a le plus connu la guerre et l’a peut-être le plus exportée sur les autres. La paix étant la condition de la jouissance de tous les biens, ce serait encore cautionner la guerre que de la qualifier de juste. L’expression de « juste guerre » est nettement oxymorique, ce qui suffit pour y renoncer. Trop de désastres nous ont prévenu contre l’attrait mortifère de la mystique de la guerre qu’elle exprime encore. La doctrine de la juste guerre est morte dans les tranchées. Le slogan « Plus jamais la guerre », « Nie wieder Krieg », mieux le « Plus jamais ça » l’ont enterrée — car “ça” ne mérite même pas le nom de guerre et, a fortiori, de juste guerre.
Pourtant, plusieurs considérations justifient qu’on s’intéresse encore à cette doctrine. Une raison historique d’abord, car même si elle a été abandonnée, elle aura été la longue tradition du droit des gens. Ensuite, si la politique n’a pas seulement le visage de l’amitié civique mais consiste aussi à savoir discerner l’ami de l’ennemi. La guerre constitue peut-être l’horizon indépassable de la politique, et alors il n’est pas inutile de se demander ce qui ce qui pourrait la justifier à défaut de la rendre juste.
Tout repose sur une idée : la guerre est un fait humain (pas de guerre dans la nature). Cette idée entraîne deux questions.
1) Le fait humain de la guerre est-il universel ? La guerre a toujours eu lieu dans le passé comme le moyen ordinaire des puissances pour régler leurs différends. Mais l’universalité passée de la guerre impose-t-elle sa nécessité à toute l’histoire à venir ? Une histoire sans guerre est-elle possible ? Comme l’a chanté et rêvé un compatriote de Shakespeare : “Imagine all the people Livin’ life in peace…” Mais le progrès d’un droit « cosmomolitique » ne pourrait-il pas supprimer la guerre et constituer le seul idéal politique universel, rendant définitivement caduque toute théorie de la juste guerre ?
Ici, on est bien obligé de reconnaître deux choses. D’une part, la guerre n’a pas déserté notre monde. Par exemple le « piège de Thucydide »[1] est peut-être en train de se nouer dangereusement entre la Chine et les Etats-Unis. D’autre part même si la guerre est (jugée) immorale, parce qu’elle est un mal, voire le mal radical par sa puissance de destruction et de désolation, aucun article d’aucune déclaration ne la déclare illégale.
2) Si la guerre est un fait humain, elle n’a rien de strictement nécessaire. Or cette contingence est ce qui rend la guerre évaluable moralement. Quelle évaluation morale la guerre est-elle susceptible de recevoir ?
Les deux questions conduisent à un problème qu’on peut formuler sous la forme d’un paradoxe : si la guerre est immorale, toute guerre est-elle illégitime ?
On se propose de traiter ce problème en trois temps : situer rapidement la juste guerre par rapport à deux autres positions rivales, le réalisme et le pacifisme ; préciser la doctrine classique de la juste guerre ; envisager comment elle pourrait être reformulée aujourd’hui dans le cadre d’un monde cosmopolitique.
1/ Réalisme, pacifisme, juste guerre
Considérons qu’il y a face à la guerre et à la question de son évaluation morale, trois positions : le réalisme, le pacifisme, la juste guerre.
Le réalisme n’est pas un bellicisme, mais il est un amoralisme. Il privilégie une approche pragmatique des relations internationales. La reconnaissance de l’universalité historique de la guerre fonde l’attitude réaliste : les faits sont là. Il y a toujours eu la guerre, donc il y en aura toujours, et penser autrement c’est méconnaître à la fois l’anthropologie et la politique. La guerre ne pourra cesser qu’avec la fin de l’histoire, donc elle ne cessera pas — à moins qu’une ultime guerre thermonucléaire ne mette fin à l’histoire, pourrait objecter le pacifiste. Pour le réalisme, les relations internationales sont des rapports de forces entre les puissances : chaque Etat tend à étendre sa puissance, à défendre ses intérêts, à améliorer l’accès aux ressources vitales, ce qui produit nécessairement des relations conflictuelles. En l’absence d’un Etat mondial, et pour préserver la paix, il faut assurer la balance des puissances. Le réalisme se rallie alors à l’adage latin : si vis pacem, para bellum.
Le pacifisme, à l’opposé du réalisme, est une position morale sur la guerre. La guerre y est intrinsèquement un mal et donc toutes les guerres sont mauvaises, aucune n’est ni justifiée ni juste. Le pacifisme trouve, pour nous historiquement ses premières racines dans l’éthique judéo-chrétienne : la guerre est l’image même du mal, c’est-à-dire la conséquence du péché ; la guerre contredit l’interdit du meurtre et l’enseignement du Christ : « Ne vous opposez pas au mal », « aimez vos ennemis » (Mt 5.44) et des apôtres : « Soyez en paix avec tous », (Rm, 12.18) : « Sois vainqueur du mal par le bien » (Rm 12.21).
Le pacifisme peut aussi s’autoriser des trois types d’éthique normative qu’on s’est habitué à distinguer en philosophie contemporaine : le conséquentialisme, le déontologisme et l’éthique des vertus. Pour le conséquentialiste, les coûts d’une guerre (la somme de maux humains et matériels) sont toujours supérieurs aux bénéfices ; pour le déontologiste, l’intention de la guerre ne peut jamais être universalisée sans violer une obligation fondamentale (ne pas tuer) ; pour l’éthicien des vertus, la guerre empêche le perfectionnisme — comment la guerre pourrait-elle être compatible avec la vertu quand, devenue mécanique et aveugle, elle tue des innocents en masse ? Seule la paix est compatible l’accomplissement moral.
Le réalisme condamne le pacifisme comme un idéalisme, voire un angélisme, inadapté à la politique : donc le pacifisme est politiquement faux. Toutefois, aucune guerre n’est menée par un gouvernement, un Etat-major, sans qu’elle puisse être justifiée dans ses raisons, ses objectifs et même ses opérations. Engageant la liberté et la responsabilité de toute la chaîne de ses acteurs, la guerre n’échappe pas à l’espace de la justification morale[2] : donc le réalisme est moralement faux. Mais le pacifisme, aussi crédible soit-il —le pacifisme est aussi une politique[3], qui peut s’appuyer sur les faits (la plupart des différends entre puissances sont résolus pacifiquement par la voie de la négociation) et sur la critique du sophisme de la nécessité du dernier recours à la guerre — reste une position morale qui ne résiste pas, dans un monde qui est un pluriversum politique, au droit de la guerre impliqué par la souveraineté des Etats.
La doctrine de la juste guerre se présente comme le dépassement des insuffisances du réalisme (qui ignore l’évaluation morale de la guerre) et du pacifisme (qui ignore l’effectivité politique de la guerre). La guerre est nécessaire et parfois légitime. Mais elle n’est justifiée qu’à certaines conditions. La guerre est immorale et n’est jamais un bien mais toutes les guerres ne sont pas injustes. Cette théorie de la guerre juste est ancienne — elle remonte à Cicéron[4] — est établie par les juristes romains et les théologiens chrétiens dont Thomas d’Aquin et par l’école de Vitoria et son disciple Francisco Suarez. Les guerres de religion permettent au juriste et philosophe Grotius (1583-1645) de lui donner une forme moderne dans Le droit de la paix et de la guerre. Ces normes de la guerre juste ont été progressivement introduites, à partir des Traités de Westphalie (1648), dans le droit des nations.
2/ De la guerre à la juste guerre
Le concept de juste guerre prolonge, à sa façon, le concept de guerre qui a la particularité de décrire une violence, même extrême, soumise à des formes juridiques. En effet, la guerre a) commence par une déclaration publique et se termine par un armistice et un traité ; b) implique des Etats et non des individus — qui ne sont donc ennemis que par accident ; c) sa fin est la destruction ou la capitulation de l’Etat ennemi. Aujourd’hui ce concept de la guerre est devenu problématique — par exemple, les Etats sont entraînés dans des conflits par des organisations non étatiques qui disent leur faire la guerre — ce qui a conduit, depuis les années 1970, le droit international public a utilisé de plus en plus les notions de différends, de rupture de la paix, de situations conflictuelles, et non plus seulement celle de guerre[5].
La doctrine de la juste guerre s’attache ainsi à préciser les conditions de justification de la guerre et donc à inscrire plus profondément le droit dans la guerre. La guerre est juste si elle est conforme au droit et si le droit s’applique à tout le processus de la guerre. C’est pourquoi la juste guerre comporte un jus ad bellum et un jus in bello : le premier définit les conditions qui légitiment d’entrer en guerre, le second les conditions qui légitiment la manière de la faire.
Les règles du jus ad bellum sont les suivantes :
1. la guerre doit être déclarée publiquement par une autorité compétente ou légitime (un Etat, une organisation internationale) ;
2. la guerre doit être menée pour une “juste cause” ;
3. les intentions de la guerre doivent dériver d’une intention juste ou droite ;
4. la guerre doit être une réponse proportionnelle à l’agression ;
5. la guerre doit être menée avec une chance raisonnable de succès ;
6. la guerre doit être le dernier recours.
Le jus in bello, de son côté, prescrit trois règles :
1. l’acte de guerre doit obéir au principe de proportionnalité ;
2. l’acte de guerre doit respecter le principe de discrimination qui interdit d’attaquer les non-combattants ;
3. l’acte de guerre doit recourir à la force minimale pour atteindre son objectif.
A suivre…
Bibliographie
Cicéron, Des devoirs
Thomas d’Aquin, Somme théologique (IIa IIæ, Q. 40
Rousseau, Du contrat social
C. Schmitt, Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum, 1950, Paris, PUF, 2001
R. Aron, Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962.
M. Walzer, Just and Unjust Wars, 1977 — trad. : Guerre juste, guerre injuste, Paris, Folio, 2006.
P. Haggenmacher, Grotius et la théorie de la guerre juste, Paris, PUF, 1981
A. Garapon, Des crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale, Paris, O. Jacob, 2002.
S. Chauvier Justice et droits à l’échelle globale, Paris, Vrin, 2006.
Ch. Nadeau et J. Saada, Guerre juste, guerre injuste — Histoire, théories et critiques, Paris, PUF, 2009.
M. Canto-Sperber, Monique, L’idée de guerre juste, Paris, PUF, 2010.
G. Allison, Vers la guerre : la Chine, et l’Amérique dans le piège de Thucydide ?, 2017, Paris, O. Jacob, 2019.
Charte de l’ONU
Notes
[1] La montée en puissance d’une nation émergente entraîne la guerre avec la nation dominante. Cf. G. Allison, Vers la guerre : la Chine, et l’Amérique dans le piège de Thucydide ?, 2017, Paris, O. Jacob, 2019.
« La question des prochaines décennies est de savoir comment la Chine et les États-Unis pourront échapper au “piège de Thucydide”, autrement dit au conflit résultant de la rivalité entre une puissance émergente et une puissance régnante, comme entre Athènes et Sparte au Ve siècle av. J.-C., ou entre l’Allemagne et ses voisins, à la fin du XIXe siècle. L’émergence rapide de toute nouvelle puissance perturbe le statu quo. Historiquement, dans 11 cas sur 15, depuis 1500, cela s’est terminé par une guerre. » (Entretien avec François d’Alançon, La Croix, 5 avril 2013)
[2] Christian Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste — Histoire, théories et critiques, Paris, PUF, p. 26.
[3] L’article 33 de la Charte de l’ONU, conformément à la doctrine de la juste guerre, recommande aux puissances engagées dans un différend de « rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix ». Le principe de l’interdiction du premier recours à la force armée est affirmé. La guerre n’est pas déclarée illégale mais il est illégal de commencer par la guerre. Or si on évite la guerre par la négociation. il suffirait de prolonger la voie diplomatique jusqu’à supprimer l’ultime recours de la guerre. Ce qui signifie que la guerre n’est jamais intrinsèquement ou par elle-même nécessaire, qu’elle est toujours la conséquence d’un défaut de négociation et donc le résultat d’une décision qui préfère y céder plutôt que de consentir à un effort supplémentaire pour l’éviter. Pour le pacifiste donc, la guerre est toujours une construction rhétorique. C’est encore par choix qu’on décide de sa prétendue nécessité[3]. On fait la guerre faute de vouloir la paix jusqu’au bout.
[4] De Officiis, 1.11.33-1.13-41.
[5] Christian Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste — Histoire, théories et critiques, Paris, PUF, p. 13.
Droit de mourir : ultime droit de l’homme ? Christine Soucille 16-12-2021

Droit de mourir : ultime droit de l’homme ?
Christine Soucille
Podcast : https://soundcloud.com/user-991517211/droit-de-mourir-ultime-droit-de-lhomme-christine-soucille-161221?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
« On n’est pas obligé d’y penser avec des têtes d’enterrement mais il est néanmoins nécessaire de réfléchir à notre fin de vie. Il ne suffit pas de dire que nous sommes pour l’euthanasie ».
C’est par ces mots extraits de l’ouvrage d’Anne Bert intitulé « Le tout dernier été » que j’ai choisi d’introduire cette réflexion sur la fin de vie L’auteure, atteinte de la maladie de Charcot, contrainte en 2017 de partir en Belgique pour se faire euthanasier, faute d’avoir pu le faire en France. Elle a choisi à travers cet ouvrage de médiatiser sa fin de vie et de dénoncer les limites de la loi française, en la matière.
Nous abordons donc un sujet polémique, complexe, et d’actualité puisque la dernière proposition de loi, sur la fin de vie a été déposée en mars 2021 par le député Olivier Fallorni.
Pourtant la problématique de l’euthanasie n’est pas une spécificité de notre époque. L’étymologie du mot euthanasie provient du grec eu thanatos signifiant bonne mort, mais qui dans la Grèce ancienne renvoyait davantage à l’idée d’un art de mourir. L’acception contemporaine du terme a évolué dans un contexte de progrès de la médecine, d’allongement de la durée de vie, de médicalisation croissante de la mort
Désormais ce concept est compris comme un droit à mourir dans la dignité.
Par ailleurs, la question de la fin de vie a fait naitre de nouvelles interrogations : que signifie mourir dans la dignité ? Puis je intervenir dans la vie d’autrui pour abréger ses souffrances ? Le droit à la vie n’implique-t-il pas le droit à choisir librement les modalités de sa propre mort ?
Ce serait une gageure de vouloir aborder tous les enjeux éthiques, juridiques, philosophiques, que le sujet soulève.
Aussi ai-je restreint ma réflexion à l’étude de l’encadrement de la fin de vie en France pour tenter de comprendre pourquoi notre droit actuel tout en reconnaissant la légitimité de restituer à l’individu la maitrise sur des derniers instants de sa vie maintient l’interdiction légale de toute forme d’euthanasie et ce malgré une pression médiatique croissante. Comment comprendre cette contradiction ?
1er partie La reconnaissance d’un droit à mourir dans la dignité en France est plus que jamais au cœur d’un débat tumultueux
A/ La notion elle-même de fin de vie est opaque : elle renvoie à une réalité plurielle
1/ Notion de fin de vie entre opacité et complexité :
– Opacité liée tout d’abord à l’absence de consensus sur le plan international.
– Opacité surtout parce que la fin de vie recouvre en effet une pluralité de concepts et de pratiques : euthanasie active, euthanasie passive, euthanasie volontaire, non volontaire, involontaire….
Retenons pour simplifier notre propos que :
– l’euthanasie active suppose un acte volontaire en vue d’abréger la vie du patient
– l’euthanasie passive signifie mettre fin à un traitement curatif ou à un dispositif qui maintien maintenant artificiellement un patient en vie.
– L’aide au suicide consiste à fournir au patient les moyens de se donner la mort ….
2/ En France euthanasie et suicide assisté sont prohibés mais cet encadrement est très contesté : pour preuve le constat, sans appel émis par le Sénat lui-même dans son rapport sur la fin de vie rendu en mars 2021 :
« Malheureusement, le constat, est que l’on meurt encore mal en France : notre encadrement de la fin de vie, précise-t-il, ignore « la détresse de certains malades notre système de prise en charge a perdu de vue l’autonomie du malade sa dignité et le sens qu’il veut donner à sa vie ».
Comprendre ces propos déconcertants suppose d’examiner rapidement quels sont les textes majeurs encadrant la fin de vie en France :
– la loi du 4 mars 2002, dite loi « Kouchner », reconnaît le droit de tout malade à refuser un traitement ;
– la loi du 22 avril 2005, dite loi « Léonetti », introduit des dispositifs majeurs, à savoir
– interdiction de l’acharnement thérapeutique c’est-à-dire la poursuite d’une obstination déraisonnable dans la dispense de soins.
– le droit effectif à bénéficier de soins palliatifs : ces derniers visant à soulager la douleur des malades en fin de vie.
– la loi Leonetti permet enfin à toute personne, de rédiger des directives anticipées, directives qui lui permettent de préciser ses choix en matière de fin de vie, dans l’hypothèse où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté́.
Mais l’élément majeur du dispositif actuel repose sur la loi Claeys-Leonetti loi du 2 février 2016, qui reconnaît un droit à la sédation profonde et continue jusqu’au décès de personnes en fin de vie et dont les souffrances ne sont plus soulageables par les traitements existants.
Attention il ne s’agit pas pour autant d’une reconnaissance du suicide assisté : cette sédation ne peut être délivrée que si le décès est imminent et si aucun traitement ne permet pas de soulager la douleur du patient.
Cependant cet arsenal juridique s’avère être défaillant et contestable : défaillances qui expliquent que depuis 2016 (année d’adoption loi Clayes Léonetti) pas moins de 7 propositions de loi-dont la dernière en mars 2021- ont été déposées, sans succès pour tenter de remédier à ces dysfonctionnements.
Essayons de comprendre pourquoi en France il existe « un mal mourir » persistant pour reprendre les mots du Sénat
B Pourquoi existe-t-il en France un « mal mourir persistant » ?
-Un mal mourir qui s’explique tout d’abord par un sous-équipement en termes d’unités de soins palliatifs inégale répartition territoriale, moyens humains insuffisants, formation des soignants insuffisante…. Bref aujourd’hui en France plusieurs centaines de malades n’ont pas accès aux soins palliatifs et connaissent des fins de vie indignes.
-Un mal mourir qui s’explique également par la persistance, de trop nombreux cas d’acharnement thérapeutique, malgré l’interdiction de l’obstination déraisonnable de soins posée par la loi de 2005..
-Enfin et surtout dans sa rédaction, la loi Clayes Léonetti s’avère être trop restrictive Nous avons vu, en effet, que ce texte conditionne le recours à la sédation profonde et continue jusqu’au décès à deux éléments :
– l’imminence du décès et la présence d’une souffrance non soulageable.
-Des conditions qui, dans les faits, aboutissent à exclure du dispositif de nombreux patients, atteints pourtant de très lourdes pathologies (notamment des maladies neurodégénératives type sclérose latérale ou certaines formes graves de maladie de Alzheimer).
Beaucoup d’entre nous malheureusement ont vu des proches atteints de ces pathologies et savent la souffrance physique et psychique engendrée la perte progressive et irréversible de l’autonomie. Comment expliquer à une personne atteinte d’une maladie neurodégénérative, qu’elle ne peut pas choisir sa fin de vie ?
Une interrogation qui m’amène au second point de mon exposé.
2ème partie
Face à de telles incohérences comment comprendre les refus répétés du législateur français de dépénaliser l’euthanasie active ? Quels dangers comporterait cette dépénalisation ?
Comme 96 % des Français nous pensons que l’euthanasie devrait être autorisée au nom du respect de la dignité de la personne, de son autonomie de la liberté individuelle, je voudrais cependant vous inviter à réfléchir aux risques potentiels ou réels que comporterait la reconnaissance d’un droit à mourir (=arguments régulièrement invoqués par les opposants à l’euthanasie).
A Donner la mort apparaît tout d’abord comme un acte contraire à la déontologie médicale.
La pratique de l’euthanasie est prohibée par le Serment d’Hippocrate, par l’article 38 du Code de déontologie médicale, au terme desquels le médecin s’engage à ne jamais provoquer délibérément la mort du malade. Les médecins qui refusent l’euthanasie rappellent qu’ils sont dans l’obligation de sauver des vies humaines et non de les abréger.
D’ailleurs une partie du corps médical sur la base de ces principes déontologiques critique le principe de la sédation profonde introduit par la loi du 2 février 2016 Clayes Léonetti qui dans son article L1110 -5-3 prévoit explicitement que les « produits utilisés pour la sédation peuvent avoir comme effet d’abréger la vie. » Certains médecins voient dans cet article une autorisation larvée et insidieuse d’euthanasier un patient.
B Reconnaitre un droit à mourir est paradoxalement susceptible de porter atteinte à la liberté
1/ -La dépénalisation de l’euthanasie peut porter atteinte à la liberté du malade lui-même
La question qui se pose est la suivante : La personne malade qui demande le recours à l’euthanasie est-elle réellement libre ?
– Rappelons qu’en droit La décision d’un individu n’est juridiquement valable que si elle émane d’une personne, libre de toute contrainte, apte à exprimer une volonté lucide.
Dès lors peut-on sincèrement penser qu’un homme en proie à la souffrance soit réellement libre : peut-il ,de manière réfléchie et responsable, prendre la décision définitive de mourir
A noter que lorsque le malade n’est plus en état d’exprimer sa volonté, le recours aux directives anticipées ou à l’avis de la famille interroge le juge de la même manière.
En effet on constate que dans leurs arrêts ou décisions le Conseil d’Etat et la Cour de cassation sont régulièrement amenés à s’interroger sur les conditions dans lesquelles a été obtenu le consentement à mourir Leur jurisprudence respective insiste sur le fait que le malade en fin de vie n’a pas toujours un consentement libre et éclairé, et que ses choix sont souvent dictés par les pressions de l’entourage ou par l’intensité des souffrances
Plusieurs éléments, d’ordre non juridique, semblent accréditer cette thèse.
Des études psychiatriques menées sur des patients en fin de vie montrent qu’une personne mourante passe par différents stades : la colère, le désespoir et souvent l’acceptation de leur état.
Le témoignage de certains médecins, responsables des services de soins palliatifs, corrobore ce constat. Citons celui du docteur Desfosses à l’hôpital de la Pitié-Salpetrière, qui affirme que «la plupart des grands malades s’adaptent à leur maladie et que les demandes d’euthanasie, fluctuant dans le temps sont souvent ambivalentes, elles expriment autant la peur de souffrir que la peur de la mort ».
2/Une reconnaissance d’un droit à mourir peut également porter atteinte à la liberté d’autrui
Si le suicide n’engage que la liberté du malade l’acte euthanasique, en revanche, suppose « l’intervention d’une tierce personne, et met en jeu donc la liberté de la personne qui provoquer la mort»
La question qui se pose est simple : peut-on envisager qu’un malade souhaitant mettre fin à ses jours soit en droit d’exiger de la part du médecin qu’il le tue ?
Cet aspect est tout à fait concevable, si l’on considère le droit à mourir comme un droit créance (le titulaire d’un droit créance est juridiquement fondé à exiger quelque chose d’une autre personne)
Alors est-il pensable que titulaire d’un droit à mourir l’individu puisse exiger qu’on lui donne la mort ?
La reconnaissance d’un droit à mourir pourrait ainsi aboutir à la reconnaissance pour le médecin d’un devoir de donner la mort, ou pire par un droit à donner la mort. On ne peut concevoir que, dans une démocratie, la loi aille à l’encontre de l’interdit pénal de tuer autrui et obliger une personne à commettre un meurtre, même avec le consentement du malade.
Enfin les opposants à l’euthanasie dénoncent le risque potentiel de dérives qu’engendrerait une légalisation du dispositif euthanasique.
Un risque effectivement confirmé par certaines enquêtes : plusieurs études menées dans des pays ayant légalisé des formes d’aides actives à mourir révèlent la présence d’un certain nombre d’abus.
Prenons à titre d’exemple l’enquête réalisée en Belgique, en 2007, pays ayant légalisé le suicide assisté depuis 2001sur 6202 décès. Cette investigation a révélé que dans environ 40% des cas d’euthanasie, toutes les étapes du protocole légal encadrant cet acte, n’avaient pas été respectées.
Pourtant malgré ces risques potentiels ou avérés, la question d’une évolution de l’encadrement actuel de la fin de vie se pose et s’impose.
3ème partie
Néanmoins il apparaît urgent, en France de faire évoluer notre législation afin de reconnaitre à chacun un droit de mourir dans la dignité pourquoi ?
A/ Tout d’abord pour mettre fin à la contradiction existant entre la rigueur des textes réprimant l’euthanasie et la clémence des sanctions prononcées par la justice. Je m’explique :
En effet sur le plan pénal l’euthanasie est rigoureusement interdite.
Elle est juridiquement qualifiée le plus souvent, de non-assistance à personne en danger ou de meurtre sur le fondement de l’article 221-1 du Code pénal dispose : « Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre puni de trente ans de réclusion criminelle”. Cette peine peut être potentiellement portée à la réclusion criminelle à perpétuité si le juge retient des circonstances aggravantes telles que préméditation et vulnérabilité de la victime, ce qui est le cas en matière d’euthanasie.
Rappelons que sur le plan pénal, le juge qualifie le passage à l’acte, de « meurtre » sans tenir compte du mobile ni du consentement de la victime. Les mobiles invoqués par les auteurs d’actes euthanasiques sont la compassion, l’amour filial, la volonté de mettre fin à la souffrance et à la détresse du malade. Cependant ces mobiles, s’ils ne sont pas retenus par le juge pénal pour qualifier l’homicide, il n’en reste pas moins que dans les faits, les cours d’assises ne peuvent y demeurer insensibles.
Conclusion : les accusés peuvent être reconnus coupables de meurtres ou d’assassinats mais écoper de peines symboliques sursis, acquittements, non-lieux, peines d’emprisonnement avec sursis.
Chacun a en tête des exemples de procès pour euthanasie très médiatisés illustrant ces incohérences.
En 2001 Anne Pasquiou reconnue coupable par la Cour d’assises de Saint Brieuc du meurtre de son fils autiste de 10 ans après l’avoir noyé dans leport fut condamnée à 3 ans d’emprisonnement avec sursis.
En 2008, Lydie Debaine reconnue coupable de l’assassinat de sa fille lourdement handicapée par la Cour d’assises des Yvelines a finalement été condamnée à 2 ans deux ans d’emprisonnement avec sursis.
Une autre illustration de verdict exceptionnel se retrouve dans l’affaire Vincent Humbert. La mère de Vincent Humbert et son médecin mis en examen pour empoisonnement avec préméditation bénéficieront tous les deux d’un non-lieu général en 2006.
B/ Pour répondre à une attente légitime de l’opinion publique l’évolution de notre législation apparait indispensable . Attente légitime pourquoi ?
– Rappelons que 96% des Français y sont favorables en 2021.
– qu’en Europe et dans le monde cette légalisation de l’aide active à mourir ne cesse de progresser : la Belgique les Pays Bas, la Suisse et récemment en début d’année 2021, l’Espagne et le Portugal ont légiféré en ce sens.
Attente légitime parce que les nombreux témoignages, livres, films, interviews, lettres ouvertes adressées aux plus hautes autorités de l’État, ne peuvent plus nous laisser indifférents
Il apparait finalement regrettable que seule la souffrance et pire la médiatisation de cette souffrance permettent de faire avancer la législation
Pour preuve deux exemples :
1/ Le combat mené par Vincent Humbert et sa mère Marie Humbert
Au moment des faits en 2000 Vincent Humbert est un jeune homme de 20 ans. A la suite d’un accident de voiture, il devient tétraplégique, muet, aveugle.
Confrontés à ce drame, la mère et le fils à leur façon entreprennent alors un combat titanesque pour abréger la vie de Vincent. Le jeune homme qui ne communique plus qu’avec l’utilisation de son pouce adresse une lettre à Jacques Chirac président de la République d’ alors dans laquelle il lui demande un « droit de mourir ». Face au refus des autorités le24 septembre 2003 la mère du jeune homme, Marie Humbert, avec l’aide de son médecin tue son fils de 20 ans. S’engage alors un marathon judiciaire qui s’achève en 2006 par un non-lieu pour la mère et le médecin.
Le cri de détresse de cette mère, le livre poignant de son fils intitulé « Je vous demande le droit de mourir » joueront un rôle décisif dans l’évolution de la législation. En effet à, la suite de cette affaire retentissante, Jacques Chirac met en place une mission parlementaire, présidée par Jean Leonetti, qui aboutira au vote de la loi éponyme.
2/ La détermination de de Chantal Sébire
Cette femme, ancienne institutrice de 52 ans, résidant en Côte d’Or, est atteinte d’une tumeur des sinus et de la cloison nasale, entraînant des douleurs insupportables, une cécité une déformation du visage, la défigurant . Soucieuse de respecter le cadre législatif d’alors, elle demande à la justice, ainsi qu’au président Nicolas Sarkozy la possibilité de recourir à l’euthanasie. Son combat, sera relayé par de nombreux médias non seulement en France, mais également en Europe, en Asie en Amérique.
Cependant sa demande d’euthanasie active est rejetée le 17 mars 2008 par le TGI de Dijon.
Deux jours plus tard cette femme se suicide.
Pourtant à la suite de son combat la mise en place d’une nouvelle mission parlementaire et une commission d’évaluation de la loi Leonetti aboutiront en 2016 à l’adoption de la loi Clayes Leonneti
Pour clore cet exposé et dépasser le traditionnel clivage entre les pour et les contre et quel que soit notre intime conviction, gardons-nous de toute prétention à vouloir décider pour ceux qui connaissent l’épreuve de la fin de vie. Si la tentation nous en prenait, souvenons-nous alors de la sagesse d’ALFRED DE MUSSET nous rappelant que
« L’homme est un apprenti, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert. C’est une dure loi, mais une loi suprême ».
Bibliographie
OUVRAGES
AUMONIER Nicolas, LETELLIER Philippe, BEIGNIER Bernard L’Euthanasie, Presses universitaires de France, Que sais-je ?, 2017 BERT Anne Le tout dernier été Fayard 2017
DEBRÉ Bernard, Nous t’avons tant aimé : L’Euthanasie, l’impossible loi, Le cherche midi 2004.
DERVILLE Tugdual La Bataille de l’euthanasie : Enquête sur les sept affaires qui ont bouleversé la France,éditions Salvator, 2012
GALICHET François Mourir délibérément -Presses universitaires de Strasbourg 2014
HIRSH Emmanuel Hirsh Apprendre à mourir, Grasset 2008
HUMBERT Vincent Je vous demande le droit de mourir J’ai lu, 2004
KAHN Axel, L’Ultime Liberté ? éditions Plon, 2008.
RUFF Pierre Jean, L’euthanasie: comment respecte-t-on le mieux la vie ?, Théolib février 2013
PIN Xavier Pin Droit pénal général éditions Dalloz 2012
PRADEL Jean Les grands arrêts du droit pénal éditions Dalloz 2021
VAN LANDER Axelle Apports de la psychologie clinique aux soins palliatifs Eres, 2015
WACHSMANN Patrick Libertés publiques, éditions Dalloz 2021
ARTICLES
BACHELET Olivier Le droit de choisir sa mort : les ambiguïtés de la cour de Strasbourg Olivier Bachelet | « Revue internationale de droit pénal » 2011/1 Vol. 82 | pages 109 à 127 DEVALOIS Bernard La Vie, 26 février 2013
KROUIFI Maria La notion d’euthanasie face au droit Mémoire Master Droit privé Université de Lille II 2017
Est-il scandaleux de vouloir légaliser l’euthanasie ?https://www.actu-juridique.fr/sante-droit-medical/est-il-scandaleux-de-vouloir-legaliser-leuthanasie/
PROTHAIS Alain Justice pour Vincent Humbert : lettre ouverte à sa mère sur l’état réel de notre droit pénal en matière dite d’euthanasie ou de fin de vie , in Mélanges en l’honneur du professeur Jacques-Henri Robert, Paris, Lexisnexis, 2012, p. 619.
SZYMCZAK David La Cour européenne des droits de l’Homme face aux libertés Europe of Rights and Liberties septembre 2020.
TIBI-LEVY Yaël, BUNGENER Martine Ȇtre là pour être là : discours croisés sur le bénévolat d’accompagnement -Sciences sociales et santé 2017/2 p 5 à 31
TEXTES ET RAPPORTS OFFICIELS
-Rapport Meunier sur la proposition de loi visant à établir le droit à mourir dans la dignité Michelle Meunier Commission des affaires sociales Sénat 2021
Rapport Sicard, Commission de réflexion sur la fin de vie en France, « Penser solidairement la vie », lien internet
Rapport Léonetti mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
-CCNE, Avis n°121, « Fin de vie, autonomie de la personne, volonté de mourir
-Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie
-Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs
– Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
– Loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie -Loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
– JO des Communautés européennes, Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n°2000/C 364-01, URL :
– Décret n° 2006-119 du 6 février 2006 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie et modifiant le code de la santé publique
Actualité pédagogique et culturelle
9 juin 2022
Espagnol et Etudes théâtrales
Homenaje a Buenos Aires
Coor. L. D’Agostin, R. Lafitte et S. Martinot Lagarde
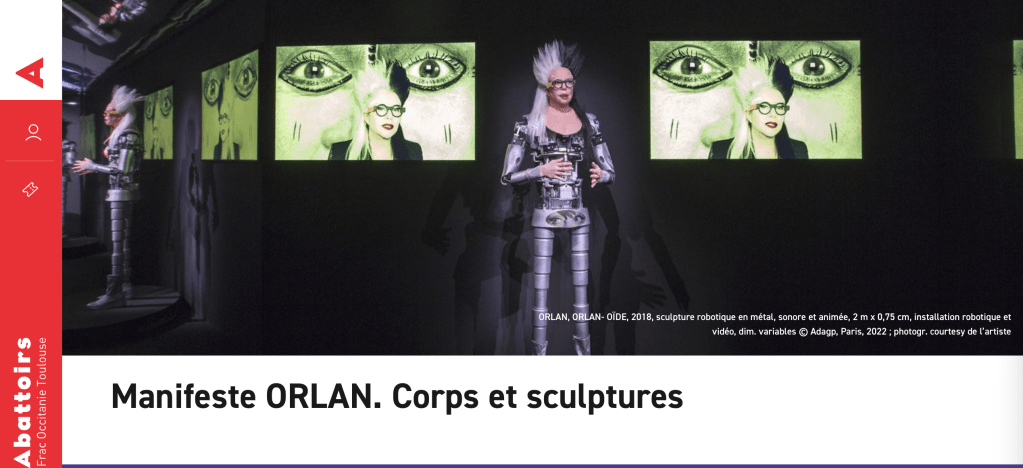
9 juin 2022
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Médiation des étudiants à l’exposition Orlan-Corps

31 mai 2022
13h.
Marie Perny : « L’objet du grenier 3 — Jeanne d’Arc fait l’ouverture du lycée en 1884 ».
A qui appartient Jeanne d’Arc à la fin du XIXe siècle ? Qui protège-t-elle ? Tous s’en réclament, l’Eglise comme la République. A l’ouverture du lycée en 1884, Jeanne est bien présente dans les rayonnages de la bibliothèque : sous quelle forme et pour quel usage ?
24-31 Mai 2022
Espagnol
Voyage d’études en Andalousie, proposé aux étudiants hispanisants LHK et KH.
Coord. : Ludovic D’Agostin

24 mai 2022
13h20
Christine Soucille : « Réalité des droits de l’homme en milieu carcéral »
Si tout détenu, en tant qu’être humain a droit au respect de sa dignité, qu’en est-il de la réalité des droits de l’Homme dans nos prisons ?

23 mai 2022
13h15
Angélique Gomes-Samaran : « Du taylorisme aux groupes semi-autonomes ».
Cette conférence de sociologie du travail dresse le panorama de l’évolution des organisations du travail, de la naissance de la fabrique à la création des groupes semi-autonomes, en passant par la rationalisation taylorienne et fordienne.

9 mai 2022
Midi-Conférences
13h15
Philippe Sierra : « « Vous avez dit “Anthropocène” … regard sur la place saint-Sernin ».
On serait entré dans l’anthropocène ? Un nouvel âge géologique ? La preuve dans le paysage : regardons et pensons la place d’à côté!

22 avril 2022
Espagnol
Hommage au poète espagnol José Hierro (1922- 2002) par les étudiants hispanisants de CPGE 1 et 2 à L’Institut Cervantès le vendredi 22 avril dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance et de la Journée du livre en Espagne. Considéré comme l’une des grandes voix lyriques de la poésie contemporaine, influencée par la Génération de 1927, José Hierro fera évoluer son oeuvre vers une poésie plus centrée sur le « moi » , sur l’rrationnel et les rêves, notamment dans son recueil « Libro de las alucinaciones » publié en 1964.


21 avril 2022
Midi-Conférences
13h15
San Saturnino : « Brouwer : le Dr Jekill et Mr Hyde des mathématiques ».Brouwer : le Dr Jekyll et Mr Hyde des mathématiques
To be or not to be, Brouwer has the answer (or only an intuition). Et il a aussi quelque chose à dire sur ta coupe de cheveux et sur la crise des missiles de Cuba.


19 avril 2022
Midi-Conférences
13h20
Marie Perny : « L’objet du grenier 2 — L’Omphale de plâtre : un Hercule au féminin dans un lycée de jeunes filles ».
Quelle est cette Omphale de plâtre exposée dans l’Hôtel Dubarry qui nous observe depuis 1884 ? Aller à sa rencontre, c’est découvrir pourquoi des chefs d’œuvres de la sculpture étaient dupliqués et quelles étaient les pratiques artistiques dans un lycée de filles à la fin du XIXe siècle.

11 avril 2022
Philosophie
Eric Bories présente son dernier ouvrage consacré à Axel Honneth, Le sens social de la liberté, à la librairie Ombres blanches.
https://www.ombres-blanches.fr/les-rencontres/rencontre/event/Eric-bories/le-sens-social-de-la-liberte-axel-honneth-penseur-de-notre-present/9782406120124/3/2022//livre///9782406120124.html


Jeudi 7 avril 13h20
Midi-Conférences
Gerald Kenny : « William Shakespeare : génie ou imposteur ? »
Shakespeare semble avoir signé son œuvre, mais est-ce bien lui qui l’a bien écrite ? That is the question ! Qui se cache derrière le nom de Shakespeare ? Venez faire un tour en coulisses pour partager quelques interrogations.


31 mars 2022
Midi-Conférences
Eric Bories : Le sens social de la liberté
Se savoir libre, se sentir libre, partager une vie libre. Tout cela n’est pas équivalent et tout se joue dans l’écart entre l’idée qu’un individu peut se faire de cette notion et sa pratique sociale.


Mardi 22 mars
Midi-Conférences
Olivia Bellier-Millès : « Les mathématiques, un savant mélange entre rigidité et souplesse »
Nous verrons comment des méthodes issues de la topologie, l’étude des formes, sont transposées en algèbre, l’étude des opérations, afin d’assouplir la rigidité des égalités qui définissent certaines relations.

Jeudi 17 mars 2022
Midi-Conférences
Marie Pachoud « Comment le genre construit le sexe ».
Il suffit de regarder autour de nous pour identifier immédiatement des filles et des garçons. Cette division est omniprésente dans notre société et nous semble généralement évidente. Mais s’agit-il d’une division naturelle ou sociale ?

17 février 2022
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Médiation des khâgneux sur l’exposition La Déconniatrie


18 février 2022
Midi-Conférences
13h15 — Emmanuel Lacoue-Labarthe-Labarthe : » Temps perdu et temps retrouvé »
Qu’est-ce que perdre son temps ? Que perd-on exactement quand on perd son temps ? Et ce temps qu’on dit perdu peut-il se retrouver ? Si oui, comment ?


8 février 2022
Midi-Conférences
12h45 — Hélène Carbonnell : « Charlotte Perriand »
Cette conférence proposera un aperçu de l’univers de Charlotte Perriand, architecte et designeuse incontournable du 20ème siècle


3 février 2022
Midi-Conférences
13h15 — Pauline Pujo : « Un coming out en 1802 »
Un homme qui aime un homme ? Qui veut vivre sans le cacher ? En 1802 ? Dans ses lettres d’amour à un mystérieux comte hongrois, J. von Müller donne une définition politique et passionnée de ses sentiments.


Mercredi 12 février 2022
9h-15h
Journée Portes ouvertes CPGE AL/BL
https://saint-sernin.mon-ent-occitanie.fr/administration-actualites-vie-scolaire/actualites/journee-portes-ouvertes-cpge-al-bl-samedi-22-janvier-2022-9h-15h-55063.htm

27 janvier-2 février 2022
Histoire des arts
Voyage d’études (Paris-Versailles) avec une Journée d’études sur « L’art et l’animal », organisée par l’APHA
Auditorium du Musée du Louvre
Coord N. Cournarie
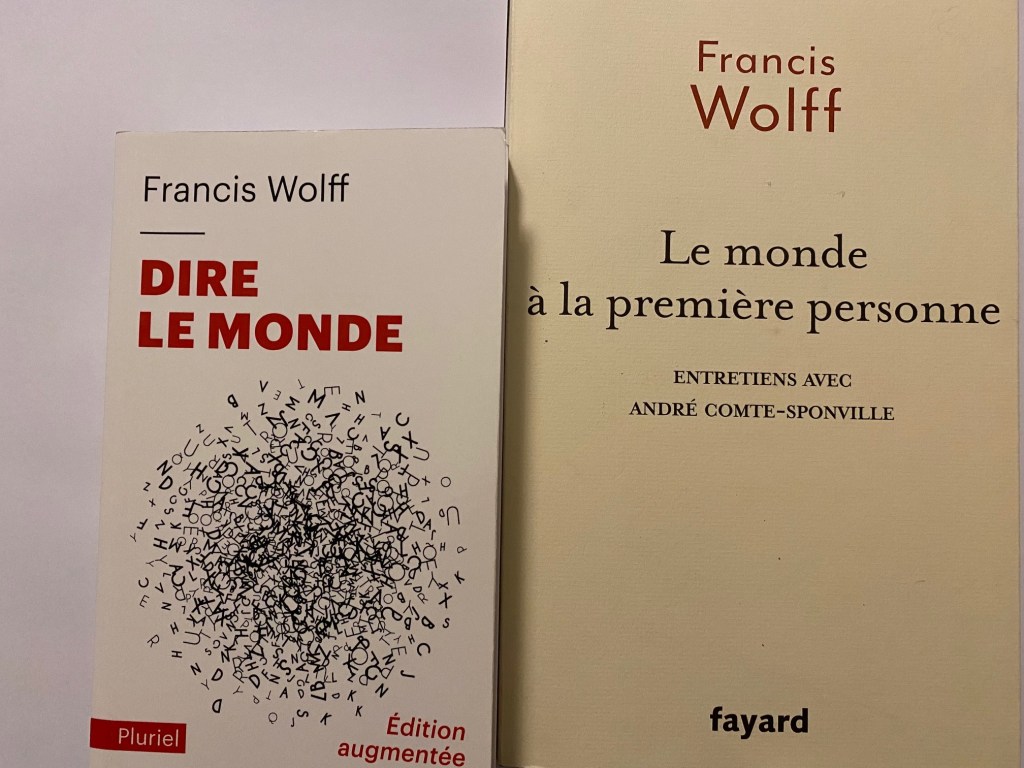
27 janvier 2022
Philosophie
Le philosophe Francis Wolff rencontre les étudiants de l’option et répond à leurs questions sur la notion de Personne, au programme de l’ENS Lyon.
14h30-16h00 — Salle des conférences
Coord. L. Cournarie
André Comte-Sponville dans le dernier ouvrage d’entretiens, Le monde à la première personne (Fayard, 2021) tient F. Wolff « pour le plus grand philosophe français vivant». C’est un philosophe atypique dans le paysage intellectuel français. Il revendique de faire encore ou à nouveau de la métaphysique, et pas simplement pour en proclamer sans fin la mort. Plus précisément, dans Dire le monde, il propose une ontologie descriptive du monde. Et sur cette base, il déploie une anthropologie (par exemple dans D’Aristote aux neurosciences, dans Plaidoyer pour l’universel (Fayard 2019), une esthétique (dans Pourquoi la musique ? (Fayard 2015), voire une éthique et une politique (dans Trois utopies contemporaines, Fayard 2017). Par l’ampleur et la cohérence, voire la systématicité de sa pensée, il répondez ainsi à une définition classique de la philosophie qu’on pouvait croire disparue au profit par exemple de l’ « intellectuel spécifique » ou du chercheur en histoire de la philosophie.
La question de la personne est au cœur des débats contemporains, en droit, en éthique ou en bioéthique notamment. Pourtant, la personne est peut-être d’abord une des trois catégories ontologiques de base pour décrire le monde, avec celles de chose et d’événement. Cette approche a le mérite de libérer le concept de personne de la thèse “herméneutico-historique” sur sa valeur relative. Mais en quel sens la personne est-elle une catégorie ontologique ou métaphysique paradoxalement inappropriée pour répondre à la question qui, ou encore, en quel sens la personne en première personne (“je”) est-elle la réfutation du concept métaphysique de personne ? Mais il faut d’abord se demander sans détour : « Qu’est-ce qu’une personne ? » qui fait l’objet de l’exposé de F. Wolff. (Laurent Cournarie)

27 janvier 2022
Langues et culture de l’Antiquité
Dans le cadre du programme sur « L’homme et l’animal », René Cubaynes présente aux élèves de première année la place du mulet dans l’armée romaine.
13h-14h — Salle des conférences
Coord. J. -L. Lévrier

25 janvier 2022
Midi-Conférences
12h15— Anne-Sophie André : « Noirceur de l’amour dans le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare »
Passions fugitives, blessures d’amour : comédie ou drame ?

25 janvier 2022
Rencontre avec le journaliste Philippe Meyer
LSHB
10h-12h
Salle des conférences
Coord. : C. Catifait

14 janvier 2022
Midi-Conférences
13h30 — Emmanuel Lacoue-Labarthe : « L’engagement »
Promesse, contrat, soutien d’une cause: les formes de l’engagement sont diverses, mais suscitent deux questions communes: pourquoi s’engage-t-on et peut-on ne pas être engagé, est-on jamais tout à fait « dégagé »?

13 janvier 2022
Midi-Conférences
CONFERENCE REPORTEE POUR CAUSE DE MOUVEMENT DE GREVE
13h15 — Jean-Christophe San Santurino : « Brouwer : le Dr Jekyll et Mr Hyde des mathématiques »
To be or not to be, Brouwer has the answer (or only an intuition). Et il a aussi quelque chose à dire sur ta coupe de cheveux et sur la crise des missiles de Cuba.

6 janvier 2022
Midi-Conférences
13h20— Gerald Kenny : « William Shakespeare : génie ou imposteur ? ».
Shakespeare semble avoir signé son œuvre, mais est-ce bien lui qui l’a bien écrite ? That is the question ! Qui se cache derrière le nom de Shakespeare ? Venez faire un tour en coulisses pour partager quelques interrogations.
MODIFICATION – REMPLACEMENT
13h20 — Laurent Cournarie : « La juste guerre » (1)

16 Décembre 2021
Midi-Conférences
13h30 — Christine Soucille : « Droit de mourir : ultime droit de l’homme ?».
Pourquoi reconnaître à chacun de nous le droit de mourir dans la dignité suscite -t-il au tant de contestations ? La question de l’euthanasie ne peut nous laisser indifférent.

6 Décembre 2021
Midi-Conférences
12h30 — Angélique Gomes-Samaran : « L’insécurité sociale ou la société du précariat selon Robert Castel ».
Salle des conférences
Sur fond d’élection présidentielle, le sentiment d’insécurité se propage et serait, selon Robert Castel, le produit d’amalgame de différentes sources d’inquiétudes. Cette conférence proposera une focale sur l’insécurité sociale et les nouveaux processus de précarité qui menacent l’intégrité des personnes.
10 Décembre
Forum des Grande Ecoles
à partir de 13h
Rencontre avec les étudiants de l’ENS Lyon, de l’Ecole du Louvre, du Celsa, SciencesPo Paris, ESSEC, IEP, TSE et bien d’autres Ecoles et Universités…

9 décembre
Histoire des arts
Sortie musée des Abattoirs et médiation des khâgneux sur l’exposition La Dame à la Licorne

30 Novembre 2021
Midi-Conférences
12h30 — Nicolas Moreau : « La fin de l’universel ».
Salle des conférences
L’idéal universaliste, hier force émancipatrice des Lumières, est aujourd’hui déconstruit au profit des identités. La conférence envisagera le besoin et les conditions d’une refondation de l’universel.

22 Novembre 2021
Midi-Conférences
13h20 — Maryse Palévody : « Comment l’esprit vient aux chèvres ».
Salle des conférences
Comment l’esprit vient aux chèvres : des inconvénients du désir et de l’émancipation en moyenne montagne (ou l’histoire tragique d’une petite coureuse en robe blanche).

16 Novembre 2021
Midi-Conférences
13h15 — Laurent Cournarie : « Entrez, il y a aussi des dieux dans la cuisine ».
Salle des conférences
Cette conférence inaugurale présente l’esprit, le sens et l’organisation des Midi-conférences. Tout est bon dans le savoir ; à tout, le savoir est bon ; tous les savoirs sont bons.

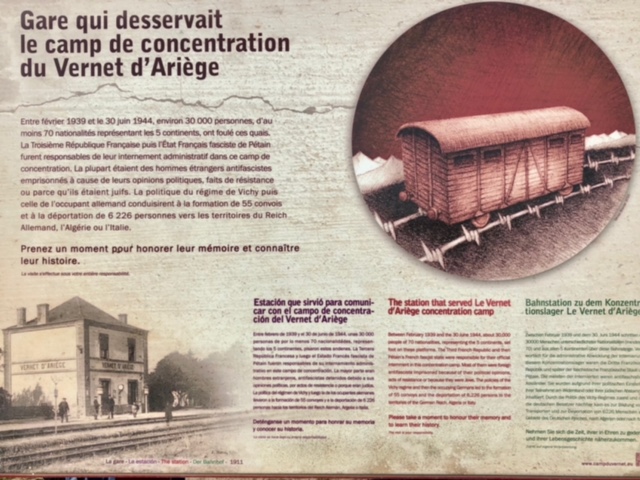
16 octobre 2021
Espagnol
Journée d’intégration

16 octobre 2021
Histoire des arts
Début des médiations des étudiantes et des étudiants pour l’exposition Théodule Ribot au Musée des Augustins

14 Octobre 2021
Allemand
Goethe-Institut
18h30
Prix: Inscription obligatoire :
accueil-toulouse@goethe.de
P. Pujo présente son ouvrage Une histoire pour les citoyens dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande.
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22338776

7 octobre
Espagnol
Coord. R. Lafitte
Les étudiants hispanisants de LVB des trois classes de LSH participent au festival Cinespaña l pour voir le film d’animation Josep dans le cadre de leur étude de La Retirada.


5 octobre
Histoire des arts
Enregistrement par quatre étudiantes de pistes pour l’audioguide del’exposition Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité au Musée des Augustins

5 octobre
Histoire
Coord. O. Loubes
2 octobre à 16h30
Allemand
Coord. P. Pujo
Rendez-vous au cinéma l’ABC pour voir le dernier film du célèbre réalisateur allemand Christian Petzold, URndine

28 septembre
Histoire
Coord. O. Loubes
Rencontre avec l’historien et académicien Pascal Ory.
23-25 septembre
Histoire
Coord. O. Loubes
Consacrée aux « Usages du faux », la 4e édition de L’histoire à venir – dont le lycée Saint-Sernin est partenaire depuis ses débuts (locaux et étudiants/bénévoles) – se déroule en quatre temps en raison de la crise sanitaire. Pour ce troisième moment de débat et d’échange qui aura lieu du 23 au 25 septembre, le programme est d’une exceptionnelle qualité. On y rencontrera en particulier, au théâtre Garonne ou à Ombres blanches, Philippe Descola, l’anthropologue, venu échanger sur la crise écologique avec l’Atécopol toulousain et aussi nous dire avec son livre « Les formes du visible » que l’histoire de l’art n’existe pas… Il en discutera avec Vincent Azoulay, l’antiquisant, qui déploiera par ailleurs une réflexion sur « Tyrannie et démocratie antique : histoires de faux? ». Dans les champs du contemporain, c’est le corps et l’intime qui seront questionnés par Elyssa Mailänder (« Amour, mariage, sexualité : une histoire intime du nazisme (1930-1950) ») et Hervé Mazurel (« Le corps et l’inconscient : des régions de notre histoire collective? »), sans compter tout ce que vous allez découvrir en parcourant le programme, ici.

23 septembre
Allemand
Coord. P. Pujo
A la Cinémathèque de Toulouse : visionnage du documentaire sur les années de plomb en Allemagne de l’Ouest, très marquant et magistralement réalisé, Deutschland im Herbst. Une réflexion sur la violence que nous avons prolongé par un documentaire sur les milieux d’extrême droite aujourd’hui, en échos aux questionnements sur la radicalisation qui occupent les Français en ce moment.

20 septembre
Etudes théâtrales
Coord. S. Martinot-Lagarde
Visite des coulisses du Théâtre de la Cité

20 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Début du stage en médiation des 8 optants d’Histoire des arts au Musée des Abattoirs, sous la direction de M. Vidal, guide-conférencier.

16 septembre
Lettres Modernes
Coord. C. Catifait
« Christine de Pizan ou le féminisme au XVème s » par Florence Bouchet, médiéviste, enseignant-chercheur, Université Jean Jaurès


16 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Rencontre avec M. Axel Hémery, directeur du Musée des Augustins
Communication : « Etre conservateur en musée aujourd’hui ».
Et présentation de l’exposition « Théodule Ribot » dont il est le commissaire

9 septembre
Etudes cinématographiques
Coord. M.-H. Meaux
Projection des travaux des étudiants à la cinémathèque de Toulouse

9 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Rencontre avec Mme Micouleau, chargée de projet, publics étudiants, au Musée des Augustins : présentation des métiers des musées, des projets pour les différents publics et 1ère présentation de l’exposition « Théodule Ribot, une délicieuse obscurité »
https://www.augustins.org/client/210/toulousemetropole_library/AUG_Livret_RIBOT.pdf
Actualité pédagogique et culturelle 2021-2022
9 juin 2022
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Médiation des étudiants à l’exposition Orlan-Corps

17 février 2022
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie
Médiation des khâgneux sur l’exposition La Déconniatrie
10 Décembre
Forum des Grande Ecoles
à partir de 13h
Rencontre avec les étudiants de l’ENS Lyon, de l’Ecole du Louvre, du Celsa, SciencesPo Paris, ESSEC, IEP, TSE et bien d’autres Ecoles et Universités…

t
9 décembre
Histoire des arts
Sortie musée des Abattoirs et médiation des khâgneux sur l’exposition La Dame à la Licorne
Novembre 2021
Début de la saison 2021-2022 des Midi-Conférences
Mardi 16 novembre 13h15 — Laurent Cournarie : « Entrez, il y a aussi des dieux dans la cuisine ».
Salle des conférences

Progammation semestrielle prochainement
16 octobre 2021
Histoire des arts
Début des médiations des étudiantes et des étudiants pour l’exposition Théodule Ribot au Musée des Augustins

14 Octobre 2021
Allemand

Goethe-Institut
18h30
Prix: Inscription obligatoire :
accueil-toulouse@goethe.de
P. Pujo présente son ouvrage Une histoire pour les citoyens dans le cadre de la Quinzaine franco-allemande.
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=22338776

7 octobre
Espagnol
Coord. R. Lafitte
Les étudiants hispanisants de LVB des trois classes de LSH participent au festival Cinespaña l pour voir le film d’animation Josep dans le cadre de leur étude de La Retirada.


5 octobre
Histoire des arts
Enregistrement par quatre étudiantes de pistes pour l’audioguide del’exposition Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité au Musée des Augustins

5 octobre
Histoire
Coord. O. Loubes
2 octobre à 16h30
Allemand
Coord. P. Pujo
Rendez-vous au cinéma l’ABC pour voir le dernier film du célèbre réalisateur allemand Christian Petzold, URndine

28 septembre
Histoire
Coord. O. Loubes
Rencontre avec l’historien et académicien Pascal Ory.
23-25 septembre
Histoire
Coord. O. Loubes
Consacrée aux « Usages du faux », la 4e édition de L’histoire à venir – dont le lycée Saint-Sernin est partenaire depuis ses débuts (locaux et étudiants/bénévoles) – se déroule en quatre temps en raison de la crise sanitaire. Pour ce troisième moment de débat et d’échange qui aura lieu du 23 au 25 septembre, le programme est d’une exceptionnelle qualité. On y rencontrera en particulier, au théâtre Garonne ou à Ombres blanches, Philippe Descola, l’anthropologue, venu échanger sur la crise écologique avec l’Atécopol toulousain et aussi nous dire avec son livre « Les formes du visible » que l’histoire de l’art n’existe pas… Il en discutera avec Vincent Azoulay, l’antiquisant, qui déploiera par ailleurs une réflexion sur « Tyrannie et démocratie antique : histoires de faux? ». Dans les champs du contemporain, c’est le corps et l’intime qui seront questionnés par Elyssa Mailänder (« Amour, mariage, sexualité : une histoire intime du nazisme (1930-1950) ») et Hervé Mazurel (« Le corps et l’inconscient : des régions de notre histoire collective? »), sans compter tout ce que vous allez découvrir en parcourant le programme, ici.

23 septembre
Allemand
Coord. P. Pujo
A la Cinémathèque de Toulouse : visionnage du documentaire sur les années de plomb en Allemagne de l’Ouest, très marquant et magistralement réalisé, Deutschland im Herbst. Une réflexion sur la violence que nous avons prolongé par un documentaire sur les milieux d’extrême droite aujourd’hui, en échos aux questionnements sur la radicalisation qui occupent les Français en ce moment.

20 septembre
Etudes théâtrales
Coord. S. Martinot-Lagarde
Visite des coulisses du Théâtre de la Cité
20 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie

Début du stage en médiation des 8 optants d’Histoire des arts au Musée des Abattoirs, sous la direction de M. Vidal, guide-conférencier.

16 septembre
Lettres Modernes
Coord. C. Catifait
« Christine de Pizan ou le féminisme au XVème s » par Florence Bouchet, médiéviste, enseignant-chercheur, Université Jean Jaurès
Ci-joint, le texte de la conférence
16 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie


Rencontre avec M. Axel Hémery, directeur du Musée des Augustins
Communication : « Etre conservateur en musée aujourd’hui ».
Et présentation de l’exposition « Théodule Ribot » dont il est le commissaire
9 septembre
Etudes cinématographiques
Coord. M.-H. Meaux

Projection des travaux des étudiants à la cinémathèque de Toulouse
9 septembre
Histoire des arts
Coord. N. Cournarie

Rencontre avec Mme Micouleau, chargée de projet, publics étudiants, au Musée des Augustins : présentation des métiers des musées, des projets pour les différents publics et 1ère présentation de l’exposition « Théodule Ribot, une délicieuse obscurité »
https://www.augustins.org/client/210/toulousemetropole_library/AUG_Livret_RIBOT.pdf
L’insécurité sociale ou la société du précariat selon Robert Castel. Angélique Gomez-Samaran 6-12-2021

L’insécurité sociale ou la société du précariat selon Robert Castel
Angélique Gomes-Samaran
Le podcast : https://soundcloud.com/user-991517211/linsecurite-sociale-angelique-gomes-samaran-061221?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Robert CASTEL
Sociologue, philosophe
1933-2013
S’est fait connaître par des travaux critiques sur la psychiatrie dans les années 70 (une dizaine d’ouvrages écrits). Mais ce sont surtout ses travaux sur la question du salariat, de l’Etat social et de la société du précariat qui lui ont valu une large notoriété.
A été directeur d’études à l’EHESS à Paris où il a dirigé le Centre d’études des mouvements sociaux.
A notamment publié « La gestion des risques » (éditions de Minuit, 1981), « Les métamorphoses de la question sociale » (éditions Fayard, 1995), « La montée des incertitudes » (éditions du Seuil, 2009), et, plus récemment « Changements et pensées du changement, échanges avec Robert Castel » avec Claude Martin (éditions La découverte, 2012).
Point de départ de l’intervention
1) les français.es sont traversé.e.s par des incertitudes, des inquiétudes.
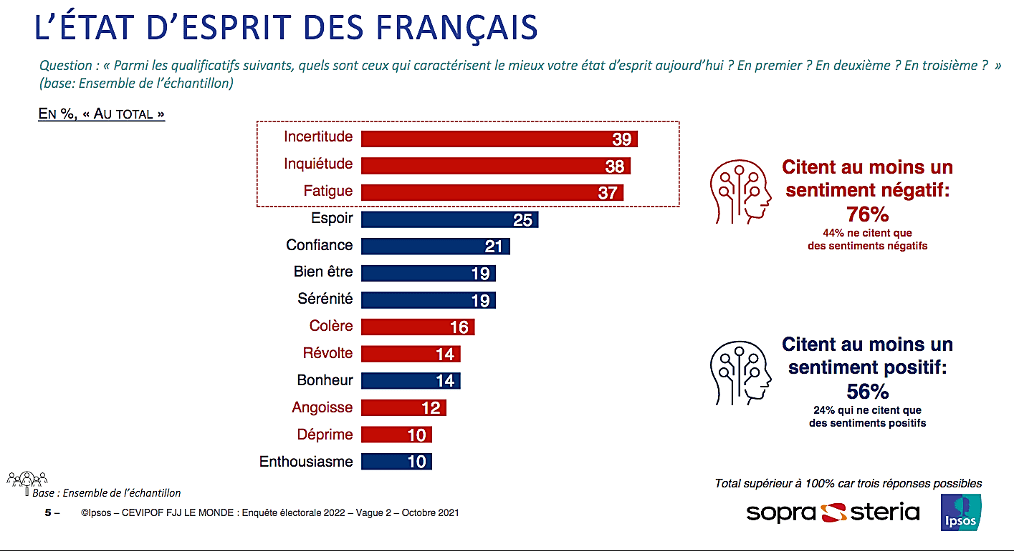
2) le sentiment devenu dominant aujourd’hui est l’insécurité. Cette insécurité s’étend à toutes les sphères la vie : personnelle, familiale, sociale, professionnelle. Elle se traduit par des incertitudes quant à l’intégration sur marché du travail, des inquiétudes quant à l’indépendance économique et le financement des institutions, la peur du terrorisme…

Pour autant, nous n’avons jamais vécu dans une France aussi sure.
Géographiquement, cette infographie qui montre les pays dans lesquels des affrontements armés impliquant des forces d’État et/ou des groupes rebelles ont été signalés en 2021, nous permet de constater que les pays d’Europe occidentalesont plutôt épargnés contrairement à plusieurs régions d’Afrique (Nord, Ouest, Centre, Est), les Porche et Moyen-Orient, par exemple.

Historiquement, si une des raisons de la construction de l’Union Européenne était le dépassement des rivalités entre les peuples et les dirigeants européens et, de fait, la pacification de la zone, pour les générations actuelles, la paix est devenue une normalité, une évidence.
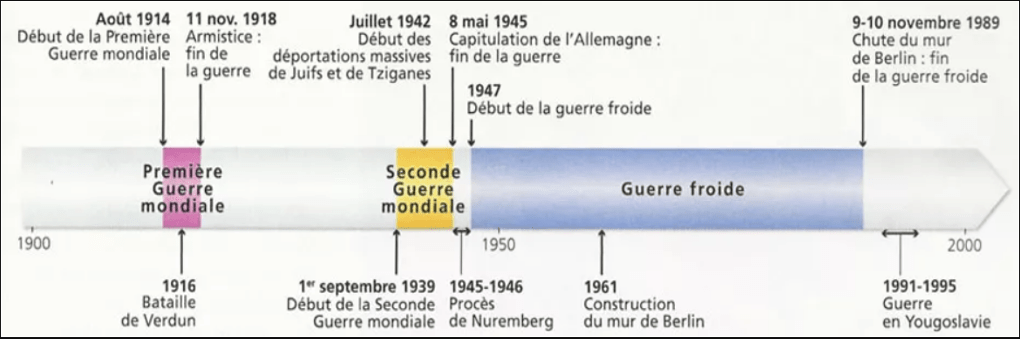
Ce constat en apparence contradictoire permet de mettre en évidence que :
1) le sentiment d’insécurité n’est pas proportionnel au niveau de protection d’une population : il est aujourd’hui plutôt en lien avec des anticipations négatives, des inquiétudes liées à la fragilisation du système et donc à la pérennité des protections (santé, vieillesse, chômage…) dans des contextes économiques aléatoires.
Plusieurs mutations sociales et structurelles ont été à l’œuvre :
Passage des solidarités traditionnelles à l’Etat social.
Passage des vulnérabilités collectives à la protection sociale du travailleur.
Tensions entre liberté et sécurité (exemple COVID : plus de sécurité = plus d’intervention de l’Etat au détriment des libertés individuelles).
2) la plupart des risques ayant été maîtrisés, s’est développée une intolérance à l’insécurité avec pour conséquence le désir d’une anticipation toujours plus grande de ces risques. A un niveau de protection atteint, les risques résiduels apparaissent inacceptables.
Plusieurs mutations sociales et structurelles ont été à l’œuvre :
Passage de la réparation à la prévention.
Passage d’une gestion des « populations à risques » (constat du danger) à une gestion des facteurs de risques (probabilités de survenue).
Passage d’une société du progrès social à une société de la peur.
Illustration par Robert Castel de ces glissements : « autrefois – mais cela existe encore malheureusement aujourd’hui dans quelques endroits – l’humanité aurait été très satisfaite d’avoir simplement à manger, car le risque de la famine a été longtemps un risque réel. Mais aujourd’hui, dans des pays comme les nôtres en tout cas, ce risque a été jugulé et les gens regardent avec inquiétude leur assiette. Ils ont peur d’avaler un produit cancérigène ou d’attraper la maladie de la vache folle, etc. Et finalement, la peur de manger peut remplacer pour certains la peur de ne pas avoir à manger[1] ».
Le sentiment d’insécurité relayé par les médias, exploité par des partis politiques de manière peu scrupuleuse n’existe pas en soi, c’est une construction socialement et historiquement située d’un rapport aux protections. Cette construction dépend à la fois des risques existant à un moment donné, et de la capacité que nous avons ou pas à les prendre en charge.
A quels risques sommes-nous soumis ?
Un risque, c’est un événement prévisible, dont on peut calculer les coûts et que l’on peut maîtriser en le mutualisant, c’est-à-dire en assurant sa prise en charge collective.
Les acteurs de cette mutualisation des risques sont publics (Etat, collectivités territoriales), privés à but non lucratif à travers les organismes sociaux (CPAM, CAF…), et privés à but lucratif à travers les compagnies d’assurance.
Nous sommes soumis.es à trois principaux risques dans nos sociétés contemporaines :
1. les « risques civils », en lien avec la délinquance, qui menacent l’intégrité des biens et des personnes (vols, violences, délits, crimes, incivilités) et renvoient à la problématique de l’Etat de droit et ses deux institutions spécialisées : la police et la justice.
2. Les « nouveaux risques » qui englobent les conséquences catastrophiques et non maîtrisées du développement de la Science, de la Technique et de l’exploitation abusive des ressources naturelles. C’est par exemple, le réchauffement climatique, l’explosion de l’usine AZF, l’exposition à des substances dangereuses/toxiques, les différentes épidémies/pandémies (SRAS, Coronavirus, grippe aviaire..).
3. Les « risques sociaux » en lien avec le développement, à partir de la seconde guerre mondiale, de la société assurantielle et de la mutualisation des risques. (Risques que nous développerons plus bas)
Les risques reposent sur des dimensions différentes mais peuvent survenir de manière synchrone et se cumuler ou asynchrone et se succéder. Par exemple les « nouveaux risques » s’agrègent aux autres comme un peur latente et contribuent à construire/entretenir l’image une société avec un avenir sombre.
Focale sur les risques sociaux
Qu’est-ce que c’est ?
« Être dans l’insécurité sociale, c’est être à la merci du moindre aléa de l’existence. Par exemple, une maladie, un accident ou une interruption de travail, peuvent rompre le cours de la vie et faire basculer un individu dans l’assistance, voire dans la déchéance sociale[1] ».
Histoire de l’assurance des risques sociaux
Lentement, l’Etat social s’est installé, clé de voute d’un système de protections. Il s’est mis en place d’abord à direction des plus défavorisés qui représentaient une majorité part de la population. Il ne s’agissait pas de redistribuer les ressources de façon égalitaire, mais de donner un minimum de ressources et de droits pour que cette catégorie sociale, invisible auparavant, puisse mener une existence avec un minimum d’indépendance pour participer à la vie sociale.
Après le Seconde Guerre mondiale, le système s’est généralisé et organisé autour de la protection sociale qui couvre les principaux risques sociaux : maladie, maternité, invalidité, décès, handicap et logement, accidents de travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage. La mutualisation aménage des solidarités intra et intergénérationnelles (des bien-portants vers les malades, des jeunes actifs vers les seniors retraités).
Problèmes contemporains du système
Les structures de l’Etat social sont aujourd’hui affaiblies, remises en cause sur au moins quatre dimensions :
1) le financement, largement fondé sur les cotisations sociales, est menacé par le chômage de masse, la précarisation des statuts, les déficits budgétaires et la dette ;
2) la généralisation du système à tous les citoyens sociaux est remise en cause en raison du nombre croissant de personnes se situant aux frontières entre emploi et chômage et entre emploi et inactivité, ces personnes ne bénéficiant pas ou bien partiellement des droits et protections ;
3) l’efficacité de la prise en charge est remise en cause à travers l’apparition de nouveaux risques sociaux comme la dépendance qui augmente à mesure que l’espérance de vie augmente, ou encore la dissociation familiale comme les familles monoparentales qui cumulent pauvreté et précarité.
4) dans un contexte de mondialisation, l’Etat social est souvent perçu comme un obstacle au libre déploiement de la concurrence et l’épanouissement du marché libéral. Les surcoûts imposés au travail par les cotisations sociales entravent la compétitivité.
Le processus de désaffiliation au principe des nouveaux risques sociaux
Les « naufragés de la société salariale » comme les qualifie Robert Castel (chômeur de longue durée, bénéficiaires du RSA, jeune en quête d’emploi, de stages, etc.) ont subi un processus de désaffiliation (mot préféré par l’auteur à celui d’exclusion) i.e. qu’ils ont décroché d’une trajectoire où ils avaient support et protection. Ces populations sont menacées par l’insuffisance de ressources matérielles mais également par la labilité de leur tissu relationnel (famille, voisinage, ami.e.s).
Robert Castel distingue trois zones schématisant le passage de l’intégration à la désaffiliation :
– la zone d’intégration (travail permanent et supports relationnels solides),
– la zone de vulnérabilité (précarité du travail et fragilité relationnelle),
– la zone de désaffiliation (absence de travail et isolement social).

Bibliographie
Robert CASTEL, « Les métamorphoses de la question sociale« , Editions Fayard, Paris, 1995,
Robert CASTEL, « La montée des incertitudes« , Editions du Seuil, Collection La couleur des idées, Paris, 2009.
Robert CASTEL, « L’INSÉCURITÉ SOCIALE : QU’EST-CE QU’ÊTRE PROTÉGÉ ? ». Texte communiqué à partir de la rencontre-débat du 16 décembre 2004 organisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne.
[1] Ibid.
[1] Robert CASTEL, « L’INSÉCURITÉ SOCIALE : QU’EST-CE QU’ÊTRE PROTÉGÉ ? ». Texte communiqué à partir de la rencontre-débat du 16 décembre 2004 organisée par le Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne.
L’insécurité sociale ou la société du précariat selon Robert Castel. Angélique Gomez-Samaran 6-12-2021

Angélique Gomes-Samaran : « L’insécurité sociale ou la société du précariat selon Robert Castel ».


