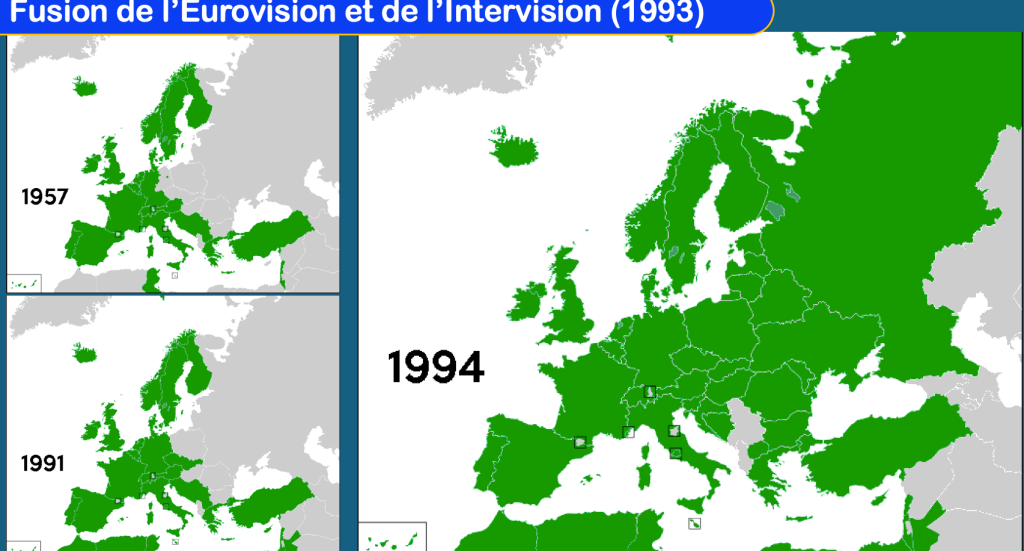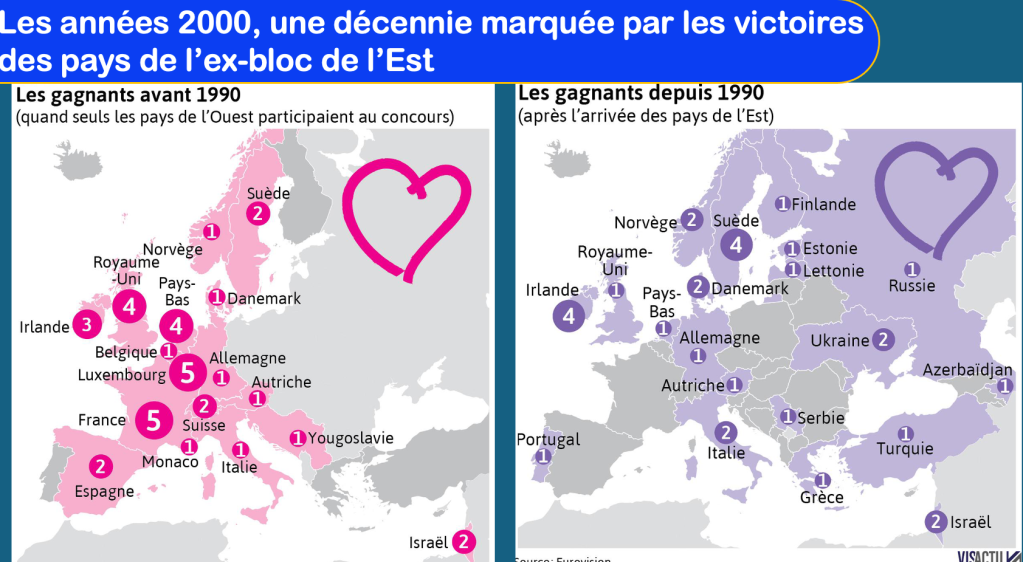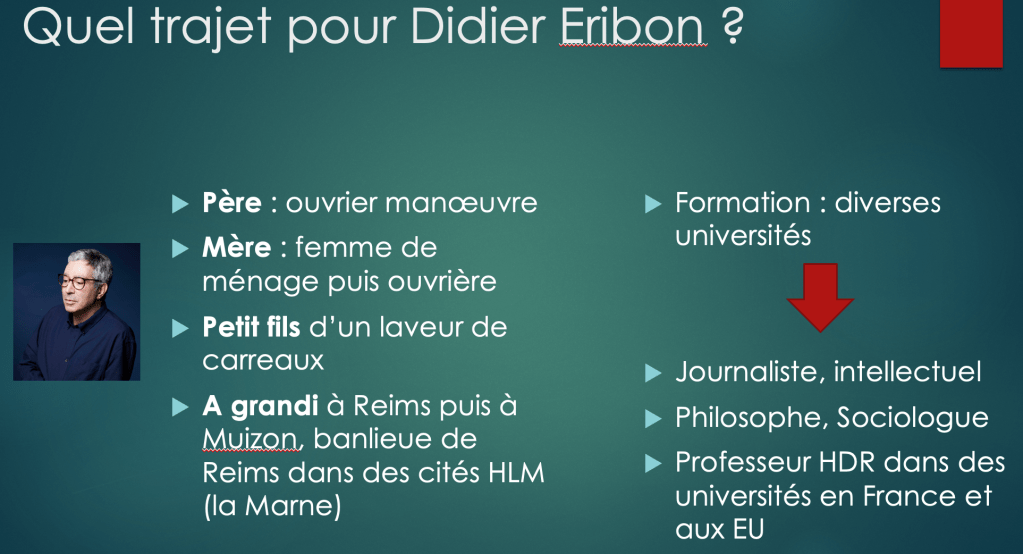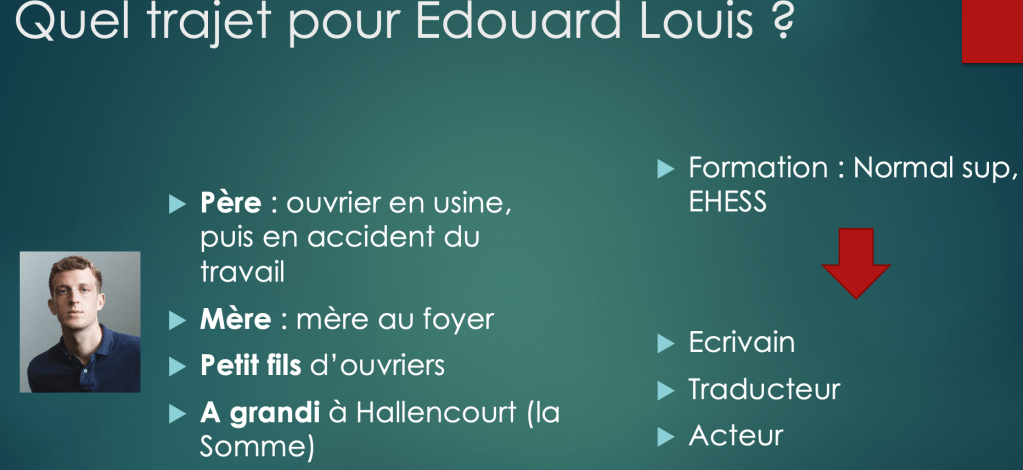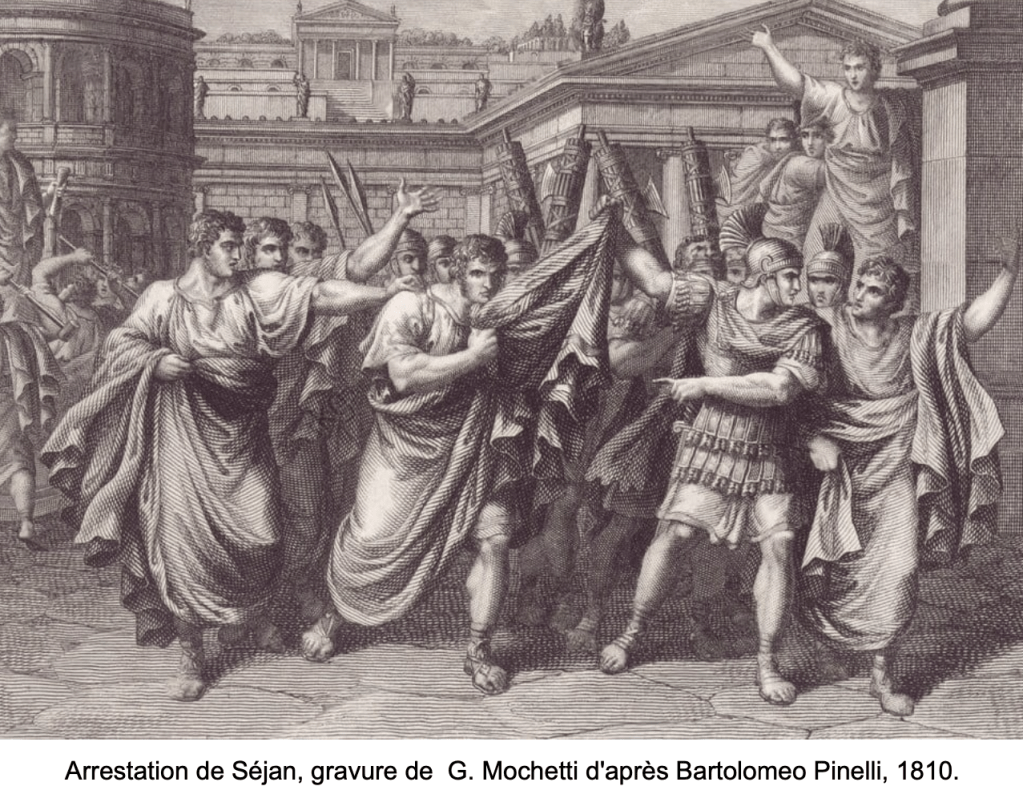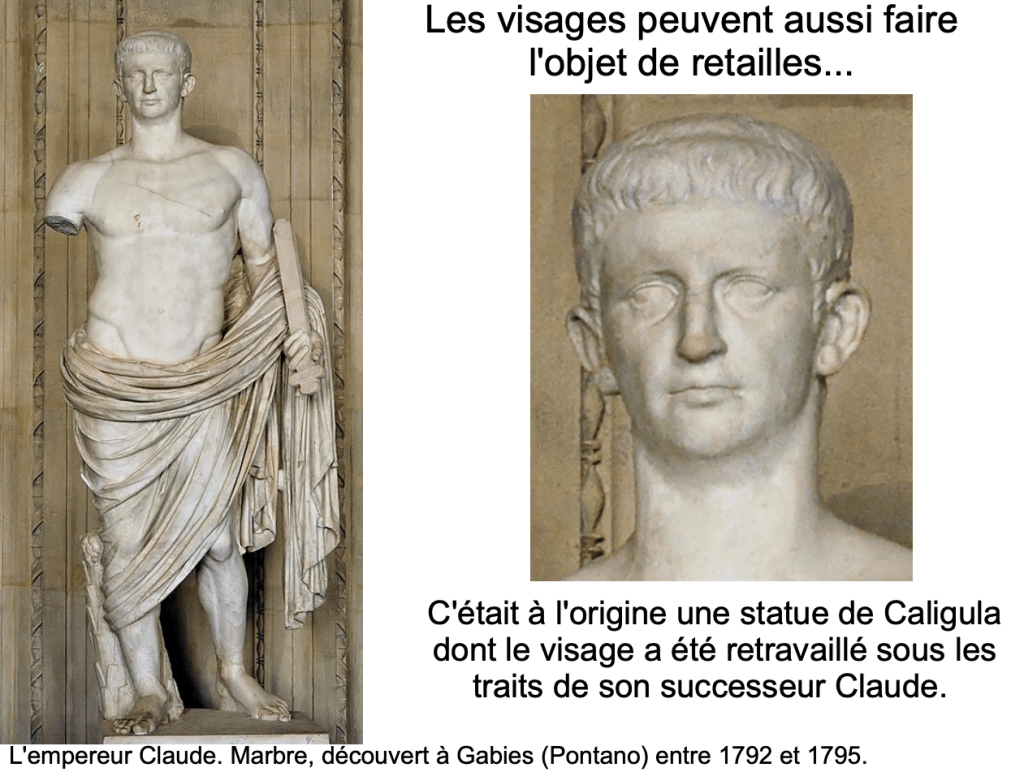Professeure :
Belinda Corbacho
Aux futurs hispanisants BL :
Le cours d’espagnol LVA (LV1) (5h / semaine), dont l’objectif premier est la préparation aux concours d’entrée aux Ecoles Normales Supérieures, porte essentiellement sur trois domaines :
– Histoire et civilisation de l’Espagne et de l’Amérique hispanique contemporaines (XVIII-XX° siècles) pour l’épreuve écrite de commentaire à l’ENS d’Ulm et l’ENS de Lyon (Commentaire en 6h de plusieurs documents)
– Etude de la presse, actualité, culture hispanique et hispano-américaine, civilisation et littérature pour les épreuves orales des ENS Lyon et Ulm (Cours de Mme Corbacho)
– Langue et traduction pour l’épreuve écrite de l’ENS Saclay (version + essai sur la presse en 3 h – Cours de Mme Dudreuil)
Le cours de LVB (LV2) (2h / semaine) a pour objectif principal la préparation aux oraux des concours d’entrée aux ENS.- Etude de la presse, actualité, culture hispanique et hispano-américaine, civilisation et littérature. (Cours de M. Comella en hypokhâgne – Cours de madame Corbacho en khâgne)

Afin de pouvoir, dès les premières semaines de cours, approfondir les connaissances et enrichir la langue sans perdre de temps sur des apprentissages déjà faits dans les classes de collège et lycée, nous vous demandons de réviser impérativement avant la rentrée :
-Les conjugaisons
-Les structures grammaticales et difficultés syntaxiques propres au castillan
-Le lexique vu dans le secondaire
Pour aborder sereinement la prochaine année scolaire, nous vous recommandons également de vous familiariser avec la presse hispanophone afin de vous entraîner à la compréhension d’un texte en langue espagnole mais aussi pour compléter vos connaissances de la culture et de l’actualité hispaniques et hispano-américaines.
Quelques sites d’information en accès libre sur internet pour lire et s’informer cet été et toute l’année.:
Amérique :
www.lanacion.ar (quotidien argentin)
www.pagina12.com.ar (quotidien argentin)
www.lajornada.unam.mex (journal mexicain)
www.plazapublica.guat (journal guatémaltèque en ligne)
www.elespectador.com (quotidien colombien)
https://revistaelestornudo.medium.com/ (journalisme indépendant cubain)
https://gk.city (Média équatorien = reportages approfondis)
Espagne :
www.elpais.es (seuls quelques articles en accès gratuit)
www.lavanguardia.es
www.elsaltodiario.com
https://www.eldiario.es/
Autres médias :
www.rtve.es
www.cadenaser.es
Afin de mieux vous préparer au travail qui vous sera demandé en hypokhâgne, il vous est vivement recommandé de lire un ouvrage de civilisation espagnole et hispano-américaine tel que :
– Carole Poux, Claire Anzemberger, Espagnol – Précis de civilisation espagnole et ibéro-américaine du Xxème siècle à nos jours, 2ème édition, Ellipses, 2021
Si vous n’en disposez pas encore à la maison, nous vous recommandons d’acheter :
– Pierre Gerboin, Christine Leroy, Précis de grammaire espagnole, Hachette éducation (plusieurs rééditions).
– Un dictionnaire bilingue pour mieux appréhender les textes à la maison (Le Larousse bilingue espagnol-français convient tout à fait.
Les étudiants très motivés et d’un très bon niveau d’espagnol pourront, s’ils le souhaitent, permuter leur langue B en langue A afin d’augmenter leurs chances de réussite aux différents concours présentés à la fin de la khâgne, avec l’accord préalable des professeurs d’anglais et d’espagnol.
Le groupe de Langue A espagnol étant d’un effectif réduit (moins de 20 élèves), les progrès et l’aide personnalisée au travail sont facilités.
Attention : votre choix devra être annoncé dès la rentrée. Il va de soi que vous devrez faire les lectures et le travail cet été en fonction de ce choix.
Travail obligatoire pour la rentrée (LVA seulement) (en vue d’une évaluation dès les premiers jours de septembre) :
Maîtriser le présent de l’indicatif et du subjonctif.
Maîtriser les temps du passé de l’indicatif ( prétérit + imparfait) ainsi que le subjonctif imparfait.
Lire les articles en pièce jointe
EL PAÍS – 11 JUN 2024 -Yásnaya Elena A. Gil – ¿Defender la democracia o defender las instituciones democráticas? Ju’ejx
Tal vez el problema viene desde la construcción misma del Estado Mexicano, quienes construyeron el andamiaje que lo sostiene pertenecían a una élite cerrada que entendía de qué iba aquello de construir una República, técnicamente hablando. Con esto no quiero demeritar la movilización popular detrás de la Independencia, pero es verdad que, una vez logrados los objetivos, la mayoría de la población, mayoría indígena durante gran parte del siglo XIX, no participó de la construcción de la arquitectura del Estado naciente. Ni la población afrodescendiente, ni la mayoría de las mujeres ni mucho menos la población empobrecida se sentaron a discutir y a diseñar el funcionamiento de la República, aquello fue tarea de ilustrados y de contadas excepciones como la del zapoteco Benito Juárez que, lejos de responder a la lógica comunalista de su contexto de origen, se convirtió en algo así como el mayor defensor de las ideas liberales para la consolidación del Estado, en muchos casos jugando abiertamente en contra de los intereses de los pueblos indígenas. El andamiaje institucional ha sido históricamente diseñado por grupos de élite que resguardan una especie de conocimiento iniciático.
Por lo que podemos ver de los resultados de la pasada elección del 2 de junio, el llamado de la oposición a defender la democracia no tuvo mayor eco en las casillas. Aquí es cuando conviene distinguir entre “defender la democracia” y “defender las instituciones democráticas”, este último es un sistema institucional de contrapesos y de controles para mantener un equilibrio de poder, sistema que se fue configurando con la llamada transición en cuanto la aplastante hegemonía del PRI como partido de Estado se fue resquebrajando, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) es el organismo estrella de este sistema. ¿Por qué si costó tanto crear este sistema de instituciones para el funcionamiento democrático, la mayoría de la población no salió a votar por la opción que dice defenderlo? Porque una vez más sucedió lo mismo, el movimiento popular que resquebrajó la hegemonía del PRI y que luchó por la democracia fue excluida del diseño técnico de aquellas instituciones cuyo funcionamiento nunca se popularizó realmente, por más que digan que se creó un instituto electoral con liderazgo ciudadano, es verdad que la ciudadanía que participó en su creación y funcionamiento pertenece a una élite que tiene un conocimiento iniciático. El INE ha fallado terriblemente en la educación cívica, en convertir un conocimiento iniciático y elitista en conocimiento popular. ¿Cómo explicar el entusiasmo que hay por la propuesta de López Obrador para que los ministros y las ministras de la Suprema Corte sean elegidos mediante voto popular? Para la defensa de la democracia popular, que la población elija a los jueces es totalmente democrático y quienes defienden lo contrario no han sabido explicar sin tecnicismos su punto, no han sabido popularizar sus términos ni sus argumentos.
Por otro lado, la defensa de la democracia va más allá de la defensa de las instituciones democráticas y creo que justamente eso es lo que no ha entendido la oposición. Por eso se sorprenden tanto de que el movimiento de defensa del INE no se haya hecho masivo y popular. ¿Cómo poneros masivamente a rizar el rizo y discutir “los frenos y contrapesos a las facultades del poder ejecutivo” cuando la desigualdad social es tan radical? Defender la democracia es algo que se ha hecho masiva y popularmente a lo largo de la historia del país; por el contrario, poder participar e incidir en el diseño de las instituciones democráticas y del sistema de frenos y contrapesos necesita de ciertas condiciones materiales y de justicia social que no se ha garantizado para la mayoría de la población mexicana.
Para muchos movimientos populares, instituciones como el INE han incluso traicionado la lucha por la democracia y es por eso que la defensa de este instituto en los términos en los que lo plantea la oposición no son nada populares, para estos movimientos estas instituciones necesitan profundas reformas. Parece haber un divorcio y un contraste rotundo entre la defensa de la democracia y la defensa de las actuales instituciones democráticas. De pronto, para la gran mayoría de la población parece resultar claro que la tarea más urgente para defender la democracia es el combate frontal a la pobreza y a la desigualdad social; claramente una sociedad más justa y más equitativa podrá participar también en igualdad de condiciones en una de las muchas dimensiones de la democracia: el diseño y funcionamiento de las instituciones democráticas.
No puede haber democracia sin justicia social y la mayoría de los votantes cree y siente que esta justicia social está llegando de la mano de la Cuarta Transformación, en esta lógica, la mejor manera de defender la democracia es votar masivamente por Morena. Ambos lados, simpatizantes de Morena y de la oposición, consideran que están defendiendo la democracia y no se entienden en absoluto, ambos lados se acusan de estar dinamitándola.
Sin bienestar y equidad social no puede haber democracia, es verdad, pero desde los movimientos alternativos en resistencia a los megaproyectos, desde la defensa del territorio, desde las personas buscadoras de desaparecidos y colectivos preocupados por el poder que se le está confiriendo a las fuerzas armadas en este sexenio hay evidencias de que Morena no es la respuesta, ni tampoco lo es la oposición. Otras maneras son posibles, pero de eso hablaré en otra ocasión.
Hoy México no solo está listo, sino que será gobernado por su primera mujer presidenta. Quedó demostrado que mientras más mujeres participamos en política, la agenda pública se transforma e incluye temas que los hombres no habían considerado
07 JUN 2024 – NADINE GASMAN ZYLBERMANN – Con Claudia Sheinbaum llegamos todas
¿México está listo para una mujer Presidenta? A lo largo de 200 años de nuestra historia democrática (1824-2024) este cuestionamiento tuvo dos claros propósitos. El primero, reforzar la narrativa de la cultura machista dominante en nuestra sociedad y que no elegiríamos una mujer para tomar decisiones, porque se asumía que la política y los espacios de poder no eran para nosotras. El segundo era precisamente mantener el mito de que no había mexicanas capaces de tomar decisiones en un país tan complejo como el nuestro, porque se nos consideraba frágiles de carácter y demasiado emocionales.
Hoy México no solo está listo, sino que será gobernado por su primera mujer presidenta. Fue un camino lleno de obstáculos y resistencias, pero al ser la igualdad entre mujeres y hombres una de las metas prioritarias de este gobierno de la Cuarta Transformación, el trayecto se redujo y fue posible el sueño de tantas mujeres que lucharon por conquistar nuestro derecho a votar y ser votadas. Por eso era imposible pensar en el segundo piso de la transformación de nuestra vida pública sin una mujer al frente.
Porque en este gobierno apostamos por una auténtica revolución de las conciencias, por una profunda transformación social y cultural donde las mujeres estén en el centro de las prioridades. Por eso, como nunca hubo mujeres protagonistas desde un gabinete paritario y al frente de secretarías del poder Ejecutivo federal. Lo mismo desde el Congreso de la Unión, donde incluso se superó el 50% de representación de senadoras y diputadas. Igualmente tuvimos primeras presidentas del Banco de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, entre otros espacios conquistados.
Quedó demostrado que mientras más mujeres participamos en política, la agenda pública se transforma e incluye temas que los hombres no habían considerado. Así se construyó la ley para la igualdad entre mujeres y hombres, la ley de acceso a una vida libre de violencia, la reforma constitucional para la paridad en todo e instrumentos jurídicos como la tipificación del feminicidio como delito grave, la 3 de 3 contra personas agresoras y deudores alimentarios.
El principio de paridad política se elevó a rango constitucional, se ratificó el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las personas trabajadoras del hogar y el 190 sobre el trabajo libre de violencia y acoso. Principalmente, el tema de los cuidados se colocó en el interés nacional al grado que fue una bandera de las tres candidaturas presidenciales y esta semana se discute en la OIT la inclusión de la economía del cuidado en el marco del trabajo digno.
En el mismo sentido, hoy participan en la economía formal 3.5 millones de mujeres más que antes de la pandemia, se redujo en 3.3 puntos porcentuales la brecha salarial entre mujeres y hombres, el 58% de las personas beneficiarias de los programas sociales son mujeres y redujimos 36% la tasa de fecundidad en adolescentes. Todos estos temas forman parte de una amplia agenda feminista que no sería posible sin la participación de las mujeres y sin el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha sido un aliado de las causas de las mujeres.
Por todo esto me llena de orgullo felicitar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien después de 65 presidentes, será la primera mujer en ocupar el máximo cargo de representación de nuestra nación. Y lo más importante: es una mujer de izquierda, sensible a las necesidades del pueblo, cercana a los movimientos sociales, con alta formación académica y que demostró saber gobernar en la Ciudad de México. Orgullo porque dimos este paso antes que democracias en apariencia más avanzadas, como la estadounidense, y porque ahora son ocho las mujeres latinoamericanas que han alcanzado este cargo.
Felicidades, compañera presidenta. Confiamos en que harás un excelente trabajo para consolidar el segundo piso de la transformación, donde las mujeres estarán al centro como agentes de cambio, reconstruyendo la paz y el tejido social desde el territorio y como líderes impulsando la economía nacional. Somos fruto de nuestras abuelas, de nuestras madres. Y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. Con Claudia llegamos todas, porque ahora sabemos que sí podemos lograrlo.
Nadine Gasman Zylbermann es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
El ciclón Otis exacerbó la vulnerabilidad de las comunidades rurales de la costa de Guerrero, afectadas también por los sismos y las sequías. Las mujeres y las niñas son las más perjudicadas por los efectos del cambio climático
EL PAÍS – Apalani (México) – 16 JUN 2024 – ANDREA J. ARRATIBEL – Hasta siete horas diarias para recolectar agua: la resistencia de las campesinas de Acapulco
En la región agraria de Acapulco, una postal habitual estampa sus paisajes. Por las empinadas colinas que atraviesan los poblados, desde la primera luz del día hasta que el sol se pone, figuras femeninas de todas las edades bajan cargadas con pesados baldes en sus cabezas. En estas comunidades marginadas, construidas sobre los cerros, las mujeres dedican todo su tiempo a trabajar: recogen leña para el fuego, mantienen las milpas, atienden las tareas domésticas y a sus criaturas y preparan las tortillas que saldrán a vender por los caminos. Pero, quizás, a lo que más tiempo dedican es a recolectar agua para sus familias.
“Nos levantamos bien tempranito. Acá nunca acaban los quehaceres”, dice Eveliana Romero, de 53 años, madre de nueve hijos y abuela de más de una decena de chiquillos. “Todos los días hay que ir del arroyo a la casa para traer el agüita en varios viajes”, relata la campesina de Apalani, localidad de unos mil habitantes en la Costa Grande de Guerrero.
Como ella, la mayoría de mujeres de esta región rural dedica hasta siete horas diarias para acarrear agua de los pozos comunitarios a sus hogares. Las más afortunadas cuentan con un burro, bestias de carga a los que las campesinas guían cuesta arriba y cuesta abajo, que llevan a modo de ánforas los bidones a cada costado de su lomo. “Pero yo no tengo uno. Por eso voy bien tempranito por ella”, dice Romero, que lleva haciendo la misma tarea desde que tiene memoria. “Siempre hubo mucho trabajo. Pero más desde que llegó la sequía y la tormenta nos dejó sin techos, sin cosecha. Con miedo”.
Apalani, donde nació Romero y de donde nunca salió, fue uno de los poblados del centro agrario de Acapulco que el 25 de octubre de 2023 azotó Otis, la tormenta tropical que marcó un punto de inflexión en la historia del Estado de Guerrero y en las ciencias meteorológicas. “Empezó a las 10 y no terminó hasta de madrugada. Aquella noche se fue el mundo, parecía que iba a desaparecer, zumbaba muy feo. Las láminas saltaron del tejado a la carretera, los trastes volaban. El viento se llevó los pajaritos, mató a los marranos. Por suerte, no hubo muertos. Pero ese susto no se quita”, confiesa la mujer.
Han pasado más de ocho meses desde que el ciclón arrasó la costa guerrerense y las comunidades van a necesitar años para recuperarse de lo que la tempestad destrozó en una sola hora. En la zona rural, se desbordó el río Papagayo, sobre el que se asientan tantos poblados. Sus aguas desbocadas inundaron parcelas y echaron a perder las cosechas. Se estima que el paso de la tormenta arrasó hasta el 80% del sector agrícola: cultivos de limones, jamaica, ajonjolí, las plantaciones de subsistencia. “Mi esposo tiene su milpita, pero Otis se lo tiró todo”, lamenta Romero, mientras prepara la comida del día. “Cuando hay suerte, compramos un pollo, huevo, aceite, carnita de res… Pero la mayoría de días, almorzamos tortilla con manteca de chuchi (cerdo) que le echamos al comalito”.
Las pérdidas materiales del desastre se vieron amplificadas por la escasez que vive la zona. “El paso del ciclón exacerbó la vulnerabilidad en la que ya se encontraban estas comunidades”, explica Isadora Hastings, una de las fundadoras de Cooperación Comunitaria, organización que trabaja con comunidades rurales en la reconstrucción de hogares. “Llevamos a cabo procesos de reconstrucción integral y participativa de la vivienda tradicional, producción agrícola y restauración ambiental para disminuir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas”, detalla la arquitecta.
Sequía e inseguridad alimentaria
La falta de lluvias que resquebraja la tierra es otro problema en el Acapulco rural. La sequía de 2023 y de este año, junto a la falta de semillas, preludian la inseguridad alimentaria. Si bien las autoridades federales destinaron fondos a los damnificados por Otis a través del Programa de Bienestar, dicen que no les alcanza. “Quienes nos ayudan son las organizaciones”, asegura Romero bajo el techo de su casa a medio reparar. “El Gobierno dio dinero directamente a la gente, pero sin considerar la asesoría técnica”, señala Hastings.
Según explica la arquitecta, cuando al reconstruir no se tienen en cuenta las necesidades locales, “se compra material industrializado, que es más caro”, señala. “Esto impacta mucho en la calidad de vida. Pierden habitabilidad porque se reduce el espacio y empeoran los efectos de la temperatura. También van perdiendo su cultura constructiva, sus saberes tan valiosos sobre el procesamiento de los bienes naturales en materiales”, afirma.
El equipo de Cooperación Comunitaria llegó a estas comunidades mucho antes que azotara Otis. Desde hace diez años trabajan en la región de la montaña. En Cacahuatepec, el municipio cabecera del núcleo agrario de Acapulco, “se han hecho mapeos de riesgos con ocho comunidades para identificar las vulnerabilidades de las poblaciones y trabajar sobre las causas y no solo sobre los daños de Otis”, cuenta Hastings.
Guerrero ocupa el segundo lugar en sismicidad a nivel nacional. Está afectada por la inseguridad y la violencia debida a la penetración del crimen organizado y los conflictos comunitarios, además de la falta de infraestructura y programas públicos. “La política pública ha marginado a esta parte de la población. Las comunidades no cuentan con acceso a salud ni medicinas ni profesionales”, lamenta la arquitecta. Tampoco tienen sistemas sanitarios adecuados. “La gente hace sus necesidades detrás de la casa, al aire libre”, revela mientras a su alrededor pululan los puercos libres como perros callejeros, lo que se puede convertir en una fuente de enfermedades.
El mayor golpe de Otis a las mujeres
Además, “el acceso al agua es malo e inequitativo, y la calidad es nefasta”, enumera Hastings. Su equipo se enfoca en las necesidades de las mujeres, con quienes trabajan en diseñar mapas del terreno para detectar arroyos, fuentes y pozos y crear estrategias integrales de saneamiento doméstico y comunitario para mejorar sus espacios.
“Cuando suceden eventos como Otis, se visibiliza cómo las afectaciones impactan más en las mujeres y niñas”, dice Blanca Meza, responsable de Adaptación y Coordinación de Reducción de Riesgos sobre Desastres en Oxfam México, otra de las ONGs que se instalaron en la zona tras el paso del ciclón. Como destaca la cooperante, “son comunidades que dependen completamente de los bienes naturales para sobrevivir”. Necesitan su milpa para comer, la leña para los fogones y el agua para todo. Pero esos recursos están amenazados por el cambio climático que ya transforma los ecosistemas de México y que también afecta más a las mujeres. “Ellas sufren más los problemas derivados del agua en mal estado o por las condiciones en las que trabajan”, matiza Meza.
En la franja baja de Apalani se encuentra el lavadero donde las mujeres recolectan el agua y lavan. Un refugio ante el sofocante calor, donde el murmullo del agua que brota del arroyo se mezcla con las conversaciones de las mujeres que frotan con ahínco el jabón con la ropa en las pilas y con las carcajadas de las niñas que las acompañan.
“Nos gusta mucho este lugar porque siempre está fresco. Lo malo es que se enloda por la basura, los plásticos se acumulan y a veces huele muy mal por el agua contaminada”, cuenta una de las mujeres. El equipo de Cooperación Comunitaria ha identificado otro problema: mientras sus esposos se bañan en casa con el agua que ellas llevan a los hogares, las mujeres suelen hacerlo en el lavadero. Allí se asean con la ropa puesta por temor a que algún hombre las vea desnuda, lo que se convierte en otro foco de posibles infecciones y en un reflejo de la desigualdad de género.
En el tiempo que la cooperante de Oxfam lleva trabajando en la zona, su equipo ha constatado que parte de esta inequidad se debe a la temprana edad a la que las mujeres son madres. “Chicas de veintitantos que ya tienen muchos hijos, que dejan de estudiar para encargarse de la familia, para llevar a cabo las tareas comunitarias que no se les reconoce como trabajo; las niñas abandonan la escuela para ayudarlas…”, relata.
“En esta región, hay muchas mujeres de 25 años que no saben escribir más que su nombre, con un acceso muy limitado a la información”, continúa. Y eso perjudica a las campesinas que no tienen acceso igualitario a la tierra ni voz en la comunidad. ”Los ejidatarios toman las decisiones y las necesidades de las mujeres quedan fuera”, añade la funcionaria de Oxfam.
Sin embargo, ellas son “quienes sacan a la comunidad adelante, unas tremendas guerreras”, destaca Hastings al referirse a las mujeres y niñas campesinas de Acapulco. Las que cada día suben y bajan las cuestas cargadas con bidones de agua en la cabeza y traen la leña a los hogares, las que no poseen propiedades terrenales aunque son quienes las cuidan y administran: ellas son la verdadera resistencia de la región.